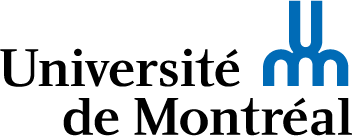Michel Jean: informer pour combattre l’ignorance
- Revue Les diplômés
Le 28 avril 2023
- Virginie Soffer
Seul journaliste autochtone de la télévision francophone au Québec, Michel Jean a aussi écrit 11 romans, dont «Kukum», gagnant du Prix littéraire France-Québec et vendu à plus de 200 000 exemplaires.
D’aussi loin qu’il se souvienne, le journaliste et écrivain Michel Jean a toujours eu de la facilité à manier la langue. «À l’école secondaire, lorsqu’on devait lire un livre et le résumer devant la classe, je n’avais pas besoin de me préparer et j’avais toujours la meilleure note, se remémore-t-il. Lorsqu’on avait des textes à écrire, j’avais aussi les meilleures notes sans faire d’effort.»
Ainsi, lorsque le conseiller d’orientation de son école lui propose d’aller en journalisme, un métier où il peut être rémunéré pour parler et écrire, il adhère à l’idée!
Choisir l’histoire
Après une mineure en sociologie, Michel Jean se tourne vers des études d’histoire à l’Université de Montréal. Il garde un très bon souvenir de ces années. Après son baccalauréat, il commence une maîtrise sur le rôle de la France pendant la crise du pétrole. Il ne l’achève pas, car il obtient un poste de journaliste à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue.
Il reconnaît que ses études d’histoire ont été excellentes pour le journaliste qu’il est devenu. «Elles m’ont forcé à lire beaucoup, à comprendre des situations globales, à faire de très nombreux résumés de lecture. On avait alors de petites fiches sur lesquelles on devait écrire un nombre limité de lignes, pas une de plus!» mentionne-t-il.
Sa démarche d’historien lui est également utile dans son travail de romancier: il part à la recherche de sources avant d’écrire sur un sujet. « Je procède comme lorsque j’étais jeune et que j’entrais à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l’UdeM, où je cherchais des livres afin de m’éclairer dans mes travaux», dit-il.
Écrire sur l’histoire autochtone
Lorsqu’il était étudiant, Michel Jean n’a pas pu suivre de cours sur l’histoire des Autochtones, il n’en existait tout simplement pas! Oui, les cours racontaient la venue des Autochtones par le détroit de Béring, mais il se souvient que, très rapidement, les professeurs évinçaient le sujet du déplacement de ces peuples pour se concentrer sur l’arrivée des colons. «Si les professeurs parlaient de la Conquête, c’était en raison de ses répercussions sur la colonisation pour les Canadiens français», précise-t-il.
De plus, côté littérature, les auteurs autochtones comme An Antane Kapesh et Bernard Assiniwi étaient peu nombreux. Les romans de Virginia Pésémapeo Bordeleau commençaient tout juste à paraître. Michel Jean a trouvé bien peu de modèles littéraires auxquels s’identifier. Et né lui-même à Alma, en dehors de la communauté de Mashteuiatsh, il ne souhaitait pas parler au nom des Innus. Jusqu’au décès de sa grand-mère.
Ce jour-là, il a pris pleinement conscience de son identité autochtone lorsque Jeannette, la cousine de sa grand-mère, lui a dit: «Michel, toi, l’Indien, tu l'as en toi. Je te vois dans des situations où les gens s’énervent autour de toi. Et tu restes toujours calme. Ça, c’est indien.» Ses propos ont dérouté Michel Jean: «C’est vrai que, dans mon métier de journaliste, les gens peuvent être agités autour de moi. Je pensais qu’être calme était un trait de caractère et non un trait culturel. À partir de cet instant, j’ai décidé d’écrire sur la vie de ma grand-mère.»
Jeannette lui a raconté comment elle et ses sœurs ont été envoyées au pensionnat. «Je pensais connaître l’histoire des pensionnats, indique-t-il. En tant que journaliste, je l’avais couverte lorsque j’étais en Saskatchewan. J’avais visité le pensionnat de Marieval, où l’on a découvert plus de 200 cadavres. Il y avait un chemin de croix qu’on trouvait pittoresque. On ne savait pas alors que les religieux y faisaient monter à genoux les enfants qu’ils ne considéraient pas comme assez obéissants. Cet élément, je l’ai appris par des récits familiaux.»
C’est alors que Michel Jean se met à écrire sur un pan de l’histoire des Autochtones au Québec pour raconter ce qui n’a pas encore été dit: «Peu de choses étaient alors écrites sur les pensionnats au Québec. Le colonialisme s’est conjugué en portugais, en espagnol, en anglais, mais aussi, et on l’oublie au Québec, en français.»
Amoindrir l’ignorance
Lorsque Michel Jean étudiait en histoire, il rêvait d’écrire des essais. Ses romans gardent cette trace: avant de commencer l’écriture de chaque livre, il a toujours une idée en tête. «Dans Kukum, le sujet est la sédentarisation forcée des Autochtones et ses conséquences. Dans Tiohtiá:ke, il est question des blessures intergénérationnelles expliquant pourquoi il y a aujourd’hui autant d’itinérants autochtones à Montréal», observe-t-il.
L’écrivain explique qu’il travaille comme un peintre, en superposant différentes couches: «Les gens peuvent lire le livre aussi bien pour l’histoire d’amour que pour le récit d’aventures, les ambiances, les descriptions, etc.»
Son prochain roman parlera du massacre de plus d’un millier de chiens d’attelage par des policiers de la Gendarmerie royale du Canada et de la Sûreté du Québec dans les années 1950 et 1960 et du bouleversement total du mode de vie des Inuits. Un épisode sombre dont on parle encore peu aujourd’hui. «Trop de gens ne voient que les problèmes d’alcoolisme et de violence des Inuits sans réaliser ce qui se cache derrière», déclare-t-il.
Michel Jean ne se perçoit pas comme un militant. «Je suis journaliste, je suis capable de confrontation, affirme-t-il. Mais ce n’est pas dans ma nature. Je trouve que c’est plus efficace d’informer. Je pense que le problème n’est pas le racisme, mais l’ignorance d’où provient le racisme. Alors, j’essaie sans prétention de fournir ma part d’efforts pour amoindrir l’ignorance.»