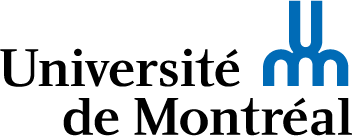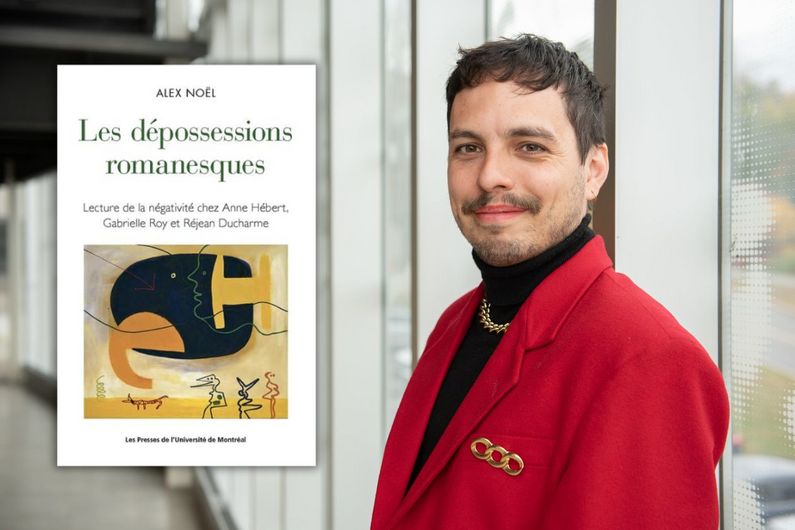Dépossessions romanesques
- UdeMNouvelles
Le 19 mars 2024
- Virginie Soffer
Le professeur de littérature Alex Noël présente son livre «Les dépossessions romanesques. Lecture de la négativité chez Anne Hébert, Gabrielle Roy et Réjean Ducharme».
«Je n’ai pas de point de repère. Aucune horloge ne marque mes heures. Aucun calendrier ne compte mes années. Je suis dissous dans le temps. Règlements, discipline, entraves rigides, tout est par terre. Le nom de Dieu est sec et s’effrite. Aucun Dieu n’habita jamais ce nom pour moi. Je n’ai connu que des signes vides. J’ai porté trop longtemps mes chaînes. Elles ont eu le loisir de pousser mes racines intérieures. Elles m’ont défait par le dedans», écrit Anne Hébert dans Le Torrent que cite Alex Noël dans son livre Les Dépossessions romanesques. Lecture de la négativité chez Anne Hébert, Gabrielle Roy et Réjean Ducharme.
Selon le professeur au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal, cette dépossession existentielle caractérise l’ensemble des romans modernes au Québec. Nous lui avons donné la parole.
Quelle différence remarquez-vous entre le roman moderne québécois et le roman européen? Comment expliquez-vous cette différence?
Le roman moderne québécois semble posséder un drôle de statut aux yeux des critiques, comme s’il lui manquait sans cesse quelque chose pour être pleinement romanesque. Lorsque vient le temps de réceptionner les œuvres, en particulier entre 1950 et 1980, plusieurs critiques québécois identifient des manquements qui écarteraient les livres du genre romanesque auquel ils prétendent appartenir. À les en croire, les romans qui se publient au Québec tout au long du XXe siècle seraient sans amour, sans spiritualité, sans héros, sans introspection, sans maturité ou encore sans aventure, pour ne nommer que ces exemples. Cette tradition de lecture, que j’ai qualifiée pour ma part «d’incapacité romanesque», aurait eu pour principale conséquence de créer un imaginaire générique du roman québécois par la négative. Ces «reproches» peuvent d’ailleurs sembler a priori fort divers, mais en regardant de plus près les textes des exégètes, on découvre un trait commun qui se dessine entre plusieurs d’entre eux, soit l’impossibilité, pour ces romans québécois, d’opérer une transformation. Or, cette idée, selon laquelle le roman aurait pour but de saisir une transformation, ne découle pas d’une pratique locale du roman, mais est importée des modèles européens, en particulier du réalisme français. Dans sa célèbre préface de Balzac et le réalisme français, le théoricien Lukács développe la thèse que le roman aurait pour mission de saisir une transition historique, de rendre compte du conflit entre le personnage et l’Histoire. C’est manifestement cette définition que les critiques ont en tête au moment de réceptionner les œuvres romanesques au Québec, et ils sont déçus ou du moins surpris de ne pas la retrouver dans les romans. Cette grille de lecture est d’autant plus surprenante que peu d’œuvres se rattachant au réalisme ont été publiées au Québec.
Il m’a semblé pour ma part que la transformation, dans le roman québécois, loin d’être liée à l’ascension sociale propre au roman balzacien, n’était pas associée à un gain, mais agissait au contraire comme repoussoir, car elle était liée à la perte. Ainsi, s’il est vrai que, dans les classiques romanesques québécois, les héros ne se transforment pas véritablement entre le début et la fin des romans ou à peine, j’explore pour ma part une hypothèse différente de celles avancées par les autres critiques. J’avance l’idée que si les personnages ne se transforment pas véritablement, c’est moins parce que leur temps est celui de l’inachèvement et de l’immaturité, ou encore parce qu’ils appartiennent à un monde idyllique d’où l’aventure serait absente, mais plutôt parce que leur transformation équivaut à une étape dans le processus de dépossession qui est le leur et que, dès lors, l’enjeu des romans est de raconter leur résistance.
Pourquoi ce titre? Qu’entendez-vous par «dépossessions romanesques»?
Il m’est vite apparu que, dans les romans modernes qui constituaient mon corpus, la dépossession revêtait une dimension formelle, comme si elle se rejouait sans cesse entre l’œuvre romanesque et ses personnages. Ces derniers semblent toujours en lutte contre le roman et sa modernité. Il en résulte des textes qui, loin de pâtir d’une simple incapacité ou d’un manque de moyens, chercheraient au contraire à adapter leur forme pour exprimer la perte, le vide, voire la négativité, au cœur même de leur poétique. Ce faisant, les romanciers et les romancières du modernisme québécois, plutôt que de simplement s’y conformer, ont souvent opéré une torsion sur la forme européenne du roman afin de l’adapter à ce qu’elles et ils avaient à dire. Par l’expression «dépossessions romanesques», j’entends donc un procédé par lequel un roman, qui cherche à mettre en scène la dépossession, l’inscrit à la fois dans son contenu (c’est-à-dire dans les histoires dont il est porteur) et dans sa forme, laquelle se trouve privée de certaines des composantes jugées essentielles aux yeux des spécialistes du genre romanesque.
Comment la dépossession se traduit-elle formellement dans les textes?
Elle varie d’un roman à l’autre et les cas de figure sont nombreux. Ils sont le plus souvent liés à la dimension générique des œuvres. Par exemple, dans les œuvres d’Anne Hébert, en particulier celles narrées au «je», il y a toujours une tension entre l’acte énonciatif et la dépossession. C’est comme si les narratrices et narrateurs devaient sans cesse lutter pour conserver la maîtrise de leur récit. Dans la nouvelle Le torrent, François continue de rejouer en lui la voix de sa mère qui l’a dépossédé et dont il ne parvient pas à se déprendre, quand bien même elle est morte depuis vingt ans; dans Kamouraska, Élisabeth se démène elle aussi contre différentes voix du passé qu’elle semble avoir intériorisées et qui tentent par moments de raconter l’histoire à sa place et de lui faire perdre la maîtrise de son récit (qui passe parfois du «je» au «elle», comme si la narration faite par la protagoniste était menacée); dans le roman polyphonique Les fous de Bassan, les différents narrateurs parviennent mal à se différencier les uns des autres et paraissent tous lutter pour raconter, chapitre après chapitre, la même histoire dans un langage qui se ressemble. Cela a pour effet de retourner contre elle-même la polyphonie, une technique qui est habituellement utilisée pour montrer l’unicité de chaque personnage. Chez Anne Hébert, la polyphonie sert au contraire à pointer l’incapacité des individus à se déprendre du collectif, en plus de faire basculer le roman dans quelque chose de plus monologique, jugé plus près de la poésie. La critique a souvent vu dans la narration autodiégétique, c’est-à-dire où le narrateur est le protagoniste du récit, un trait constitutif du roman moderne québécois. Pourtant, celle-ci se trouve problématisée dans les œuvres d’Anne Hébert, qui nous rappellent que s’exprimer au «je», pour les personnages dépossédés, ne va jamais de soi. Ce ne sont là que des exemples parmi d’autres. Dans les œuvres de Gabrielle Roy, nous voyons qu’une forme romanesque plus ancienne, qualifiée de «romance» par certains théoriciens, effectue un retour. Alors que le roman moderne, au contraire de l’épopée dont les héros sont exemplaires et symboliques d’une communauté, met en scène des individus (souvent qualifiés de héros problématiques), l’unicité des personnages est attaquée dans les œuvres de Réjean Ducharme. La durée du temps romanesque, qui prend la forme du passage de l’enfance à l’âge adulte, est associée au conformisme et menace de déposséder les personnages de leur identité et de faire d’eux des types. Dans ces œuvres que j’ai étudiées, et dans bien d’autres encore, tout se présente comme si le roman, par sa modernité et le principe de transformation qui l’anime, était porteur de dépossession et que les personnages entreprenaient de lui résister.
À propos de ce livre
Alex Noël, Les Dépossessions romanesques. Lecture de la négativité chez Anne Hébert, Gabrielle Roy et Réjean Ducharme, Les Presses de l’Université de Montréal, 2024, 464 p.