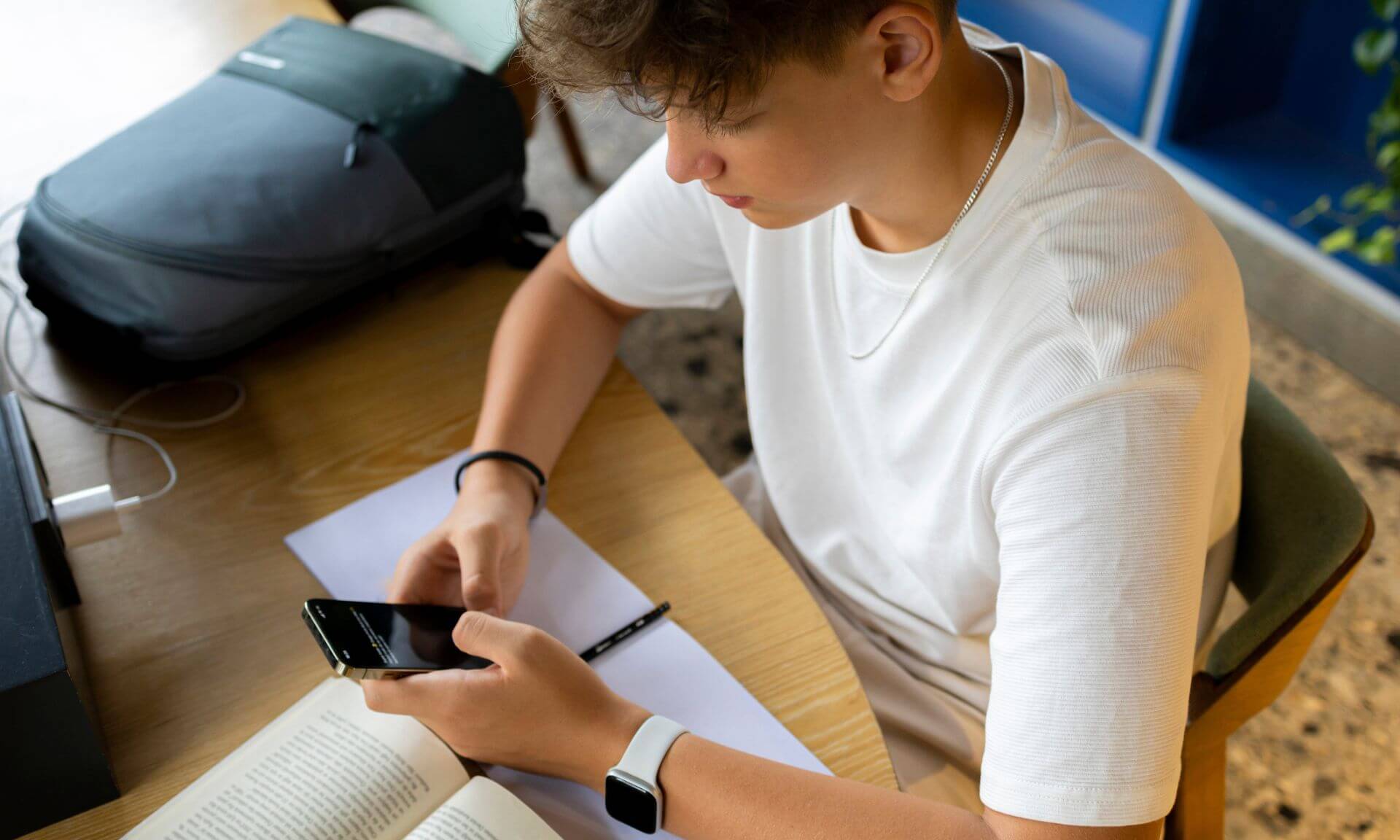La condition enseignante: entre professionnalisation, défis et quête de sens

«Y a-t-il encore, dans le monde contemporain, une place pour un projet d’enseignement partagé et mobilisateur, ainsi que pour la reconnaissance de la figure essentielle que représente l’enseignant ou l’enseignante?»
Telle est la question fondamentale à laquelle le professeur émérite Claude Lessard a voulu répondre à l’occasion d’une conférence prononcée le 6 février à l’occasion de la Semaine des enseignantes et des enseignants.
Organisée par la Faculté des sciences de l’éducation (FSE) de l’Université de Montréal, où Claude Lessard a contribué à la formation des maîtres pendant près de 40 ans, l’activité lui a permis d’exposer sa vision des défis majeurs de la condition enseignante, dont l'autonomie et la reconnaissance sociale de ceux et celles qui exercent la profession.
Des gains et des pertes survenues au fil du temps

Pour Claude Lessard, la condition enseignante se rapporte à deux éléments, soit la situation des membres du personnel enseignant dans le système éducatif – leur formation, l’emploi, leur carrière, leur place dans l’organisation et le système – ainsi que leur statut social et la reconnaissance de leur situation.
À ce chapitre, les enseignantes et les enseignants ont obtenu des gains au cours des dernières décennies, dont la permanence des emplois, la formation universitaire, la reconnaissance des savoirs professionnels et la présence d'associations professionnelles. Mais ils ont aussi accusé des reculs récents, dont la déqualification et la précarisation de l'emploi, la faible attractivité de la profession et l'intensification du travail.
«Ces reculs, survenus au gré des réformes temporaires qui deviennent permanentes, ont contribué à rendre le métier moins attractif, en plus d’entraîner des problèmes de rétention et du décrochage, ce qui a eu une incidence sur la reconnaissance sociale des enseignants et enseignantes et sur leur carrière», a-t-il indiqué.
Les ingrédients d’une professionnalisation
Si les établissements d’enseignement constituent le lieu où la professionnalisation de l’enseignement doit s’exercer «en partenariat avec la direction et les parents», c’est par la formation initiale des enseignantes et des enseignants, leur supervision et la mise à jour de leur expertise qu’elle doit s’incarner.
«En ce qui concerne l’établissement, il faut un leadership, un esprit de corps, prendre le temps de se concerter, une capacité à conclure des accords à l’intérieur du groupe ainsi qu’à régler des conflits, a expliqué Claude Lessard. Et du côté du corps enseignant, la professionnalisation implique une lutte politique, sociale, économique et juridique, et l’identité professionnelle doit être plus assurée et s’affirmer en n’étant pas seulement sur la défensive.»
Claude Lessard juge normal qu’il y ait une tension entre la direction d’école et le corps enseignant «parce qu’ils ne couvrent pas des réalités interchangeables, ils font tous deux partie d’un système de relations interdépendantes et des jonctions sont possibles à travers les notions de professionnalisme collectif et de communauté d’apprentissage professionnel», a-t-il ajouté.
Selon lui, un véritable accord entre le personnel enseignant et les directions d’établissements scolaires est d’autant plus nécessaire qu’il y a «danger de récupération de la nouvelle gestion publique et ses impératifs de performance».
Vers une standardisation du travail enseignant?
Le professeur émérite a abordé deux défis auxquels sont confrontés les enseignants et les enseignantes d’aujourd’hui, soit l’autonomie de la profession et la reconnaissance sociale.
«Avec l’Institut national d’excellence en éducation, qui est juridiquement créé, certaines personnes prétendent qu’il agira comme agent d’uniformisation et de standardisation de l’enseignement, mais s’agit-il d’exagération ou de craintes fondées?» a-t-il soumis à l’auditoire.
Sa réponse a été sans équivoque.
«Jusqu’ici, on n’est pas parvenu à éliminer le facteur humain de l’enseignement parce qu’il ne peut y avoir d’enseignement sans l’engagement réel de l’enseignant ou de l’enseignante et de l’élève, a-t-il dit. L’enseignement est un métier de relations humaines, un travail sur, avec et pour l’humain, avec une composante éthique importante – la bienveillance – et une obligation d’adaptation aux éléments contextuels, de sorte qu’il est impossible de simplement appliquer une règle abstraite.»
Pour ce qui est de la reconnaissance sociale du métier et des raisons pour lesquelles une société devrait le valoriser, Claude Lessard a rappelé qu’il y a eu trois figures de l’enseignement au fil de l’histoire.
Il y a d’abord eu celle de l’école d’autrefois, de la Renaissance à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, «où la professeure ou le professeur était dépositaire d’un savoir légitime et mentor de l’élite sociale».
Ensuite, on a vu celle de l’école moderne, comme porteuse de progrès, «où l’enseignement constituait un véhicule d’ascension sociale et où les membres du personnel enseignant étaient les agents de la modernisation du Québec de la Révolution tranquille: elles et ils étaient l’incarnation de la mobilité sociale, puisque, à la fin des années 1970, 66 % d’entre eux étaient issus de familles d’agriculteurs ou d’ouvriers».
Enfin, il y a eu celle de l’école postmoderne, qui a déconstruit cette vision et cette figure de l’enseignant.
«La modernité n’a pas rempli sa promesse, le progrès par la connaissance inspire le doute, l’avenir apparaît chaotique ou bouché et il ne reste que le moment présent, a souligné Claude Lessard. Le développement du plein potentiel de chacun devient une finalité, ce qui est en harmonie avec l’individualisme dominant et le souci d’individualisation de l’enseignement porté par les pédagogues. Il légitime la bienveillance des enseignantes et des enseignants, mais il ne nous dit rien sur ce qui doit être enseigné.»
De sorte que les membres du corps enseignant doivent paradoxalement exprimer de la bienveillance tout en se souciant de l’efficacité exigée par «le système».
Quelle mission dans un monde incertain?
Pour Claude Lessard, ces trois figures de l’enseignement demeurent, «mais l’enseignement ne peut s’enfermer dans un présent toujours changeant et en accélération, rappelle-t-il. Les deux grandes incertitudes de nos sociétés que sont la démocratie et l’environnement nous obligent à faire appel à des stratégies d’enseignement pour préparer les jeunes face à l’avenir et cela nous enjoint de leur apprendre à penser de manière critique et constructive – dans la recherche du bien commun».
«Si le monde actuel nous paraît fragmenté et si l’individualisme domine, l’école doit – pour retrouver du sens – actualiser sa mission sociale, a conclu Claude Lessard. Il faut résister au “chacun pour soi” et à l’enfermement dans des identités exclusives, établir des liens avec le passé, le présent et l’avenir, entre les personnes et les groupes, dans une école commune axée sur le vivre-ensemble et l’inclusion.»