Plus de 50 % des cliniques d’optométrie n’acceptent pas les urgences de nouveaux patients

Imaginez: vous ressentez une douleur subite à l’œil, des flashs lumineux ou des corps flottants surgissent soudainement dans votre champ de vision. Pourrez-vous obtenir de l’aide rapidement si vous n’avez pas d’optométriste attitré?
C’est à cette question que se sont attaqués Benoît Tousignant, professeur à l’École d’optométrie et à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, et ses étudiantes Catherine Binette et Ariane Duchesne dans une étude parue dans la revue Clinical and Experimental Optometry. Leur enquête, menée à l’aide d’appels simulés partout au Québec, dresse un constat surprenant de l’accessibilité aux soins d’urgence en optométrie pour les patients orphelins. Un constat plus préoccupant encore en milieu périurbain.
Habilités à prescrire des médicaments et à procéder à l’extraction de corps étrangers de l’œil, les optométristes québécois traitent au-delà de 185 000 urgences oculaires par année. Ces professionnels de la santé évitent ainsi aux patients la consultation d’une salle des urgences ou d’une clinique sans rendez-vous.
Des appels mystères pour tester le terrain
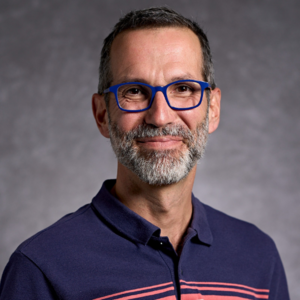
Pour mesurer l’accessibilité à ces services en optométrie de manière réaliste, les chercheurs ont eu recours à une méthode bien connue en santé publique: les patients simulés. Entre mai et juin 2022, Catherine Binette et Ariane Duchesne, alors étudiantes à l’École d’optométrie, ont appelé, du mardi au jeudi, 95 cliniques d’optométrie en se faisant passer pour de nouvelles patientes inquiètes. Elles avaient élaboré deux scénarios. Dans le premier, il était question d’un œil rouge et donc d’une possible conjonctivite. Dans le second, on avançait des symptômes plus inquiétants: des flashs lumineux et des corps flottants, qui évoquaient un risque de déchirure rétinienne. «Ces deux situations sont fréquentes en clinique. On voulait couvrir différents degrés de gravité, allant du cas commun, plus léger, au plus lourd, qui peut avoir des répercussions importantes sur la vision», explique Benoît Tousignant.
L’étude aurait pu se faire différemment. «On aurait pu simplement demander aux cliniques si elles acceptent de traiter les urgences, mais on risquait alors d’obtenir des réponses biaisées par le désir de bien paraître», poursuit-il.
Un patient sur deux n’obtient pas de rendez-vous
Le résultat a surpris les chercheurs eux-mêmes: plus de la moitié des cliniques (53,9 %) n’ont pas proposé de rendez-vous. Un constat jugé «décevant» par Benoît Tousignant, d’autant plus que tous les optométristes sont formés pour traiter ces cas et que les cliniques d’ophtalmologie et les salles des urgences sont souvent engorgées.
Il souligne toutefois que, pour des raisons de faisabilité, l’étude portait uniquement sur de nouveaux patients. Ceux qui ont déjà une clinique attitrée ont vraisemblablement un meilleur accès à une ou un optométriste.
Des écarts marqués entre les régions
Autre conclusion de l’étude: les cliniques rurales sont plus susceptibles d’offrir des rendez-vous. Une bonne nouvelle pour les habitants des régions éloignées, où les ressources hospitalières sont plus rares ou plus distantes. Elles ont proposé un rendez-vous dans 68,9 % des cas, contre seulement 40 % en milieu urbain et 30 % en milieu périurbain. Ce paradoxe s’expliquerait peut-être par l’absence de services hospitaliers spécialisés en région, qui pousserait les optométristes à prendre plus de responsabilités locales.
Facilité de rendez-vous pour les cas plus simples
Concernant la nature du problème, les cas de conjonctivite ont été légèrement plus souvent acceptés (34,8 %) que les cas de déchirure rétinienne suspectée (30,3 %). Un écart léger: les cliniques qui n’ont offert qu’un seul rendez-vous ont eu tendance à favoriser les cas simples.
Selon Benoît Tousignant, c’est probablement une question de logistique:
«Une conjonctivite, c’est rapide à diagnostiquer, dit-il. Quelques minutes suffisent entre deux patients. En revanche, les cas de flashs ou de corps flottants demandent une dilatation des pupilles, des tests plus longs et parfois une redirection vers un spécialiste. Par expérience, on sait que certains facteurs d’organisation interne d’un cabinet peuvent faciliter l’accueil d’une urgence.»
Quand il y a un rendez-vous, c’est rapide et abordable
La bonne nouvelle, c’est que les rendez-vous accordés l’étaient rapidement: le délai moyen était de 3,7 heures. Les cas les plus graves étaient vus un peu plus vite (3 heures) que les cas bénins (4,9 heures).
Côté coût, les frais à la charge du patient restaient modérés et assez uniformes: une somme moyenne de 55 $ à travers la province. «Je m’attendais à des frais plus élevés en région, mais finalement, c’était assez homogène», note le professeur Tousignant.
Une question de répartition plus que de ressources
L’étude ne remet pas en cause la compétence des optométristes québécois ni leur rôle important dans la prise en charge des urgences oculaires. Elle pointe plutôt un problème de répartition des cas entre les cabinets. Certaines cliniques semblent assumer une part importante des urgences, pendant que d’autres n’en prennent que peu ou pas du tout.
«Ce n’est pas juste une question de formation ou de nombre de professionnels sur un territoire donné, un argument souvent avancé pour optimiser l’accès aux soins de santé. Il faut comprendre pourquoi certaines cliniques accueillent les urgences et d’autres non, conclut Benoît Tousignant. Et avant de passer aux recommandations, je resterais prudent. Je pense qu'il faudrait réaliser une autre étude pour savoir plus précisément ce qui fonctionne bien dans les cliniques qui acceptent beaucoup de patients en urgence et ce qui limite les autres. Nous pourrions ainsi mieux comprendre les barrières à la prise d'un rendez-vous et les éléments qui la facilitent.»



