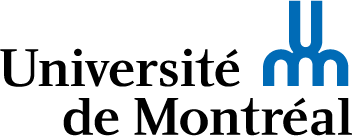Ghislaine Rouly, de patiente partenaire à codirectrice d'une chaire
- UdeMNouvelles
Le 18 avril 2023
- Mylène Tremblay
Pour la première fois, une chaire de recherche du Canada est codirigée par une personne sur la base de son expérience plutôt que de ses diplômes.
Deux maladies orphelines, trois cancers, une immense soif de savoir et une généreuse compassion. À 76 ans, Ghislaine Rouly est riche de toutes ses expériences. Malgré la douleur, elle tourne son cœur vers autrui et met ses connaissances au service de la science.
Patiente partenaire et accompagnatrice auprès de personnes malades, démunies ou en fin de vie, cette battante travaille au sein de la Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et les communautés depuis sept ans.
En tandem avec Antoine Boivin, titulaire de la Chaire et professeur agrégé au Département de médecine de famille et de médecine d’urgence de l’Université de Montréal, elle a cofondé le programme de recherche participative Communauté soignante sur l’intégration des pairs en soins communautaires.
Et voilà que l'expertise de la patiente chercheuse, qui a contribué à la rédaction de six articles scientifiques, obtenu des subventions de recherche à titre de coauteure principale et participé à plus de 70 conférences, est enfin pleinement reconnue: elle devient la première personne à codiriger une chaire de recherche du Canada à la faveur de ses savoirs acquis sur le terrain plutôt qu'à l’université.
Entretien avec une femme engagée qui est au faîte de sa carrière.
Vous êtes membre à part entière de la Chaire depuis un bon moment déjà. Qu'est-ce que cette nomination vient changer pour vous?
Au quotidien, cela ne va presque rien changer, outre que c'est une belle reconnaissance qui me touche beaucoup et dont je suis très fière. L'idée derrière cette nomination, c'est d'ouvrir les portes aux savoirs des patients et de M. et Mme Tout-le-monde. De montrer que, même si l’on n’est pas médecin ou professeur d'université, on peut accéder à des postes intéressants et valorisants – ça vaut bien sûr pour les jeunes femmes, les personnes autochtones, les personnes immigrantes, etc.
Pour la grande curieuse intellectuelle que je suis, la recherche me permet d’aller plus loin, de comprendre, d'analyser. Mais il faut savoir que je n'ai pas de diplôme. La maladie et les hospitalisations m’ont empêchée de terminer une formation universitaire en médecine. C'est ma grande tristesse, moi qui rêvais d'être neurochirurgienne. Mais j’ai persisté. En ce moment, je prépare un diplôme en ligne à l'Université Côte d’Azur de Nice et je fais un certificat à l’Integrated Care Academy d’Irlande.
Vous êtes née en France avec deux maladies orphelines. Or il a fallu 33 ans pour qu’elles soient diagnostiquées. Pourquoi tout ce temps?
Quand j'étais enfant, ça se passait très bien. Je n'avais pas encore les grosses crises que j'ai connues après. Le médecin s'adressait directement à moi et cela me plaisait. Quand je suis arrivée au Québec, à l’âge de huit ans, ç’a été complètement différent. On ne me prenait pas au sérieux, le médecin parlait à ma mère et me regardait à peine. Je lui disais: “Écoutez-moi!” Lorsque les maladies sont trop rares, il est difficile de demander les tests appropriés, car on ne sait pas ce que c’est. Et à l’époque, le paternalisme était la règle… C'est beaucoup plus tard, dans la foulée de mes cancers, qu’on a enfin trouvé. Voilà pourquoi je suis si sensible à l’importance de parler au malade en tant que personne intelligente.
À l’image de votre grand-mère qui était dans la Résistance, vous vous êtes engagée socialement…
Je me suis battue pour obtenir des réponses. Je tenais à exprimer ce que je ressentais. Pour le milieu médical, c’était nouveau de voir une jeune patiente s’impliquer autant dans ses soins. Puis, mes séjours répétés à l’hôpital m’ont amenée à m'occuper des patients. Certains avaient peur, d’autres ne comprenaient pas ce qu’il se passait… Je les réconfortais et j’allais chercher pour eux des explications auprès du personnel soignant.
Toutes ces années d’hospitalisation vous ont conduite à devenir patiente partenaire. Vous avez fait de la maladie votre alliée?
Tout à fait. Dans les années 1990, alors que j’habitais aux États-Unis, le Roswell Park Comprehensive Cancer Center m'a demandé de participer à un projet pilote pour accompagner les patients qui recevaient un diagnostic de cancer. À mon retour au Québec, après avoir survécu à un troisième cancer, j'ai offert mes services à l'Hôtel-Dieu de Montréal, à l’unité des soins palliatifs. En 2012, je me joignais à la toute nouvelle Direction collaboration et partenariat patient de l'Université de Montréal. Trois ans plus tard, je faisais partie d'un comité de gouvernance de l'aide médicale à mourir. Et maintenant, je siège au Groupe interdisciplinaire de soutien à l’aide médicale à mourir du CHUM, des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et du Nord-de-l'Île-de-Montréal, en plus d’accompagner les patients qui font la demande de ce soin de fin de vie.
Au sein de la Chaire, je contribue à l’ensemble des projets et des différents volets – mentorat, recrutement, élaboration de protocoles, questions d’éthique, gestion des données, évaluation, etc.
Comment allez-vous aujourd'hui?
La douleur est constante. Je dois prendre des opiacés pour fonctionner. J'ai des problèmes de mémoire par moments. Mais le fait de travailler en recherche et d’avoir mon esprit rempli de nouvelles connaissances m’empêche d'être continuellement en contact avec la douleur. Pour moi, en tout cas, c'est le meilleur des médicaments. Et c'est ce que j'explique aux patients que j'accompagne: on a toujours le choix face à la maladie: soit on se victimise, soit on l’apprivoise, on suit ses traitements et on continue.