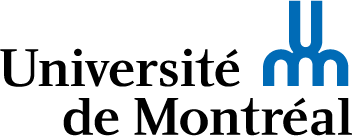Quand la musique de fond est la trame sonore du quotidien
- UdeMNouvelles
Le 2 avril 2025
- Catherine Couturier
Une étude s’intéresse aux habitudes d’écoute de musique de fond chez les jeunes avec ou sans TDAH.
Est-ce que les personnes atteintes d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) sont plus portées à écouter de la musique d’ambiance pendant qu’elles accomplissent une autre tâche? La candidate au doctorat en neuropsychologie clinique Kelly-Ann Lachance, qui s’intéresse aux effets subjectifs de la musique d’ambiance chez les jeunes adultes ayant un TDAH, a voulu répondre à la question.
Dans une étude publiée dans la revue Frontiers in Psychology, elle a analysé les réponses, avec sa directrice de thèse Nathalie Gosselin, neuropsychologue et professeure au Département de psychologie de l’Université de Montréal, de 434 jeunes de 17 à 30 ans à un sondage en ligne sur le sujet (auquel on peut d’ailleurs toujours participer). «Dans les études en laboratoire, on demande rarement les habitudes d’écoute des participants. C’était intéressant de les prendre en compte parce que les gens ont besoin de différents mécanismes d’activation pour bien exécuter une tâche», précise Kelly-Ann Lachance.
La doctorante voulait partager ses trouvailles avec le public. «Comme future clinicienne, j’essaie d’utiliser la recherche pour aider les personnes que je suivrai», note-t-elle. Le choix d’un journal en libre accès n’est ainsi pas étranger à cette volonté.
Étude en ligne
Lancée à la fin de la pandémie, cette étude s’est déroulée en ligne. «Certaines parties du sondage existaient déjà, mais on a regroupé les questions sur les habitudes d’écoute de musique et ses effets subjectifs en un seul questionnaire en ligne, qui se remplit en une quinzaine de minutes», remarque Kelly-Ann Lachance.
L’outil comportait des questions de dépistage de l’Adult ADHD Self-report Screening Scale for DSM-5 (ASRS-5), un outil d’autoévaluation du TDAH; 118 personnes présentaient des signes de TDAH et 316 se sont révélées neurotypiques. «C’est un moyen rapide de prendre le pouls des symptômes», indique Kelly-Ann Lachance.
D’autres questions avaient pour but de mesurer l’état émotionnel récent des personnes participantes, leur niveau d’anxiété et leurs symptômes dépressifs. «La musique est utilisée pour moduler les émotions et on voulait s’assurer de prendre en considération ces aspects-là dans l’étude», explique Nathalie Gosselin, qui est également directrice du Laboratoire de recherche sur la musique, les émotions et la cognition et chercheuse au BRAMS, le Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son.
Bande sonore quotidienne
Parmi les résultats de ce premier coup de sonde, les personnes soupçonnées d’avoir un TDAH écoutaient davantage de musique d’ambiance en moyenne, durant des activités autant cognitives que non cognitives (lire, étudier, écrire par opposition à faire du sport, cuisiner, être dans les transports en commun). Ces répondants et répondantes écoutaient également beaucoup plus de musique en étudiant par comparaison avec les personnes neurotypiques, mais ces dernières passaient plus d’heures par semaine à écouter de la musique activement, c’est-à-dire sans faire autre chose en même temps.
Si les chercheuses ne sont pas complètement surprises par ces résultats, «nous aurions aussi pu imaginer que la musique constitue une interférence lors d’une tâche cognitive exigeante», soulève Nathalie Gosselin. Par conséquent, les personnes ayant un TDAH auraient pu être moins portées à écouter de la musique à ce moment-là.
Les habitudes d’écoute recueillies pointent plutôt vers l’inverse et vers une préférence pour la musique stimulante dans le cas d’un TDAH. «Pourquoi la musique stimulante? La littérature nous dit que les personnes atteintes d’un TDAH ont besoin de plus d’activation pour obtenir un résultat équivalent à celui des personnes neurotypiques. La musique pourrait y contribuer, peu importe le type d’activité», suggère Kelly-Ann Lachance. «Mais cela reste une hypothèse qui devra être analysée dans le futur», souligne Nathalie Gosselin.
Une habitude bénéfique?
Si les personnes qui ont un TDAH écoutent autant de musique, est-ce que dans les faits cette écoute est positive? Joue-t-elle sur la concentration? sur la motivation?
Ces questions taraudent Nathalie Gosselin depuis longtemps. «Mon premier stage en neuropsychologie était en pédopsychiatrie. Dans mes premiers suivis, le parent d’un adolescent avec des difficultés d’attention m’avait demandé si c’était une bonne idée que son jeune écoute de la musique en étudiant, se rappelle-t-elle. Je ne savais pas trop quoi répondre parce qu’on n’avait pas de données probantes dans la littérature à cet égard, mais ça m’est toujours resté en tête.»
La musique étant présente partout et facilement accessible, il serait en effet intéressant de l’ajouter au coffre à outils des stratégies pour gérer les symptômes du TDAH. «La musique ne remplace pas la médication, mais pourrait être un complément. Comment utiliser la musique à son plein potentiel pour favoriser des performances optimales?» s’interroge Kelly-Ann Lachance. Cette publication ouvre donc la porte à d’autres études plus poussées et à des expériences en laboratoire.
À propos de cette étude
L’article «Listening habits and subjective effects of background music in young adults with and without ADHD», par Kelly-Ann Lachance et ses collègues, a été publié dans la revue Frontiers in Psychology.