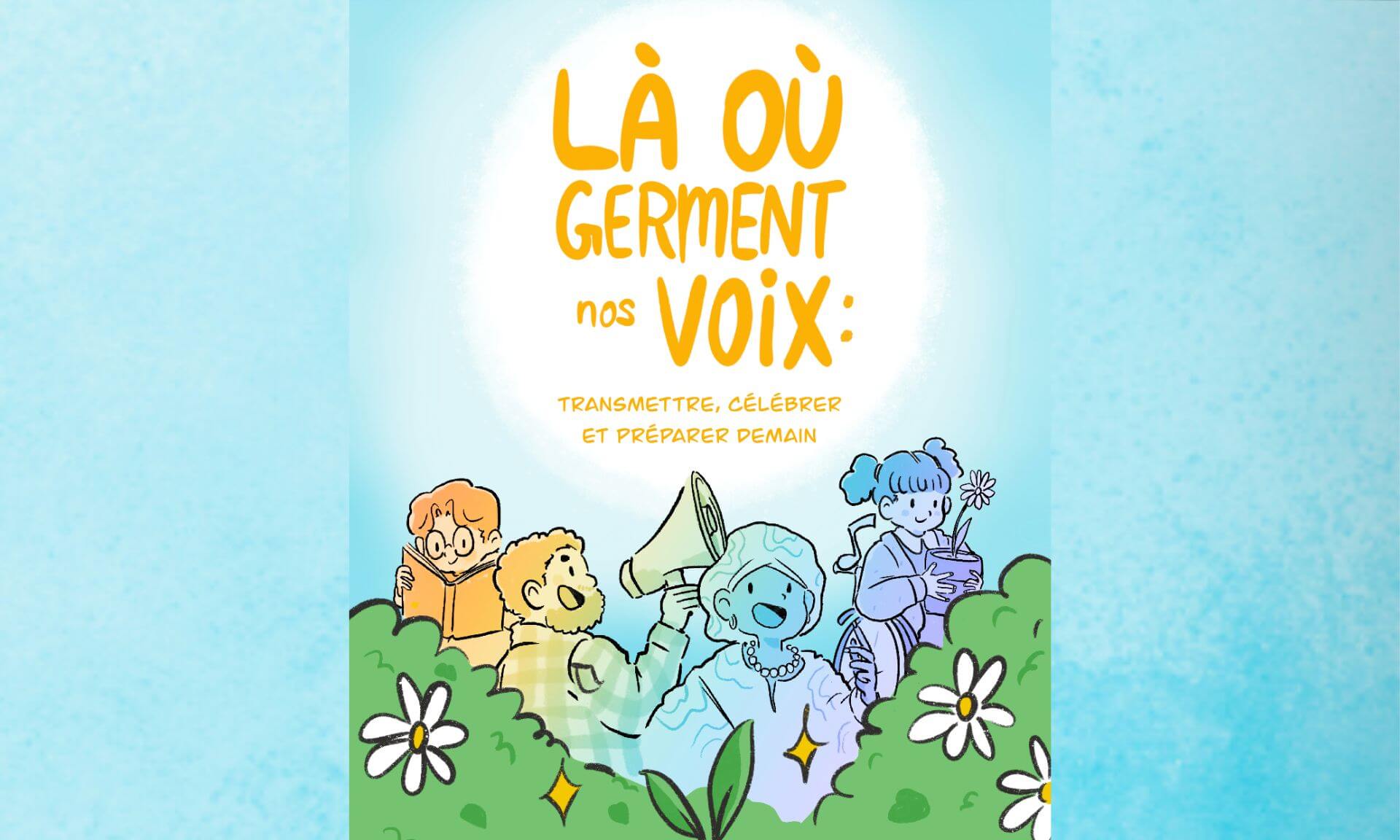Grandir en affirmant son genre

De plus en plus de jeunes trans et non binaires expriment le désir de recevoir des soins médicaux d’affirmation de genre. Mais quelle est leur façon de vivre cette période à l’aube de la puberté? Quelles sont leurs attentes, leurs inquiétudes? Qu’est-ce qui oriente leurs décisions et quel est l’accompagnement offert par leurs familles?
Une vaste étude internationale, menée dans six pays, s’est penchée sur ces questions. Pendant trois ans, des chercheurs et chercheuses ont suivi 45 familles, soit 46 jeunes trans et non binaires de 7 à 16 ans au début de l’étude. Un article au sujet de cette étude a été rédigé par Charles-Antoine Thibeault, doctorant en travail social à l’UdeM, Sabra L. KatzWise, professeure agrégée au Département de pédiatrie de la Harvard Medical School, Patrick André Schmitt, médecin chef de clinique adjoint en santé des adolescents à l’Hôpital Nestlé à Lausanne, et Annie Pullen Sansfaçon, professeure en travail social à l’UdeM et chercheuse principale sur le projet. L’objectif était de mieux comprendre le parcours de ces jeunes et de leurs proches, au-delà des simples chiffres ou des débats médiatiques souvent très polarisés.
Une étude de terrain dans 6 pays
Entre l’été 2022 et l’automne 2023, l’équipe de recherche a mené des entretiens semi-structurés dans six pays (Canada, États-Unis, Angleterre, Suisse, Inde et Australie), en collaboration avec des partenaires locaux. Les discussions exploraient la compréhension de l’identité de genre, la dynamique familiale, le vécu à l’école ou dans la communauté, mais aussi le bien-être et l’accès aux soins médicaux ou psychosociaux liés à la puberté. Les questions posées étaient par exemple: «Pouvez-vous me dire comment vous/votre enfant vous sentez par rapport à la puberté?» «Pouvez-vous me dire comment vous en êtes venu à penser à rechercher des soins médicaux d’affirmation de genre et où vous en êtes dans le processus?» ou «Comment pensez-vous que l’obtention de soins médicaux d’affirmation de genre vous fera vous sentir?»
Pour Charles-Antoine Thibeault, la richesse de cette étude réside dans cette approche qualitative: «Beaucoup d’études se concentrent sur des données quantitatives, comme des échelles de bien-être ou des corrélations statistiques. Mais la réalité des jeunes trans est bien plus complexe.»
Des attentes fortes partagées
Malgré la diversité culturelle des pays étudiés, les jeunes expriment des désirs très similaires. Pour beaucoup, recevoir des soins médicaux d’affirmation de genre, comme les bloqueurs de puberté ou les hormones, représente l’espoir de se sentir mieux dans leur corps. «Je pense que les œstrogènes me rendront heureuse dans mon corps», confie ainsi une jeune fille trans australienne de 13 ans.
Beaucoup espèrent aussi une meilleure reconnaissance sociale. Comme l’explique un garçon trans suisse de 14 ans: «Je pense que ça aidera les gens à m’accepter en tant que garçon.»
Charles-Antoine Thibeault, résume: «Les jeunes cherchent avant tout à se sentir bien dans leur corps et à être perçus comme le genre auquel ils et elles s’identifient, sans devoir constamment expliquer leur situation. Pour certains, ces soins sont aussi un moyen de se passer d’accessoires et de gagner en confort physique et émotionnel.»
La pression du temps à l’aube de la puberté
L’étude montre combien la question du temps est importante à l’aube de la puberté. Pour ces jeunes, chaque année compte: leur aspiration est d’évoluer au même rythme que leurs camarades. Un garçon trans canadien de 15 ans explique: «Dans un an, j’aimerais avoir commencé la testostérone. Ce serait une grande étape. C’est tout ce que je souhaite pour le moment.»
Charles-Antoine Thibeault explique: «Les jeunes veulent vivre leur puberté au même âge que leurs pairs. Reporter une décision jusqu’à 18 ans, c’est souvent leur imposer de subir une puberté qui ne correspond pas à leur genre. Et on s’aperçoit dans nos résultats que les jeunes en parlent très tôt. Ils savent ce qu’ils veulent. Pour eux, ne pas recevoir des soins à temps et ne pas être capables de vivre leur puberté au même rythme que les autres jeunes est une source d’anxiété.»
Des espoirs mêlés d’inquiétudes
Les récits recueillis témoignent cependant de multiples inquiétudes, autant chez les jeunes que chez leurs parents. Certains redoutent les effets secondaires des traitements, les douleurs liées aux injections ou aux interventions chirurgicales futures, ou encore les impacts psychologiques des hormones sur l’humeur. Une mère australienne d’une fille trans de 10 ans confiait ainsi: «Je suis inquiète uniquement à cause d’autres histoires que j’ai entendues, à savoir comment les hormones, les hormones supplémentaires, peuvent réellement modifier leur humeur […] Je m’inquiète donc de cela, et de l’impact que cela pourrait avoir sur son humeur, par exemple, si elle risque de souffrir de dépression, ou quelque chose du genre. Mais je suis aussi très enthousiaste pour elle, car d’un autre côté, j’entends tellement d’histoires de jeunes enfants, d’adolescents qui commencent leur traitement hormonal, et ils sont tellement enthousiastes.»
D’autres s’inquiètent des conséquences sociales d’une transition visible: risque de harcèlement scolaire, de moqueries, voire de discrimination. Mais pour la grande majorité des jeunes et de leur famille, ces peurs ne supplantent pas le désir d’avancer dans leur parcours d’affirmation de genre.
Un environnement familial soutenant

Un autre grand enseignement de cette étude est l’importance du soutien familial. Annie Pullen Sansfaçon le souligne: «On voit dans nos données que les familles s’impliquent énormément. Ça se passe rarement sur un coup de tête. Ce sont des décisions réfléchies.»
Plusieurs jeunes racontent à quel point leurs parents sont présents, comme ce garçon trans de 13 ans, au Royaume-Uni: «Chez nous, on peut parler de ce genre de choses librement. Si j’ai une question, je peux la poser, et soit ma mère, soit mon père y répond aussi honnêtement que possible.»
Charles-Antoine Thibeault renchérit: «Les données nous montrent que dans des environnements soutenants, les jeunes n’hésitent pas à parler de leurs peurs, de leurs inquiétudes: peur des procédures, peur de la réaction des autres, peur du retard, ce sont toutes des données qui sont prises en considération par les familles. Ils n’approchent pas ces questions-là avec des œillères en disant «Ça va bien aller». Ils ont préalablement discuté avec leurs parents et avec des spécialistes de la santé.»
Ce soutien familial est d’autant plus précieux qu’il contrebalance les pressions sociales et politiques qui, dans plusieurs pays, menacent de restreindre l’accès aux soins d’affirmation de genre pour les personnes mineures. Toutefois, Annie Pullen Sansfaçon avertit qu’il faut interpréter les résultats de l’étude avec prudence, car elle porte surtout sur des familles déjà disposées à dialoguer: «Il y a un biais de recrutement: ce sont des familles qui sont volontaires pour parler. Elles sont généralement déjà sensibilisées, ce qui n’est pas toujours représentatif de toutes les familles.»
Les chercheuses et chercheurs insistent aussi sur l’impact du contexte culturel et géopolitique. Vivre dans un environnement transphobe peut réduire à néant les effets bénéfiques des soins: «Ce n’est pas parce qu’une ou un jeune reçoit un soin d’affirmation de genre que tout va bien ensuite si la société autour est hostile.»
Mieux comprendre pour mieux accompagner
Pour l’équipe de recherche, ces témoignages rappellent l’urgence de former davantage de professionnels et professionnelles de la santé et de construire un accompagnement respectueux et individualisé. «Ces décisions ne se prennent pas à la légère. Les familles et les jeunes réfléchissent beaucoup, consultent longuement des médecins avant d’avancer. Il faut leur offrir l’espace et les informations nécessaires pour dialoguer sereinement plutôt que de restreindre l’accès aux soins», conclut Annie Pullen Sansfaçon.