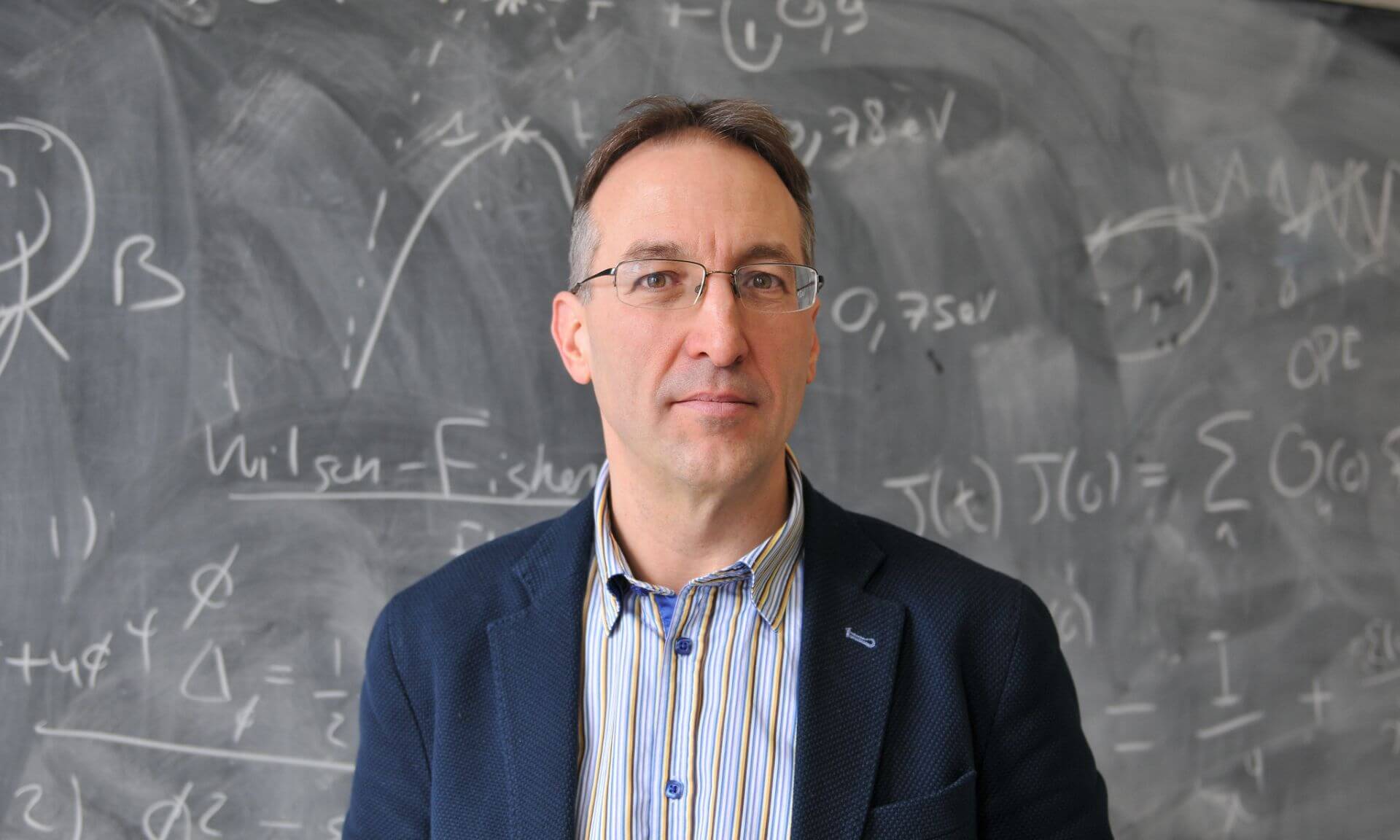Les conséquences de cette tendance sur le réseau électrique seront considérables, selon les chercheurs.
Leurs projections indiquent que la demande d’électricité pour les véhicules électriques passerait de 0,24 térawattheure (TWh) en 2021 à 29,03 TWh en 2040, dans un scénario où l'alourdissement des véhicules se poursuit au rythme actuel.
Pour mettre ces chiffres en perspective, cela représente environ 13,6 % de la demande totale d'électricité enregistrée au Québec en 2019. D'ici 2030, alors que le gouvernement vise deux millions de véhicules électriques sur les routes, la consommation atteindrait 7,68 TWh, ce qui concorde avec les estimations d'Hydro-Québec de 7,8 TWh pour 2032.
Mais c'est surtout l'hiver québécois qui pose un défi de taille. Normand Mousseau insiste sur l'enjeu de la puissance électrique lors des grands froids.
«En contexte hivernal, il faut diminuer la demande en électricité parce qu'elle implique un coût important: lors des périodes de pointe, il en coûte de 150 à 200 $ pour produire chaque kilowatt additionnel, mentionne-t-il. Avec un parc entièrement électrifié en 2040, la puissance moyenne nécessaire pour une journée à -20 °C atteindrait 5261 mégawatts (MW) de plus, soit 12,1 % de la pointe hivernale enregistrée en 2022.»
«Si l’on augmente la pointe d’un gigawatt avec un parc automobile électrique qui continue à s’alourdir, on parle de quelques centaines de millions de dollars de plus pour produire cette électricité», ajoute Normand Mousseau.
Cette réalité s'explique par les particularités du climat québécois: les températures froides réduisent l'efficacité des batteries, augmentent la friction des pneus et accroissent la densité de l'air, autant de facteurs qui font grimper la consommation. À titre d’exemple, en janvier, avec une température moyenne de -10,3 °C, la consommation mensuelle d’électricité du parc automobile grimperait à 3,1 TWh, comparativement à seulement 1,9 TWh en août. À -20 °C, la puissance nécessaire double pratiquement par rapport à une journée d'été.