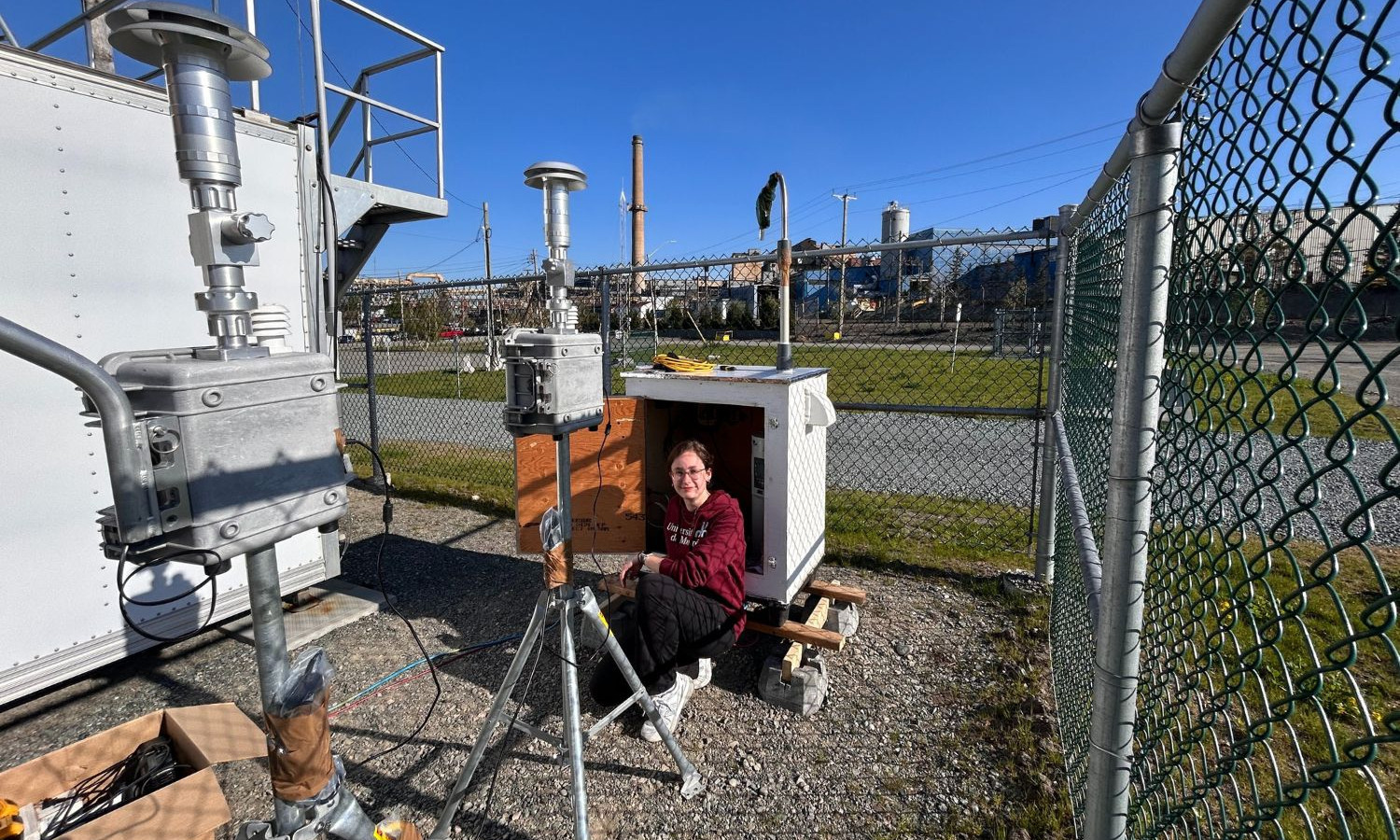Découverte de nouveaux matériaux: passer en quatrième vitesse

Sommes-nous vraiment prêts à faire un virage complet vers les véhicules électriques dans les prochaines décennies? Si l’on connaît bien les défis sociaux et géopolitiques associés aux matériaux contenus dans les batteries, peu de gens se sont penchés sur les électrolytes, alors que le Parlement européen comme plusieurs pays souhaitent que la totalité des véhicules neufs vendus soient électriques d’ici à peine 10 ans.
Le professeur du Département de chimie de l’Université de Montréal Olivier Fontaine et des collègues se sont plongés dans cette réflexion. «Nous nous sommes posé la question de la réalité de cette démarche: avec la technologie actuelle, est-ce une annonce politique ou la chaîne de production peut-elle suivre? Notre conclusion est plutôt alarmante: on n’a pas vraiment de solution viable», affirme-t-il. Leur réflexion vient de paraître dans la revue Nature Communications.
L’électrolyte, le parent pauvre de la recherche et de l’innovation

Une batterie comporte trois compartiments: une électrode positive, une électrode négative et, au centre, l’électrolyte. «C’est ce qui sépare les deux électrodes et qui permet aux ions de circuler et de faire fonctionner la batterie sans qu’elle explose», explique Olivier Fontaine.
Plusieurs équipes de recherche et entreprises se sont attelées à trouver des matériaux plus verts, plus efficaces ou plus locaux pour la fabrication des électrodes. Mais pour l’électrolyte, à peu près rien n’a été fait. «On considère souvent que c’est facile à produire parce que c’est un sel qu’on mélange avec un solvant. Les compagnies achètent des électrolytes liquides de la Chine, mais c’est un peu une boîte noire, on ne se pose quasiment aucune question», déclare-t-il.
Or, pour fabriquer ces électrolytes, nous aurons besoin de ressources minières: du phosphate, du lithium et du fluorure. De beaucoup de ressources. «Cela engendrera d’autres problèmes géopolitiques parce que ces ressources ne sont pas abondantes dans tous les pays», soulève Olivier Fontaine.
Des scénarios
Pour étoffer sa réflexion, l’équipe a envisagé trois scénarios pour estimer les besoins en électrolytes (et donc en minéraux) de chaque pays: le premier simule une électrification complète du parc automobile et les deux autres sont basés sur des prédictions de taux d’adoption des véhicules électriques. Olivier Fontaine et ses collègues ont ensuite examiné la distribution géographique de ces minéraux critiques.
Avec la mise à l’échelle prévue, c’est jusqu’à 1,5 million de tonnes d’électrolytes qui seraient nécessaires. «Imaginer qu’on va pouvoir faire une transition énergétique avec des voitures à 100 % électriques, c’est aller droit dans le mur, en tout cas avec la technologie actuelle», résume le chercheur.
En effet, pour être efficaces, les batteries sont notamment alimentées par de l’hexafluorophosphate de lithium, un sel fluoré à base de lithium et de phosphate. D’une part, le phosphate est utilisé dans une foule de domaines, entre autres en agriculture comme engrais. «À partir du moment où l’on emploie des phosphates pour faire rouler une voiture, ce sont des phosphates qui ne servent pas à fabriquer des engrais ou d’autres types de technologies», note-t-il. C’est sans compter que presque 50 % des réserves de phosphate se trouvent dans un seul pays, soit le Maroc, ce qui est annonciateur de tensions dans la chaîne d’approvisionnement. «On veut une indépendance énergétique pour ne plus avoir un problème de géopolitique avec le pétrole, mais ça en crée d’autres», ajoute-t-il.
De grands changements à envisager
Les auteurs ont par ailleurs examiné les solutions de rechange, soit le recyclage, des électrolytes plus verts ou de nouveaux matériaux. Ainsi, certains composants pourraient être produits avec de la biomasse. Mais comme pour les biocarburants, ces solutions soi-disant vertes ont le grand désavantage de monopoliser des terres agricoles pour faire rouler des véhicules plutôt que pour nourrir des humains. De plus, ces voies issues de la biomasse produisent des électrolytes contenant de l’eau. Or, «les batteries au lithium fonctionnent très bien aujourd’hui parce que l’électrolyte est non aqueux. Si l’on utilise un électrolyte aqueux, la tension des batteries est très diminuée. Les voies un peu plus vertes contiennent par défaut de l’eau; ça plombe toute l’innovation», constate-t-il.
Le recyclage de l’électrolyte dans les batteries en fin de vie est une autre avenue à envisager, même si pour l’instant elle est aussi pavée de difficultés. La plupart des processus de recyclage ne s’intéressent actuellement qu’aux matériaux des électrodes, ignorant complètement l’électrolyte – dont la composition variable rend difficile sa récupération.
La communauté scientifique devra donc accélérer la recherche de solutions de rechange durables aux électrolytes, ce à quoi le chercheur et ses collègues s’attellent d’ailleurs. Et malgré tout, «s’imaginer que, dans 10 ans, on trouve une solution de rechange à l’électrolyte, c’est illusoire», croit-il. Parce que ces nouveaux matériaux doivent être économiques, verts, abondants, efficaces et stables, et leur développement prendra plusieurs années. «Devant des éléments qui sont multidimensionnels, l’intelligence artificielle pourrait aider à répondre à ces questions», espère-t-il.
Mais il faudra également que la société revoie son rapport à la voiture, suggère Olivier Fontaine. «On voit la voiture électrique comme la continuité de la voiture thermique, mais il y a peut-être un autre modèle à imaginer. Les électrolytes plus verts sont moins performants, mais si l'on changeait nos habitudes de consommation de la voiture, ils pourraient avoir un rôle à jouer dans la transition», conclut-il.