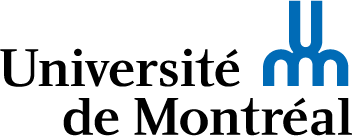L’état des États en temps de pandémie
- Salle de presse
Le 24 mars 2020
- Jeff Heinrich
Comment les nations et les instances internationales gèrent-elles ‒ ou doivent-elles gérer ‒ la crise de la COVID-19? Entretien avec le politologue Frédéric Mérand, directeur du CÉRIUM.
Retour des frontières et du pouvoir de l'État, fin de la mondialisation, rôle accru des organisations internationales et de coopération: le professeur de science politique et directeur du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM), Frédéric Mérand, nous explique les conséquences de la pandémie de coronavirus sur les relations internationales.
Dans le contexte de la COVID-19, êtes-vous d'avis que «l'État est de retour»?
La mondialisation et les nouvelles technologies ont pu nous faire croire que l’État était désuet. À l’ère des chaînes de valeurs globales et des flux de capitaux numérisés, on pensait que l’État ne pouvait plus influencer, encore moins contraindre les marchés. Comme si ce n’était pas assez, les GAFA [Google, Apple, Facebook et Amazon] allaient créer des communautés virtuelles permettant aux individus de s’affranchir de la nation, historiquement attachée à l’État.
En fait, on constate à travers la gestion de la pandémie que l’État demeure le détenteur d’une puissante autorité. Seul l’État peut prendre des mesures de santé publique, stimuler l’économie et dédommager les victimes de la crise. C’est ce que le sociologue français Pierre Bourdieu appelle la «main gauche» de l’État, protectrice, qu’il distingue de la «main droite», celle de la contrainte. Car on voit, à la faveur de la COVID-19, que l’État est aussi la seule institution capable de fermer les frontières ou de confiner les gens à la maison, voire de déployer des forces de sécurité considérables, même lorsque le coût économique est élevé.
En ce printemps 2020, la valeur d’un passeport, qui donne droit à un refuge, au secours public, à un rapatriement, parfois même à des prestations sociales, n’a jamais été aussi grande. Dans les années qui viennent, détenir la citoyenneté d’un État-providence efficace aura une influence encore plus importante qu’avant la crise sur ce que les sociologues nomment les «chances de vie». D’où le repli, inattendu mais inévitable, sur l’État.
Pourquoi les États, dont le Québec, réagissent-ils de manière différente?
Je veux commencer par une mise en garde: à l’heure actuelle, nous n’avons aucune donnée nous permettant de dire avec certitude que certains États ont réagi mieux que d’autres à la pandémie. Les statistiques sont mouvantes et, d’ailleurs, je ne suis ni épidémiologiste ni spécialiste des politiques de santé.
Cela dit, on peut déjà faire quelques observations de nature politique.
Au premier temps de la pandémie, les États ont réagi selon des inclinations politiques assez prévisibles pour les politologues. Sans surprise, le régime communiste chinois a caché la vérité avant de mobiliser des ressources et d’user de tout son pouvoir de coercition. Les États fédéraux, comme le Canada, les États-Unis et l’Allemagne, ont plutôt laissé leurs provinces, leurs États ou leurs Länder agir en ordre dispersé, certains prenant heureusement les devants comme le Québec ou la Bavière. Aux États-Unis et au Brésil, les dirigeants populistes se sont moqués de la science et ont utilisé le coronavirus pour stigmatiser leurs adversaires politiques.
De manière générale, les États «forts» sur le plan administratif, tels que Taiwan et la Corée du Sud, ont semblé mieux préparés à la gestion de crise. Des États jugés plus faibles, comme l’Italie ou l’Iran, ont d’abord eu du mal à prendre les décisions qui s’imposaient ou à convaincre la population de leur importance. Cela augure mal pour une bonne partie des États de la planète, dont le «pouvoir infrastructurel» est plutôt fragile.
Au fur et à mesure que la pandémie se propage à l’échelle de la planète, on observe toutefois une convergence. L’urgence est désormais reconnue partout. C’est même le cas des gouvernements qui, comme ceux de Boris Johnson au Royaume-Uni et de Donald Trump aux États-Unis, ont d’abord donné une impression d’insouciance. Il y a un apprentissage mutuel et collectif.
Jusqu’à maintenant, le gouvernement québécois s’est comporté dans sa communication comme le garant de l’intérêt public, jouissant d’une forte légitimité au sein de la population. C’est la définition la plus positive qu’on puisse donner de l’État. Mais si la légitimité est importante, la capacité d’action l’est tout autant. Or, les systèmes de santé et de protection sociale québécois demeurent modestes par rapport à ceux de pays européens qui, comme la France, paraissent pourtant dépassés par la crise. On peut en déduire que l’État-providence québécois sera soumis à une forte tension au cours des prochains mois.
La montée du populisme dans certains pays freine-t-elle la lutte contre de telles pandémies?
Le populisme est un discours qui oppose le «peuple», incarné par son leader, aux «élites du système», vues comme corrompues ou arrogantes. Par définition, les experts sont mal vus par les populistes, qui préfèrent mettre en valeur le «bon sens» populaire. Puisque le «peuple» est inattaquable, il faut trouver les «corps étrangers» qui menacent de le contaminer. Cela décrit parfaitement la réaction de Donald Trump et de Jair Bolsonaro, qui ont commencé par minimiser la menace, s’en sont moqués même, puis ont blâmé les étrangers (le «virus chinois»).
Pourtant, le débat sur la pandémie étant devenu global, les populistes sont soumis aux mêmes injonctions que les autres dirigeants. Le théâtre politique qu’ils incarnent est confronté au regard comparatif des citoyens qui, apprenant ce qui se passe ailleurs en temps réel, se demandent pourquoi leur pays a un taux de mortalité supérieur à celui du voisin ou pourquoi des mesures d’aide économique existent ailleurs et pas chez eux. Dans un pays démocratique comme les États-Unis, où l’information circule librement, même les populistes finissent par devoir rendre des comptes. Dans la Russie de Vladimir Poutine, c’est moins sûr.
Entre parenthèses, en appliquant avec célérité les consignes des experts, sans stigmatiser personne, le premier ministre François Legault a démontré qu’il n’était pas le populiste que certains dénonçaient.
En ce qui concerne l'économie, assiste-t-on à la fin de la mondialisation par voie de pandémie?
La fin, je ne sais pas, mais un sérieux coup d’arrêt, oui. Plus rapidement qu’on l’aurait cru, les frontières se referment. Elles le resteront un certain temps, y compris entre le Canada et les États-Unis ainsi qu’en Europe, où la libre circulation des personnes était pourtant considérée comme un acquis.
Bien sûr, les sans-papiers, les ressortissants de pays pauvres, les apatrides et les demandeurs d’asile connaissent cette expérience de l’enfermement sur un territoire. Ce sont les gens d’affaires, les touristes, les travailleurs temporaires, les frontaliers, les familles binationales, les étudiants, les chercheurs qui sont frappés par une réalité nouvelle.
Il est possible qu’une forme de démondialisation se produise au cours de la prochaine décennie. Elle se traduirait par le rapatriement de certains secteurs d’activité plus près des lieux de consommation, la diminution des voyages d’affaires et de tourisme, la chute du nombre d’étudiants étrangers, peut-être même des restrictions supplémentaires à l’immigration. Les «vecteurs humains de la mondialisation» auront tout simplement plus de mal à traverser les frontières.
En même temps, la dématérialisation de l’économie pourrait contrarier ce mouvement de démondialisation. Jamais, au printemps 2020, n’aura-t-on autant utilisé Amazon, Facebook et Netflix. Il est possible que la prochaine vague de mondialisation se vive dans notre salon, grâce au télétravail, à la consommation de produits culturels en ligne, à l’éducation à distance, qui, la diffusion de l’anglais aidant, favoriseront la mise en place d’un marché virtuel global.
Selon vous, où serons-nous dans cinq ans avec le «nouvel ordre mondial»?
Sur le plan géopolitique, je ne suis pas certain que la pandémie transformera les tendances actuelles en profondeur. Avant la COVID-19, nous étions dans un monde où la Chine prenait de l’assurance, l’Europe poursuivait sa lente marginalisation et l’avenir des États-Unis faisait le miel des théoriciens des relations internationales: allaient-ils céder le pas à la Chine ou demeurer la principale puissance économique, militaire et culturelle de la planète?
D’ici cinq ans, on verra si la Chine a réussi à vendre son modèle à un plus grand nombre de pays qui seront dès lors devenus des alliés. Beijing perfectionne un récit dans lequel son régime autoritaire est la meilleure solution aux pandémies. Il trouvera preneur.
La question la plus épineuse, à mon avis, est de savoir comment les États-Unis vont gérer leur déclin relatif, qui semble inévitable. Vont-ils «aplanir» cette transition en privilégiant la coopération internationale, y compris avec la Chine et l’Europe, afin d’éviter une démondialisation désordonnée ou plutôt aggraver les choses en adoptant une posture de repli agressif qui signerait le début d’une période de fortes tensions?
Frédéric Mérand publiera bientôt un ouvrage intitulé Coping with Geopolitical Decline: The United States in European Perspective (McGill-Queen’s University Press).