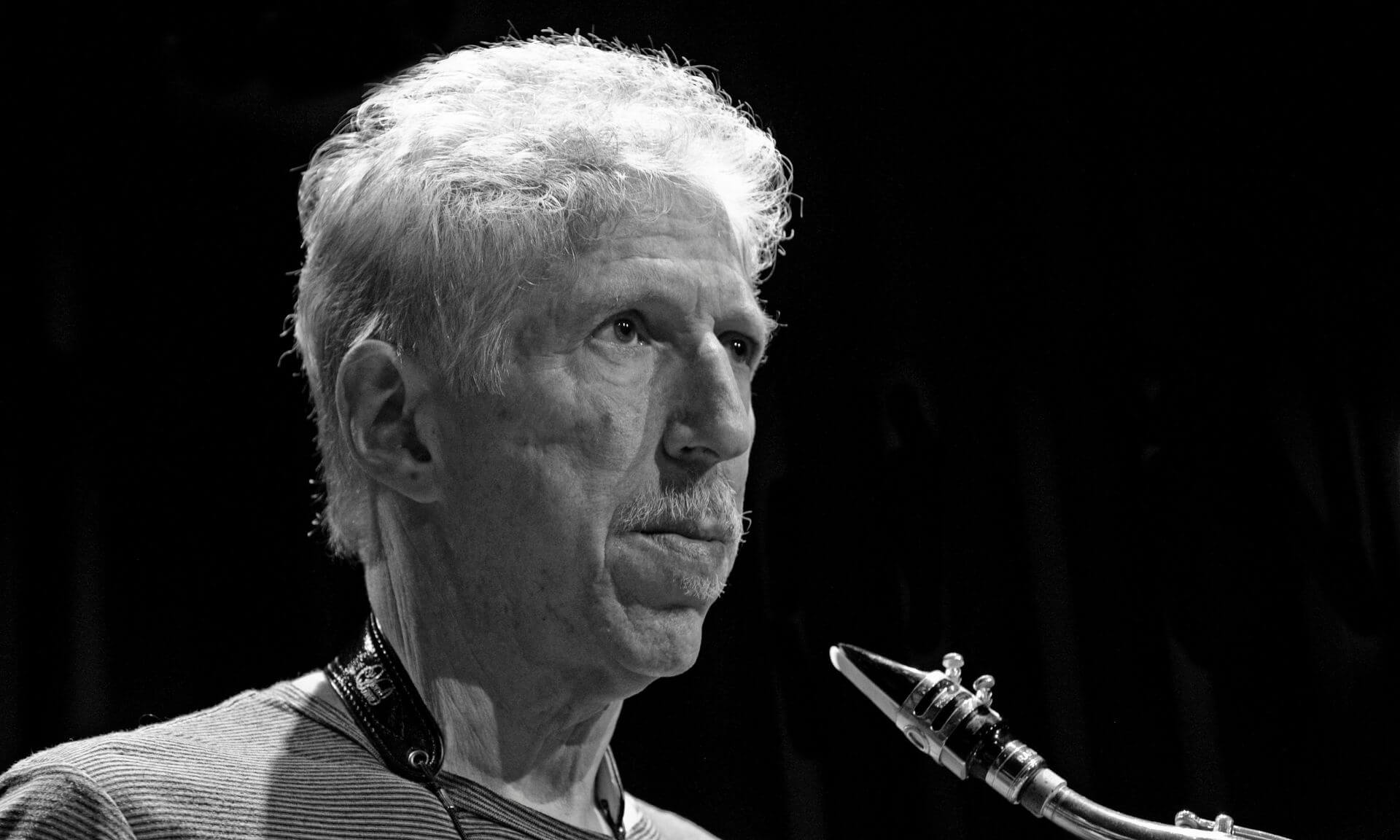Judith Lussier: au-delà de la culture du bannissement

Judith Lussier est ravie de voir que le recteur Daniel Jutras a lu son dernier livre, en témoignent les languettes adhésives collées aux pages. «Vous avez marqué les passages sur les universités!» s’exclame-t-elle. Annulé(e): réflexions sur la cancel culture est le septième essai de la diplômée du baccalauréat en communication et politique. Elle y décortique le phénomène de la culture du bannissement en revisitant plusieurs cas qui ont défrayé la chronique comme l’affaire Maripier Morin ou l’utilisation en classe du «mot en n».
Daniel Jutras: J’ai dévoré le livre en deux jours. Il est empreint de beaucoup de sagesse. On sent que votre réflexion à l’arrivée n’est pas la même que celle que vous aviez au départ. Qu’est-ce qui a changé chez vous en cours d’écriture?
Judith Lussier: Avant d’entreprendre ce projet, les médias me sollicitaient déjà sur la culture du bannissement et je trouvais que mes idées à ce propos étaient plutôt arrêtées. La rédaction d’un livre est l’occasion de prendre le temps de réfléchir et d’apporter des nuances. L’une des conclusions que je tire est que critiquer à plusieurs sur les réseaux sociaux un individu qui a commis une faute n’est peut-être pas la façon la plus productive d’améliorer la société. On devrait travailler à changer la culture sous-jacente aux comportements qu’on dénonce. En ciblant, par exemple, la recrue du Canadien de Montréal Logan Mailloux, qui a été accusé d’avoir partagé des photos de sa copine sans son consentement, on évacue le problème qui est à la source de son geste. Si Logan Mailloux avait senti que les photos allaient être perçues de manière négative par son groupe d’amis, il ne les aurait jamais envoyées.
DJ: Je m’inquiète de l’effet «chambre d’échos» des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et l’université représentent deux territoires vraiment contrastés. Le premier crée des silos pour les idées, il favorise les réactions émotives et spontanées. Le second propose de s’ouvrir à différentes réalités au risque de se cogner et de se faire mal – mais tout le monde en sort grandi.
JL: Les conflits en milieu universitaire sont présentés dans les médias comme un problème, alors que c’est dans la nature même de l’université de susciter des débats! On ne pourra jamais se priver de l’université, ne serait-ce que parce que les idées progressistes qui circulent sur les réseaux sociaux viennent souvent de personnes qui la fréquentent. Ces idées sont peut-être présentées de façon superficielle, mais elles touchent à des enjeux importants. Les mouvements #MeToo et Black Lives Matter sont nés d’expériences et de savoirs partagés sur les réseaux sociaux.
DJ: Vous vous définissez comme féministe. À presque 40 ans, comment voyez-vous votre évolution à cet égard?
JL: Ma mère a élevé seule trois enfants en faisant deux maîtrises et un doctorat. Je l’ai vue se battre contre sa propriétaire à la Régie du logement et contre ses patrons. J’ai grandi avec l’idée que tout est possible, mais je ne réalisais pas que, si elle n’avait pas été une femme, ma mère n’aurait peut-être pas eu tous ces combats à mener. Nous étions alors dans une sorte de mouvement incarné par le slogan Girl Power et nullement dans une remise en question des dynamiques de pouvoir. Avec les années 2010 sont apparus des enjeux de violence sexuelle qui ont fait réfléchir les membres de ma génération. Nous avons pu adhérer à la cause du féminisme, qui avait été mise de côté par des années de dénigrement.
DJ: On vous connaît comme journaliste, animatrice, essayiste et activiste. Comment réussissez-vous à combiner ces rôles, alors que le journalisme demande une certaine objectivité?
JL: Je ne me définis pas comme activiste. Je n’organise pas de manifestations, je ne lance pas de pétitions. Il est vrai que mon travail est teinté par mes préoccupations sociales – et j’aurais tendance à dire qu’il en manque, des préoccupations sociales, chez certains de mes collègues journalistes. J’estime que la liberté est le point d’ancrage de tout ce que je fais. Je suis devenue journaliste indépendante dès la fin de mes études. J’ai tellement aimé ma liberté d’étudiante que j’ai poursuivi ce mode de vie jusqu’à aujourd’hui!
«Les conflits en milieu universitaire sont présentés comme un problème, alors que c’est dans la nature même de l’université de susciter des débats!»