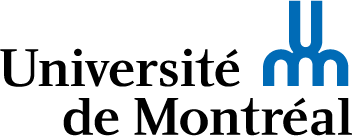La Galerie de l’UdeM présente deux expositions sur les effets du colonialisme
- UdeMNouvelles
Le 5 décembre 2024
- Virginie Soffer
Les expositions «Formes infinies» et «Le catalogue de traductions spéculatives, acte II: Fugitivités» sont présentées à la Galerie de l’Université de Montréal jusqu’au 1er mars prochain.
Deux nouvelles expositions multimédias sur le colonialisme sont à découvrir à la Galerie de l’Université de Montréal jusqu’au 1er mars 2025.
La première, Formes infinies / Iah Tshiewató:ktha tsi Nikaieron’tó:tens / Infinite Forms, réunit quatre artistes autochtones qui, à travers peintures, tapisseries, photographies, écrits et installations, se questionnent sur les interactions passées et actuelles entre les peuples autochtones et les Européens. Cette exposition, soutenue par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère de l’Enseignement supérieur et le Vice-rectorat à la planification et à la communication stratégiques de l’Université de Montréal, est présentée pour la première fois en trois langues, soit en français, en anglais et en mohawk.
La seconde, Le catalogue de traductions spéculatives, acte II: Fugitivités, est le fruit d’un travail de recherche-création de Cosmo Whyte, artiste et professeur adjoint à la faculté des arts et de l’architecture de l’Université de Californie à Los Angeles, et Abigail E. Celis, professeure adjointe en histoire de l’art et muséologie à l’UdeM. Soutenue par la Fondation Camargo, la Chaire de recherche du Canada en muséologie citoyenne de l’UdeM, le Conseil de recherches en sciences humaines et la Fabrique des écritures ethnographiques du Centre Norbert Élias, cette installation multimédia pose un regard critique sur l’exposition d’objets africains dans les musées français.
«Formes infinies»
Dans la salle principale, quatre artistes autochtones: David Garneau (métis), Martin Akwiranoron Loft (Kanien’keha:ka), Michelle Sound (crie et métisse) et Alexis Gros-Louis (wendat), rendent compte des interactions entre les cultures occidentales et celles des Premiers Peuples. Chaque artiste se réapproprie les techniques et les codes visuels traditionnellement utilisés par les culturelles euro-occidentales. Ainsi, dans Raw Harvest, David Garneau revisite la tradition de la nature morte en y ajoutant des plantes indigènes du Canada comme le maïs. Martin Akwiranoron Loft choisit quant à lui la photographie pour présenter différents portraits de personnes autochtones. Et dans Every photo of her mother, Michelle Sound utilise des cyanotypes, procédé photographique généralement employé par les Occidentaux comme la botaniste Anna Atkins, et les présente sur des tambours en cercle avec des portraits de famille et des plantes médicinales et locales. Chacun réimprime sa propre histoire, tout comme Alexis Gros-Louis, qui grave sur du plâtre des modèles de poterie traditionnelle wendate.
Les artistes s’interrogent également sur la nature des liens tissés entre les différentes cultures. Par exemple, une immense tapisserie d’Alexis Gros-Louis «est basée sur cet antependium, un élément décoratif utilisé dans une église pour orner un autel, qui fut tissé par des religieuses et le peuple wendat au 18e siècle. La pièce exposée aujourd’hui à la Galerie de l’UdeM a, quant à elle, été produite aux Pays-Bas sur un métier à tisser jacquard informatisé. C'est une autre étape d’un détournement de la production d’un artéfact d’un objet wendat fabriqué aux Pays-Bas», explique le commissaire Michael Patten.
«Le catalogue de traductions spéculatives, acte II: Fugitivités»
Dans une deuxième salle obscure, les artistes Cosmo Whyte et Abigail E. Celis nous invitent à poser un autre regard sur les objets africains soustraits à leur culture d’origine pour être exposés dans les musées français. «J’ai été stupéfaite de découvrir que le bâtiment qui abrite le Musée d’arts africains, océaniens, amérindiens de Marseille a servi au début du 20e siècle de caserne et de centre de transit pour les troupes coloniales françaises. J’ai alors pensé à ces personnes des colonies qui ont été enrôlées pour servir les intérêts de la France et, 50 ans plus tard, vous trouvez des objets en provenance de ces mêmes régions qui deviennent à leur tour enrôlées pour raconter une histoire à la gloire de la France et de ses valeurs universelles dans ce même lieu», se remémore Abigail E. Celis, commissaire et collaboratrice.
En résidence avec Cosmo Whyte dans ce musée, elle l’a alors exploré et collecté des images et des fichiers audio. Les deux artistes se sont d’abord concentrés sur la manière la plus adéquate de traduire ses expériences visuelles, matérielles, textuelles et émotionnelles. Puis, ils se sont particulièrement intéressés à la question de la fugitivité. «Comment pouvons-nous imaginer un chemin d'évasion symbolique pour ces objets?» s’est demandé Abigail E. Celis. En jouant notamment sur le flou, sur les éclairages et les ombres projetés, les artistes proposent de revoir les objets conservés et leur histoire sous une tout autre perspective. Au lieu de rendre plus visible ce qui a été effacé, ils ajoutent des zones d’ombre, tels ces rideaux faits de perles sombres qui viennent recouvrir partiellement une projection.
Les artistes se questionnent en outre sur l’histoire de l’art occidentale traditionnellement présentée dans les musées et la façon dont les archives servent à écrire l’histoire. Ainsi, un meuble destiné à contenir des fiches d’archives est rempli de questions des artistes et de citations extraites d’ouvrages tel Dear Science and Other Stories, de Katherine McKittrick: «By observing how arranging, rearranging and collecting ideas outside ourselves are processes that make ideas our own, I think about how ideas are bound up in stories, research, inquiries, that we do not (or should not claim) own.» (En observant comment l’agencement, le réagencement et la collecte d’idées en dehors de nous-mêmes sont des processus qui nous permettent de nous approprier les idées, je réfléchis à la manière dont les idées sont liées à des histoires, des recherches, des enquêtes, dont nous ne sommes pas (ou ne devrions pas prétendre être) propriétaires.) À notre tour de nous interroger.
Informations pratiques
Galerie de l’Université de Montréal
2940, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Pavillon de la Faculté de l’aménagement, salle 0056
Horaire
Du mardi au samedi, de 10 h à 17 h
Le jeudi, de 10 h à 19 h
Du 29 novembre 2024 au 1er mars 2025
Activités spéciales
- Une visite guidée en français de l’exposition Le catalogue de traductions spéculatives, acte II: Fugitivités aura lieu le 16 janvier à 17 h 30 avec la commissaire, Abigail E. Celis.
- Un atelier de perlage sera donné le 30 janvier à 17 h par l’artiste innue Carole Bérubé-Therrien.
- Autres activités: galerie.umontreal.ca/activites.php