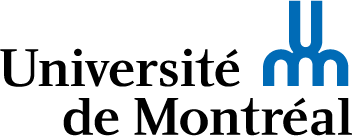Les propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires du miel sous la loupe de Simon Matoori
- UdeMNouvelles
Le 8 avril 2025
- Martin LaSalle
Le professeur de pharmacie Simon Matoori, de l’Université de Montréal, a passé en revue les études sur les propriétés thérapeutiques du miel pour traiter les plaies aigües ou chroniques.
Il était une fois un remède millénaire, utilisé depuis l'Égypte antique, auquel les médecins ont encore recours aujourd’hui – bien que sous une forme différente de l’époque des pharaons – pour traiter certaines plaies vives ou des plaies chroniques.
Ce remède ancestral, c’est le miel.
Et le professeur Simon Matoori, de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, s’y est récemment intéressé en réalisant une revue de la littérature sur les propriétés antiseptiques et à la fois anti- et pro-inflammatoires (ou immunomodulatoires) du miel utilisé à des fins médicales. Les résultats de sa recherche ont été publiés récemment dans la revue Advanced Therapeutics.
L’idée d’explorer les vertus médicinales du nectar fabriqué par les abeilles découle de «la montée des résistances aux antibiotiques qui nous oblige à trouver d’autres solutions thérapeutiques efficaces», explique le chercheur spécialisé en bio-ingénierie.
Un miel pas comme les autres
Le miel utilisé en milieu hospitalier n'a rien à voir avec celui qu'on trouve sur les tablettes d'épicerie. Le «miel de grade médical» qui était dans la mire de Simon Matoori doit répondre à des normes strictes: provenir de sources biologiques certifiées, être exempt de tout contaminant et avoir subi une stérilisation aux rayons gamma pour éliminer les microorganismes potentiellement dangereux, notamment les spores de Clostridium botulinum.
L'un des types de miel de grade médical les plus couramment employés est le miel de manuka, produit en Nouvelle-Zélande et en Australie. «Ce miel est fabriqué par le butinage des feuilles de l’arbre à thé – le Leptospermum scoparium – et contient des concentrations élevées de méthylglyoxal, un composé aux propriétés antimicrobiennes remarquables», précise Simon Matoori.
Les recherches qu’il a scrutées montrent que le miel de grade médical agit de plusieurs façons sur les plaies: son acidité naturelle et sa forte concentration en sucre créent un environnement hostile aux bactéries et, plus surprenant encore, il peut avoir des effets soit anti-inflammatoires, soit pro-inflammatoires, selon l'état de la plaie.
«C'est fascinant de voir comment le miel interagit avec le microenvironnement de la plaie, souligne le chercheur. Dans une plaie très enflammée, il agit de façon anti-inflammatoire, tandis que, dans une plaie chronique peu active, il peut entraîner une réaction inflammatoire bénéfique qui contribue à la guérison.»
Des résultats prometteurs, mais nuancés
Actuellement, plus de 20 produits à base de miel médical sont homologués par la Food and Drug Administration aux États-Unis. Au Canada, certains médecins utilisent déjà le miel de grade médical dans leur pratique: les études cliniques font état de résultats particulièrement encourageants pour le traitement de divers types de plaies, dont les ulcères du pied diabétique, les ulcères de jambe, les brûlures de premier et de deuxième degré, les escarres, les plaies du site donneur, les plaies traumatiques et les plaies chirurgicales.
Cependant, le professeur Matoori reste prudent.
«Les résultats des études sont parfois contradictoires, principalement en raison d'un manque de standardisation dans les méthodologies de recherche, indique-t-il. Nous avons besoin d'études plus rigoureuses, avec des protocoles uniformisés concernant le type de miel utilisé, le dosage et les groupes de patients.»
La mise au jour des molécules actives du miel, dont le méthylglyoxal, ouvre la voie à de nouvelles perspectives. «En comprenant précisément quels composants sont responsables des effets thérapeutiques, nous pourrons mettre au point des pansements standardisés plus efficaces», explique le chercheur.
Cette approche permettrait de résoudre l'un des principaux défis actuels: la variabilité naturelle du miel, qui complique son utilisation en contexte médical. Les chercheurs travaillent désormais à l'élaboration de produits dits bio-inspirés qui conserveraient les propriétés bénéfiques du miel tout en garantissant une composition stable et standardisée pour en fabriquer à grande échelle.
Le professeur Matoori prévoit étendre ses recherches au domaine vétérinaire, notamment pour les animaux d'élevage, dans une perspective plus large de lutte contre la résistance aux antibiotiques.
À propos de cette étude
L’article «Bee Better: The Role of Honey in Modern Wound Care», par Simon Matoori, Benjamin Freedman et Léo-Paul Tricou, a été publié dans la revue Advanced Therapeutics.