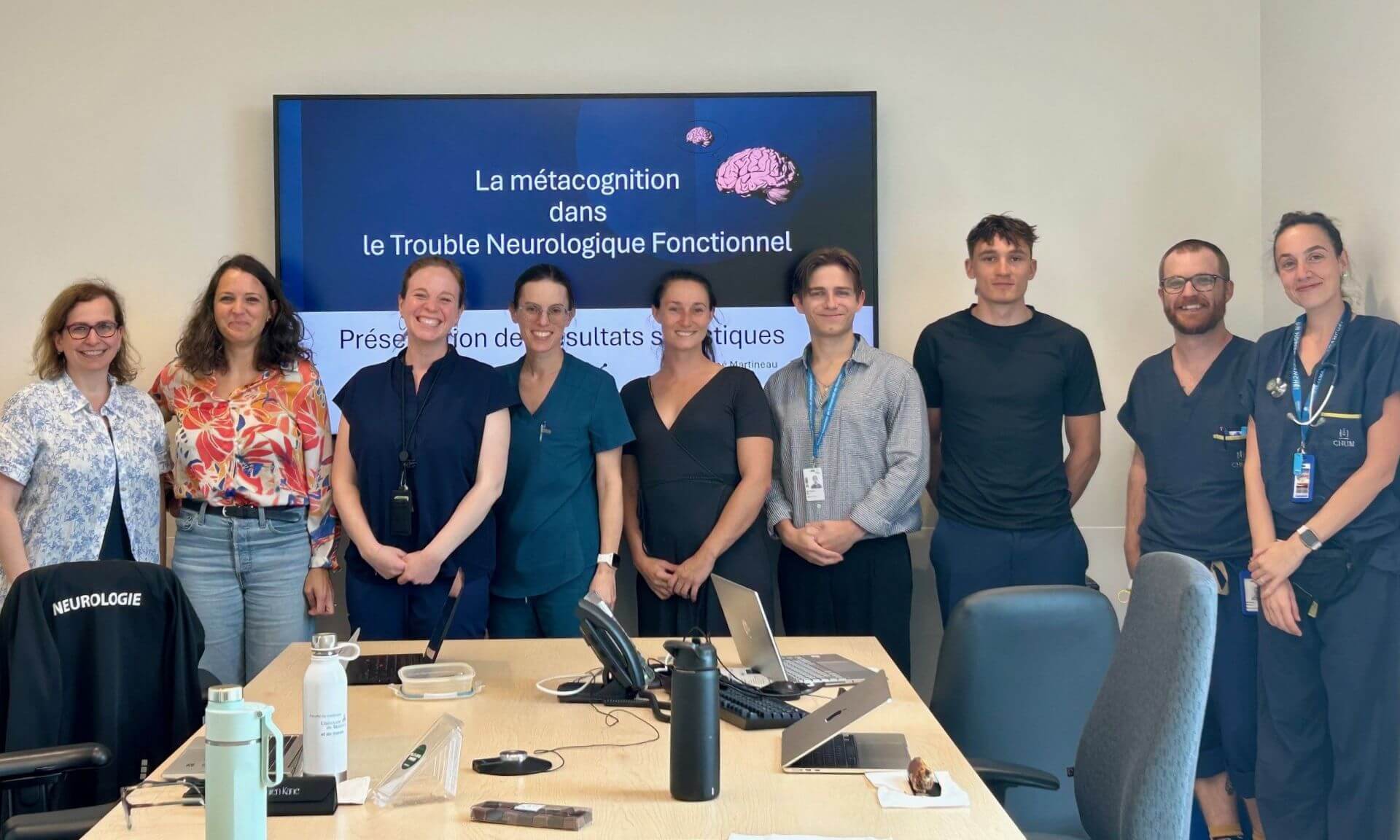Des impacts jusqu’à la structure du cerveau des enfants atteints de troubles alimentaires

Les troubles alimentaires restrictifs à développement précoce, tels que l’anorexie mentale et le trouble d’alimentation sélective ou d’évitement (TASE), pourraient être associés à des modifications structurelles du cerveau chez les enfants atteints, révèle une nouvelle étude publiée dans Nature Mental Health et dirigée par Clara Moreau, chercheuse au Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine et professeure adjointe à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.
Qu’est-ce que le trouble d’alimentation sélective et/ou d’évitement?

Mieux connu sous son acronyme anglais ARFID («avoidant/restrictive food intake disorder»), le TASE consiste à limiter la prise d’aliments ou à ne manger que certains types d’aliments, mais sans désir de perdre du poids et en l’absence d’une image corporelle déformée. Il apparaît généralement durant la petite enfance et serait le résultat d’une perte d’intérêt envers la nourriture, d’une hypersensibilité sensorielle incitant à éviter certaines textures ou certains goûts, ou encore d’une crainte des conséquences de s’alimenter (p. ex. vomir, s’étouffer).
Grâce à des analyses d’images cérébrales obtenues par résonance magnétique (IRM) d’enfants âgés de 7 à 13 ans souffrant d’anorexie mentale ou d’un TASE sévère, l’équipe de chercheuses et chercheurs a mis en évidence des altérations cérébrales majeures, spécifiques à chacun de ces deux troubles alimentaires. Si une partie de ces changements est attribuable à la perte de poids, en particulier à cette période cruciale du développement cérébral, l’étude montre également des effets propres à la maladie. Bonne nouvelle : les données recueillies à différents stades de la prise en charge suggèrent que ces altérations seraient au moins en partie réversibles.
Il s’agit de la première étude à documenter l’impact du TASE sur la morphométrie cérébrale, et de l’une des rares à évaluer celui de l’anorexie mentale à développement précoce, une forme moins fréquente de ce trouble qui apparaît avant la puberté.
Un impact au-delà de la perte de poids
En comparant les cerveaux d’enfants atteints d’anorexie mentale à ceux d’enfants vivant avec un TASE, Clara Moreau démontre que l’impact de ces deux troubles n’est pas seulement lié à la maigreur. En effet, bien que tous les enfants de l’étude qui étaient atteints d’un trouble alimentaire aient eu un indice de masse corporelle (IMC) faible (< 16), les altérations cérébrales différaient nettement entre les deux groupes. «Chez les enfants anorexiques, nous avons observé un amincissement important et généralisé du cortex cérébral, explique la chercheuse principale. Ce phénomène avait récemment été documenté chez les populations adolescentes et adultes souffrant d’anorexie, ce qui suggère un impact significatif sur le cerveau, quel que soit l’âge au moment du diagnostic.» Environ la moitié de cet effet serait attribuable à la perte de poids rapide.
À l’inverse, chez les enfants atteints d’un TASE, l’épaisseur du cortex cérébral demeure intacte, mais on observe une diminution du volume intracrânien et de la matière grise. Malgré un IMC similaire, ces altérations ne seraient pas liées à la maigreur chez ces enfants. «Le TASE débute souvent plus tôt et de manière plus progressive que l’anorexie; il est possible que le cerveau et le métabolisme arrivent à s’adapter à la restriction alimentaire, ce qui pourrait expliquer l’absence d’effet sur l’épaisseur du cortex chez ces enfants», avance la chercheuse.
Soutenir la récupération cérébrale pour prévenir les rechutes
L’étude montre également que le cerveau peut se rétablir avec la prise de poids. En comparant les enfants selon leur stade de rétablissement, les scientifiques ont noté que les différences structurelles tendent à s’atténuer à mesure que l’IMC augmente. «C’est très encourageant, car cela suggère qu’une récupération complète est possible lorsque le rétablissement survient en jeune âge et que le nombre de rechutes est limité.»
Pour mieux comprendre l’évolution des fonctions cérébrales au fil du rétablissement, Clara Moreau et son équipe poursuivront leurs travaux dans une perspective longitudinale en y intégrant l’imagerie cérébrale fonctionnelle. La professeure compte mettre sur pied une cohorte d’enfants suivis à la clinique des troubles alimentaires du CHU Sainte-Justine et tirer parti des équipements à la fine pointe du Centre IMAGINE de ce même établissement. «On sait qu’environ un tiers des jeunes hospitalisés pour anorexie mentale rechutent dans l’année suivant leur congé. Est-ce que cela pourrait être lié à une récupération cérébrale incomplète? Et si oui, pourrions-nous prédire le risque de rechute afin de mieux soutenir les jeunes les plus vulnérables?»