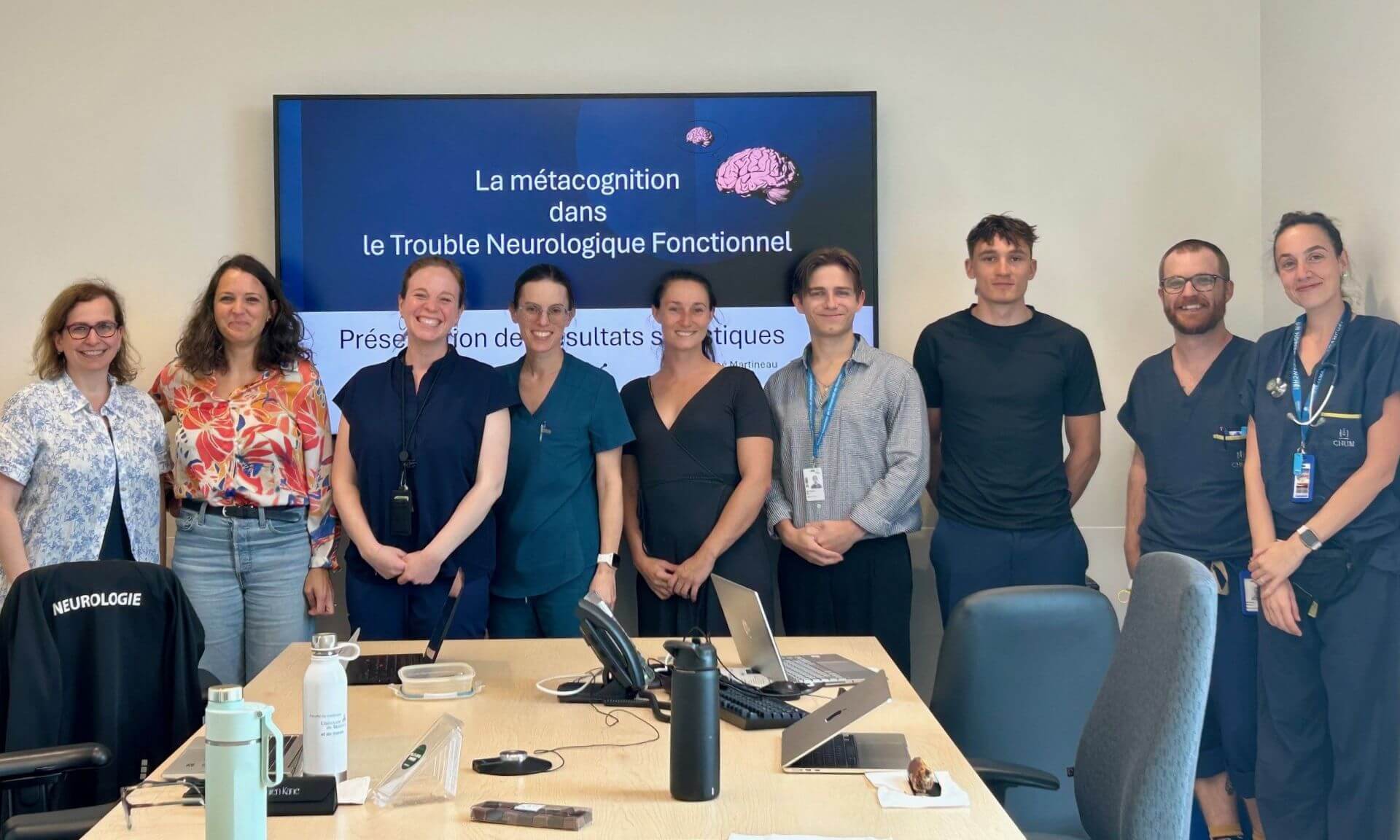Une équipe de recherche internationale dirigée par le professeur Shady Rahayel, de l'Université de Montréal, vient de franchir une étape majeure dans la prédiction de maladies neurodégénératives. Grâce à deux études distinctes mais complémentaires, les scientifiques peuvent maintenant distinguer, des années à l'avance, quelles personnes atteintes d'un trouble du sommeil particulier souffriront de la maladie de Parkinson ou de la démence à corps de Lewy.
Ces découvertes concernent le trouble du comportement en sommeil paradoxal isolé, où les personnes crient, se débattent ou rêvent tout haut pendant leur sommeil, parfois au point de blesser leur partenaire. «Ce n'est pas simplement un sommeil agité, c'est un signal d'alerte neurologique», explique le neuropsychologue Shady Rahayel, professeur à la Faculté de médecine de l'UdeM et chercheur au Centre d’études avancées en médecine du sommeil de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal.
Environ 90 % des personnes atteintes de ce trouble du sommeil développeront, au fil des ans, la maladie de Parkinson ou une démence à corps de Lewy. Mais jusqu'à présent, il était impossible de savoir quelle maladie allait se déclarer ni quand.