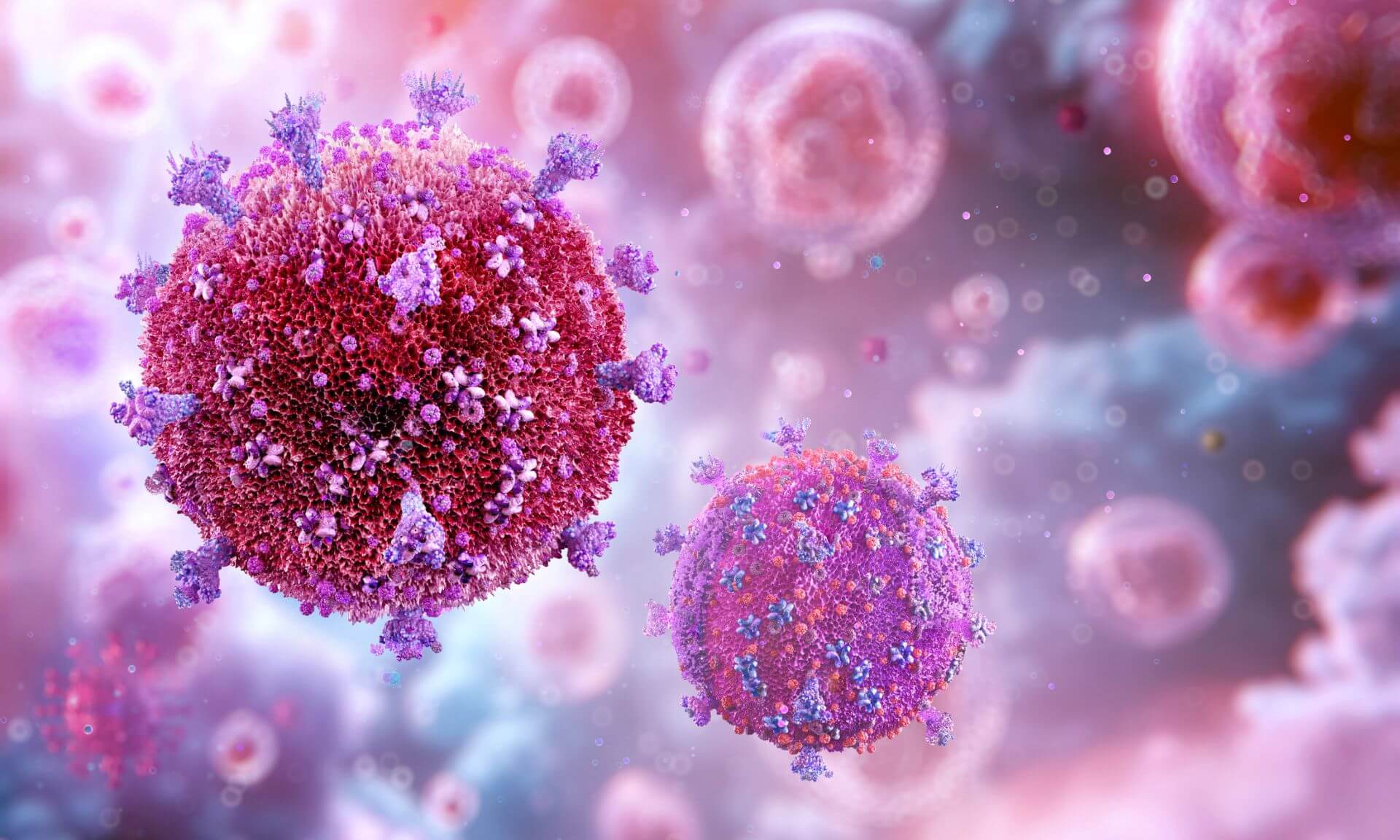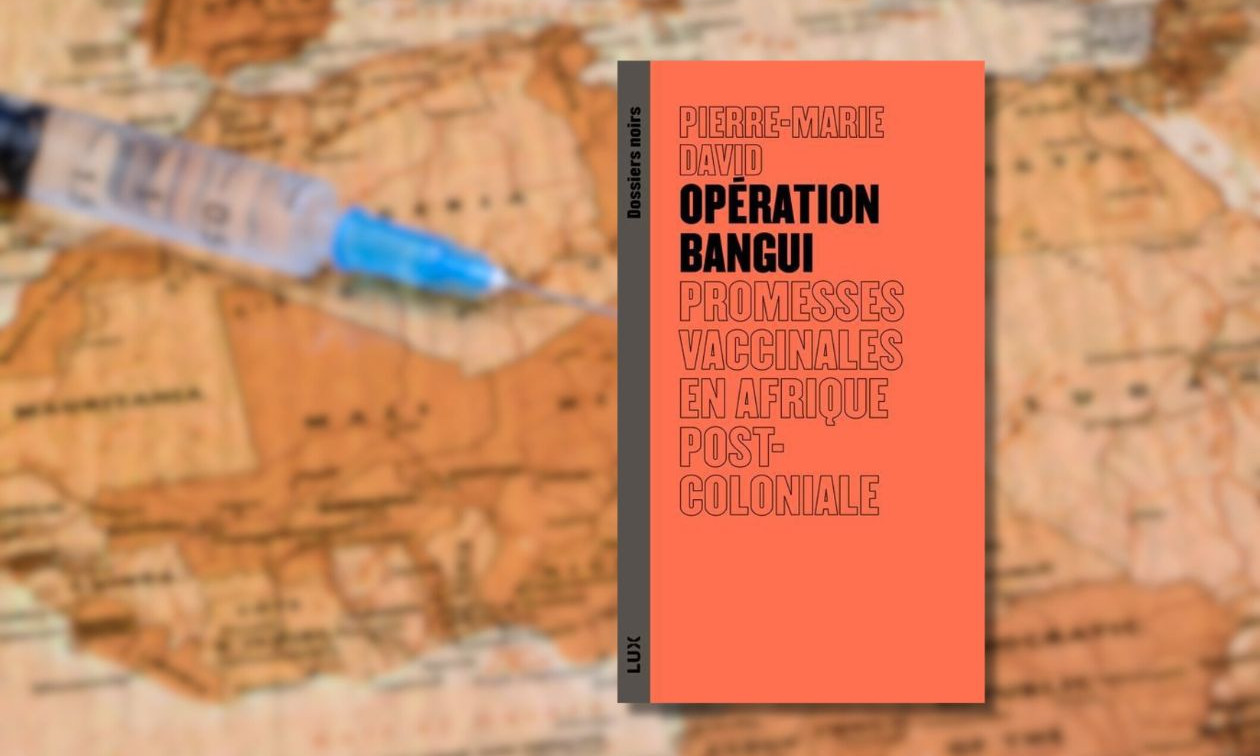Depuis leur étude publiée en 2023, les deux scientifiques et Mehdi Benlarbi, doctorant dans le laboratoire d’Andrés Finzi, s’intéressent à une molécule en jeu dans le VIH: la gp120. Cette protéine, utilisée par le virus pour infecter les cellules CD4 responsables d’activer la défense immunitaire, semble jouer un rôle plus sournois.
Même lorsque la charge virale est indétectable, la molécule gp120 circule dans le sang d’une personne infectée sur trois et agit comme une toxine virale. Elle se fixe à des cellules saines, les ciblant pour se faire éliminer par le système immunitaire, qui détruit ainsi ses propres défenses.
Dans l’étude diffusée en août 2025 dans eBioMedicine, l’équipe scientifique montre que certains anticorps non neutralisants aggravent cette situation en attaquant ces cellules CD4 non infectées rendues vulnérables par l’action de la molécule gp120.
«Cette forme de sabotage immunitaire s’accompagne d’une baisse du nombre de cellules CD4 et nuit directement à la capacité du système immunitaire des personnes vivant avec le VIH à combattre le virus, explique Andrés Finzi. À l’inverse, nous montrons que d’autres anticorps plus rares – les anti-CD4BS – bloquent l’ancrage de la molécule gp120 à la surface des cellules CD4 saines et les protègent.»
Cette découverte a pu être réalisée grâce à des échantillons de la cohorte canadienne CHACS (Canadian HIV and Aging Cohort Study), dirigée par la Dre Durand. Cette cohorte regroupe 850 personnes infectées par le VIH et 250 sujets témoins.
«Seulement 15 % des gens qui vivent avec le VIH possèdent ce type de “bons” anticorps dans leur plasma, en plus des “mauvais” anticorps qui se débarrassent des cellules saines», dit la Dre Durand, professeure adjointe à l’Université de Montréal.