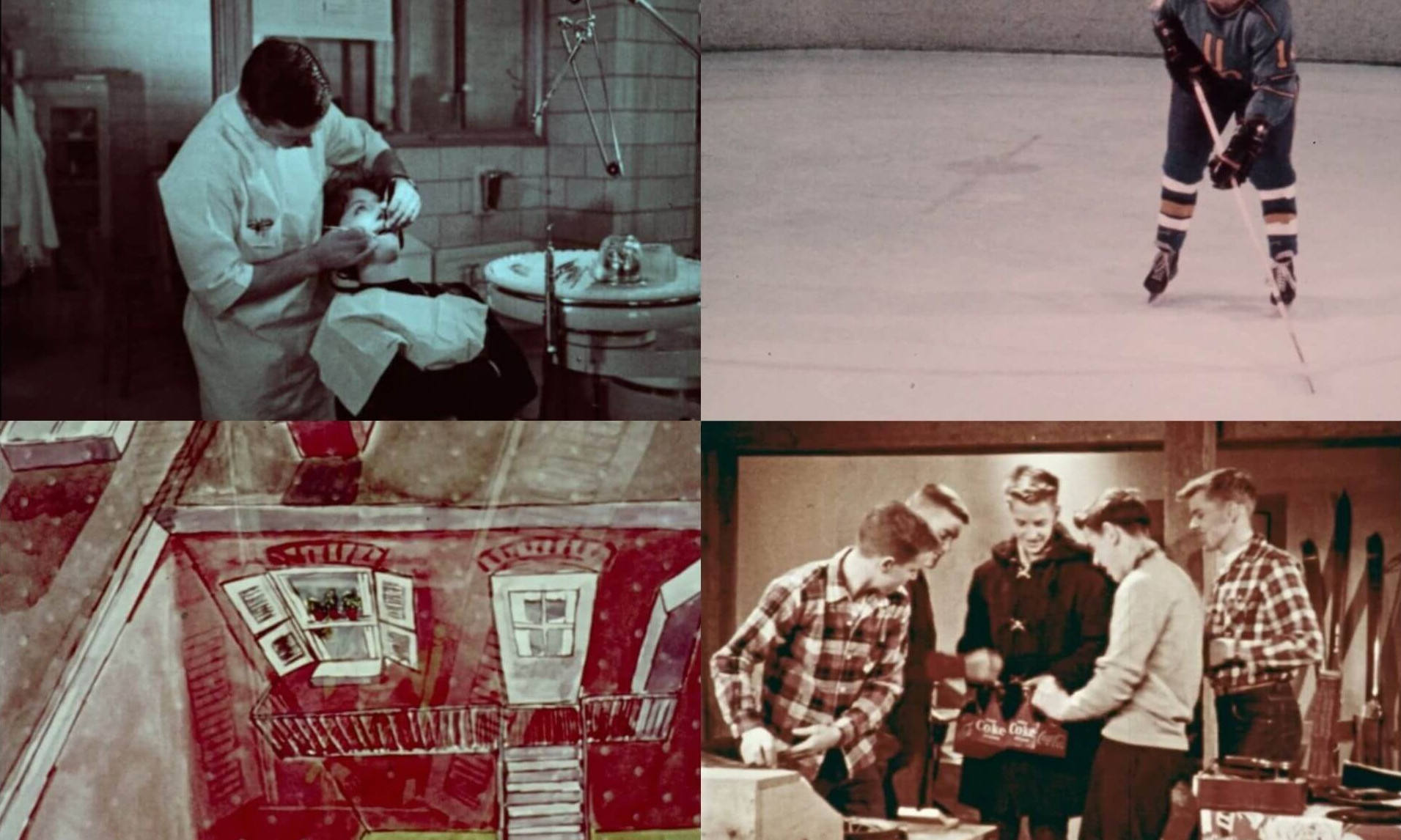Le film Soleils Atikamekw, de la cinéaste Chloé Leriche, revient sur un drame survenu le 26 juin 1977 dans la communauté Atikamekw de Manawan. Ce soir-là, un véhicule tombe dans une rivière. Deux Québécois s’en sortent indemnes, mais cinq jeunes Atikamekw meurent noyés. L’affaire est rapidement classée. La communauté est sous le choc et tente d’obtenir qu’une enquête soit ouverte.
Ce film bouleversant sera prochainement projeté au Ciné-campus et sera suivi d’une discussion avec la poète, parolière, conteuse et réalisatrice innue Joséphine Bacon, qui fait partie de la cohorte 2025 des sages de l’UdeM. À cette occasion, nous nous sommes entretenus avec celle qui a reçu un doctorat honorifique aux dernières collations des grades pour son engagement à l'égard des droits des Premiers Peuples.
«Soleils Atikamekw» revient sur un drame survenu en 1977. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez entendu parler de cette tragédie?
Je n’avais pas entendu parler de ce drame avant d’apprendre l’existence du film Soleils Atikamekw. C’est en lisant sur le projet que j’ai compris l’impact que cet évènement avait eu sur la communauté et sur les familles.
La réalisatrice Chloé Leriche parle de «la violence de l’indifférence». Est-ce une expression qui résonne pour vous?
Oui, beaucoup. Dans ces années-là, les gens étaient plutôt indifférents à ce qui nous arrivait. Ce n’était pas quelque chose qui passait aux nouvelles. Ces tragédies restaient confinées dans les communautés. Les Atikamekw, eux, ont vécu cet accident très durement, mais ça n’a pas dépassé leurs frontières.
C’est comme si, pour que ce soit pris au sérieux, il aurait fallu que ça arrive ailleurs. C’était ça, l’indifférence des médias à l’époque.
Depuis 1977, sentez-vous que les choses ont évolué?
Oui, je crois que les choses ont évolué. Aujourd’hui, les réseaux sociaux et les médias permettent de partager beaucoup plus rapidement ce qui se passe dans les communautés. En 1977, c’était impossible: on n’avait pas accès à ces moyens de communication. Maintenant, quand quelque chose survient, tout le monde le sait presque tout de suite. C’est une grande différence.
Pensez-vous que l’art et le cinéma peuvent contribuer à briser ces silences?
Oui, certainement. Ce genre d’œuvre permet d’ouvrir les yeux, d’amener les gens à entendre ce qu’ils ignoraient. Ce film permet de faire connaître cette histoire à un plus large public et de rappeler que de telles choses ne se sont pas produites qu’à Manawan, mais dans bien d’autres communautés aussi.
Peut-on dire que la création artistique est un outil de guérison pour les peuples autochtones?
Je ne sais pas si l’on peut parler de guérison parce qu’un film reste une succession d’images en mouvement portées sur un écran. Mais ce qui aide, c’est que les gens soient au courant de ce qui s’est passé, de ce qui n’est pas dit, mais qui existe encore aujourd’hui. La reconnaissance, la visibilité, c’est déjà un pas important.
Le film est tourné en langue atikamekw. Quelle importance accordez-vous à la langue dans la transmission de la mémoire?
Une très grande importance. Je trouve que c’est dans notre langue que la vérité existe. C’est dans nos mots que se trouvent les émotions, les souvenirs, la force. On peut traduire, bien sûr, mais la profondeur reste dans la langue d’origine.
Le film a été réalisé par une cinéaste allochtone en étroite collaboration avec la communauté de Manawan. Comment percevez-vous ce type de démarche?
Je trouve ça très bien. Les Atikamekw lui ont fait confiance, ils étaient prêts à lui raconter leur histoire. Même si elle est allochtone, Chloé Leriche était prête à écouter, à entendre vraiment ce que les gens avaient au fond de leur âme. C’est ce qui fait avancer les choses: elle n’a pas parlé à leur place, elle a écouté. Elle a ainsi pu mettre en images ce qu’ils avaient à dire. J’ai hâte de voir le film.