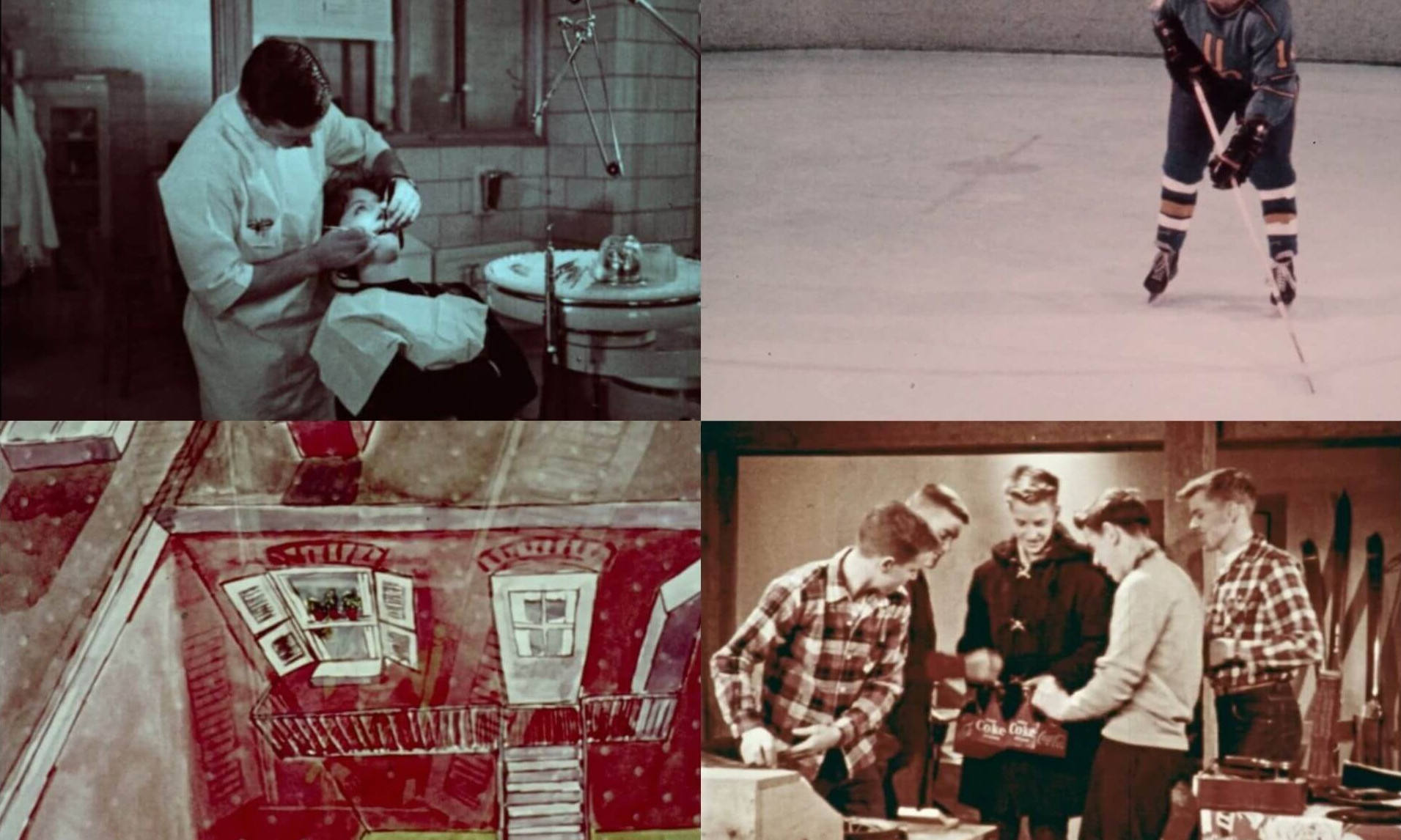Et si les machines racontaient une autre histoire du cinéma?

C’est une histoire du cinéma qu’on raconte peu. Celle des câbles, des bobines, des boutons, des interrupteurs. Une histoire de manivelles, de molettes et de pellicules. Une histoire en somme technique. Depuis plus de 10 ans, le projet TECHNÈS s’emploie à écrire cette autre histoire du cinéma, celle que les projecteurs n’éclairent presque jamais.
«Le programme qu’on s’est donné revient à repenser l’histoire et l’esthétique du cinéma à travers le prisme des techniques qui ont façonné son évolution depuis la seconde moitié du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui. Cette mission, nous l’avons menée avec l’ambition de proposer un renouvellement méthodologique à un moment critique de l’histoire du cinéma, celui de la transition vers le tout numérique», explique André Gaudreault, professeur au Département d’histoire de l’art, de cinéma et des médias audiovisuels de l’Université de Montréal, membre fondateur du Laboratoire CinéMédias et instigateur du projet.
Et cette idée, qui aurait pu rester dans les marges d’un colloque universitaire, a donné naissance à TECHNÈS, un ambitieux partenariat de recherche francophone qui réunit les groupes de recherche en études cinématographiques et médiatiques de trois grandes universités: l’Université de Montréal, l’Université Rennes 2 et l’Université de Lausanne, mais aussi des centaines d’autres chercheurs ainsi que des collaborateurs rattachés à des cinémathèques, des écoles de cinéma ou des musées. Et à l’arrivée: une encyclopédie numérique, des livres numériques en libre accès procurant une documentation inédite sur des dizaines d’appareils et de gestes techniques méconnus.
De la bobine au clic
L’Encyclopédie raisonnée des techniques du cinéma, par TECHNÈS, vient de paraître dans sa version définitive. Le mot raisonnée n’est pas là par hasard. Il ne s’agit pas seulement d’une enfilade de définitions ou de la présentation de fiches techniques: chaque entrée est pensée comme un parcours thématique, mêlant textes, images, vidéos, témoignages, entretiens filmés et démonstrations.
Un exemple? Le parcours consacré à la caméra Bolex, cette petite caméra suisse à manivelle adorée des cinéastes expérimentaux, comporte des vidéos montrant son fonctionnement, des modélisations 3D et même des archives rarement dévoilées. On découvre non seulement comment elle marche, mais aussi pourquoi elle a tant compté. On apprend ainsi comment les deux frères Abdullah et Issa Omidvar, équipés d’une Bolex H16, «partent à motocyclette de Téhéran pour ne revenir que sept ans plus tard, après avoir visité les populations les plus isolées de la planète. Leur expédition de 225 000 km les mène en Inde, en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Tahiti et à Bali, puis à chaque extrémité de l’Amérique, depuis le cercle arctique jusqu’à la Terre de Feu. En chemin, ils vivent plusieurs mois avec les Inuits et des tribus d’Amazonie, en particulier les Yaguas et les Jivaros, “les fameux chasseurs de têtes”. Cinéastes sans expérience, ils ramènent des images exceptionnelles, qui constituent non seulement un document ethnographique d’une inestimable valeur, mais témoignent également de l’incomparable [polyvalence] des caméras Bolex».
Aujourd’hui, 34 parcours bilingues sont en ligne. Certains plongent dans l’univers du cinéma d’animation, d’autres explorent les débuts du son, le montage à la table Steenbeck, la restauration du muet ou encore le bricolage dans le cinéma expérimental.
Un projet collaboratif
TECHNÈS, c’est aussi une aventure de recherche. Au fil des années, plus d’une centaine d’auteurs et auteures ont contribué à l’écriture de cette encyclopédie. Grâce à une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines de 2,5 M$ sur sept ans, ce projet a permis de former toute une nouvelle génération de chercheurs et de chercheuses. «Pour beaucoup d’étudiants et d’étudiantes à la maîtrise, au doctorat ou au postdoctorat, ça a été une première expérience professionnelle très riche. Certains, comme Annaëlle Winand, enseignent à leur tour. Il y a eu un véritable accompagnement dans la prise en compte des questions techniques liées à l’histoire du cinéma», souligne Rémy Besson, directeur éditorial de l’Encyclopédie.
Cette attention à la formation et à la collaboration s’est aussi manifestée dans les partenariats. TECHNÈS a tissé des liens solides avec des établissements de prestige comme la Cinémathèque française, la Cinémathèque québécoise, la Fémis (l’école nationale supérieure des métiers de l’image et du son en France), l’Office national du film du Canada ou encore le George Eastman Museum (États-Unis). L’objectif: croiser les expertises, allier recherche fondamentale et savoirs de terrain, théories et pratiques.
Des livres numériques

Mais le numérique, c’est aussi l’éphémère. Pour éviter que l’Encyclopédie disparaisse dans les limbes du Web, l’équipe de TECHNÈS a eu une autre idée: publier les différents parcours thématiques sous forme de livres numériques, en partenariat avec Érudit et le Laboratoire CinéMédias. On trouvera par exemple Techniques et technologies de la scénarisation des professeurs de cinéma Olivier Asselin et Isabelle Raynauld.
«On voulait une trace durable, quelque chose qui puisse aussi circuler dans les bibliothèques, qui soit imprimable», mentionne Rémy Besson. Vingt et un ouvrages sont déjà en ligne, téléchargeables gratuitement depuis le site d’Érudit.
Un projet qui continue de faire son chemin
Bien que le financement du partenariat ait officiellement pris fin en 2022, TECHNÈS continue de vivre. En 2023 était ainsi publié le livre Histoires d’appareils: la technologie du cinéma à travers les années et les continents, dirigé par Louis Pelletier et Rachael Stoeltje. Et à la toute fin du mois d’avril, au congrès de la Fédération internationale des archives du film à la Cinémathèque québécoise, une journée d’étude a été consacrée au bilan de TECHNÈS.
«TECHNÈS, c’est plus qu’un projet de recherche, c’est un écosystème, résume André Gaudreault. On a posé des bases, ouvert des pistes, formé des gens. C’est maintenant à chacun de le découvrir.»