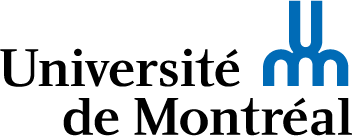IA: une route longue et sinueuse
- UdeMNouvelles
Le 30 août 2020
- Jeff Heinrich
De l'ex-URSS à une chaire d'excellence en recherche du Canada, Irina Rish, informaticienne à l'UdeM et chercheuse à MILA, a passé sa vie à explorer l'intelligence des humains et des machines.
Irina Rish avait 14 ans et fréquentait une école secondaire de Samarkand, en Ouzbékistan, lorsqu'elle a découvert la notion d'intelligence artificielle (IA).
«J'ai vu un livre, traduit de l'anglais vers le russe, dont la couverture était noire avec des lettres jaunes et qui s'intitulait Can Machines Think?» se souvient Mme Rish, évoquant ce moment clé de sa scolarité dans l'ex-Union soviétique.
Participante d’une olympiade de mathématiques, l’élève était intriguée.
«L’ouvrage portait sur l'intelligence artificielle et je me suis dit: Mon Dieu, l’auteur aussi pose la question des algorithmes à concevoir pour résoudre des problèmes difficiles et demande comment nous pouvons stimuler notre propre “intelligence naturelle”», se rappelle-t-elle.
Elle poursuit: «Je ne pensais pas seulement que ce serait amusant d'apprendre aux ordinateurs à résoudre des problèmes ‒ en d'autres termes l'IA. Je voulais aussi savoir comment développer mon intelligence pour que ma prochaine olympiade de maths soit meilleure.»
C'était en 1983 et, depuis lors, Irina Rish a fait de cette double quête l'œuvre de sa vie.
Après des études universitaires ‒ d'abord à Moscou, puis en Californie ‒ et une carrière de 20 ans chez IBM à New York, elle a déménagé au Canada en octobre dernier pour devenir professeure associée au Département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal et membre du corps professoral de l’Institut québécois d'intelligence artificielle, MILA, qui lui est affilié.
Déjà titulaire d'une chaire en IA Canada-CIFAR, Mme Rish s’est vu accorder cet été une chaire d'excellence en recherche du Canada (CERC), une reconnaissance prestigieuse de son travail. Cette chaire est dotée d'un budget de 34 M$ sur sept ans, dont 10 M$ du gouvernement fédéral et 4,4 M$ de l'UdeM.
La demande de subvention de Mme Rish a été soutenue par une variété d'organisations (MILA, HEC Montréal, Polytechnique Montréal, l’Université McGill, Calcul Québec, le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec) et d'acteurs de l'industrie (Imagia, Element AI, Samsung, IBM, Microsoft et Druide). «C'est une merveilleuse occasion pour mon équipe et moi à MILA», déclare Mme Rish.
Une IA large et solide
«Au cours des prochaines années, cette chaire nous permettra d'explorer les frontières de la recherche en IA au croisement de l'apprentissage automatique et des neurosciences, et de progresser vers une intelligence artificielle plus autonome, à échelle humaine, en élaborant de nouveaux modèles et méthodes pour des systèmes d'IA larges et solides, par opposition aux systèmes étroits et fragiles d'aujourd'hui», indique-t-elle.
Son objectif, ajoute-t-elle, est de «développer des capacités d'IA en apprentissage continu, tout au long de la vie, analogues à celles des humains, ainsi que des approches pour que l'intelligence artificielle s’adapte aux changements de son environnement et aux problèmes qu'elle doit résoudre, et soit capable d'une compréhension et d’une généralisation améliorées, à l'instar des capacités humaines. Le programme de la CERC, d'une durée de sept ans, est une occasion extraordinaire de se concentrer sur la recherche de pointe et d'emprunter des pistes peu fréquentées qui pourraient mener à des résultats surprenants. C'est un grand honneur pour nous tous».
Au fil de son parcours, Irina Rish a franchi de nombreux obstacles et réussi à apporter de nombreux changements dans sa vie. Elle a fait face à la discrimination ethnique dans le milieu universitaire russe, a surmonté le choc culturel du déménagement aux États-Unis en apprenant l'anglais, a surpris ses parents enseignants en refusant un poste de professeure d'université pour aller travailler dans l'industrie et a concilié sa carrière de chercheuse avec sa vie familiale.
Aujourd'hui à Montréal avec son mari et leurs deux enfants, elle doit relever de nouveaux défis liés à son passage de l'industrie à l'université et d'un pays à un autre, notamment apprendre une nouvelle langue.
«L'UdeM est une université de langue française, donc j'apprends le français, dit-elle dans un anglais teinté d’un accent russe. Une des premières choses que je devais savoir, c'est qu'il n'y a pas de mot distinct pour 70, 80 ou 90. C'est 60 plus 10, 4 fois 20, 4 fois 20 plus 10 ‒ comme c'est intéressant! Pas si simple!»
Trouver des modèles intéressants
En tant que scientifique, Irina Rish décrit son travail comme étant «au carrefour de l'intelligence artificielle, des neurosciences et de la psychologie. On utilise des ordinateurs pour analyser les données du cerveau et y trouver des modèles intéressants liés au comportement humain, aux états mentaux et à leurs changements, et l’on se sert de ce qu’on apprend pour mieux comprendre comment le cerveau fonctionne et pour rendre les ordinateurs plus performants et l'IA moins artificielle».
Chez IBM de 1999 à 2019, Mme Rish a remporté plusieurs prix d'entreprise pour l'excellence et l'innovation alors qu'elle était employée au Centre de recherche Thomas J. Watson à Yorktown Heights (New York). Jusqu'à présent, à MILA, elle a travaillé avec le directeur scientifique Yoshua Bengio, entre autres sur COVI, une application de recherche de contacts dans la lutte contre la COVID-19.
Irina Rish détient 64 brevets, a publié plus de 90 articles de recherche, rédigé plusieurs chapitres de livres, édité trois ouvrages et fait paraître une monographie sur la modélisation éparse, un domaine de l'apprentissage automatique statistique particulièrement important en bio-informatique et en neuro-imagerie. Elle a fait de la résolution de problèmes une vocation ‒ et un plaisir.
«Le meilleur conseil que j'ai reçu sur la façon de résoudre les problèmes était simplement d'en résoudre autant que possible; il suffit de continuer à s'entraîner, mentionne Mme Rish. Et si vous n’y arrivez pas du premier coup, alors reformulez, essayez des méthodes différentes et abordez le problème sous différents angles.
«Quand il s'agit de former votre cerveau, il n'y a pas de substitut à l’entraînement, tout comme lorsque vous formez des systèmes d'IA avec de plus en plus d'échantillons de données. Reformuler les problèmes, ainsi qu'explorer différentes perspectives et transformations de données, est utile à la fois pour les humains et pour l'intelligence artificielle.»
Une famille de mathématiciens
Irina Rish a eu la piqûre des mathématiques très tôt. Ses parents enseignaient la discipline: son père, Georg Rish, était spécialisé dans la modélisation mathématique et la linguistique à l'Université d'État de Samarkand; sa mère, Lioubov («amour», en russe) enseignait les mathématiques aux élèves d’un lycée de la ville. L’un de ses deux frères, Dimitri, était également mathématicien.
«Il était mon modèle, raconte-t-elle à propos de ce frère de 15 ans son aîné et surnommé Dima. Mes parents étaient occupés par leur travail, alors il m'a prise sous son aile dès mon plus jeune âge et a commencé à me donner de petits tests de logique à faire et j'ai vraiment aimé ça. Je l'ai ensuite suivi aux olympiades de mathématiques et je me suis plongée dans l'apprentissage des mathématiques, puis de l'informatique. Il m'a appris la programmation à l'âge de 14 ans.»
En grandissant, la jeune fille a manifesté un intérêt pour d'autres domaines très différents, comme la création littéraire ainsi que la physique et la chimie. Son deuxième frère, Ilya, de 13 ans son aîné, l’a également influencée, car il était passionné de chimie. Son père espérait qu'elle suivrait ses propres traces et se lancerait dans la linguistique. (Bien qu'elle ait choisi les mathématiques et l'informatique, elle est restée attachée à l'écriture; dans un univers parallèle, imaginait-elle, elle ferait carrière en tant qu'écrivaine.)
Pour son diplôme de premier cycle, elle a voulu entrer à l'Université d'État de Moscou en mathématiques appliquées. L'examen oral d'admission a duré trois heures au lieu des 20 minutes habituelles; son examinateur lui soumettait des problèmes de plus en plus difficiles et le dernier était impossible à résoudre. Elle a obtenu la note C, qui lui a fermé les portes de l’Université.
«J'ai été surprise», se souvient Irina Rish, qui à l'époque se doutait qu'elle était victime de discrimination. Son père, bien qu'athée, était juif, né en Allemagne; son grand-père, Arnold (Grigorievich) Rish, était un représentant du jeune gouvernement soviétique, envoyé plus tard en Sibérie quand il est tombé en disgrâce, sa famille exilée en Ouzbékistan. Les Rish sont originaires de Biélorussie; le nom signifiait à l'origine «roux».
Refusée par l’Université d’État, Irina Rish a posé sa candidature à l'Université nationale du pétrole et du gaz de Moscou, également connue sous le nom d'Institut Gubkin, qui abritait un grand nombre de brillants scientifiques, dont beaucoup étaient juifs. Elle y a étudié aux côtés de futures sommités telles qu'Edward Frenkel (aujourd'hui à l'Université de Californie à Berkeley) et Roman Abramovich (l'oligarque basé en Grande-Bretagne).
Une éducation américaine
Puis est survenu l'effondrement de l'Union soviétique. C'était en 1991 et des étudiants comme Irina Rish ont enfin pu postuler dans des universités occidentales. Pour son diplôme de troisième cycle, elle a envoyé sa candidature dans bon nombre d'établissements américains et a été acceptée par plusieurs. Elle a choisi l'Université de Californie à Irvine, qui l'a impressionnée par la grande variété de sujets de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle.
«La première année a été un choc: la nouvelle langue, les cours, la logistique pour trouver un appartement, je partais de zéro», se remémore-t-elle.
Un autre défi a été de travailler comme assistante d'enseignement. Au fur et à mesure de sa progression, Mme Rish a pris en charge de grandes classes de premier cycle, corrigeant les devoirs et les examens et animant des séances de discussion avec les étudiants.
Son anglais était loin d'être parfait, mais ce poste lui a fait réaliser que l'enseignement ‒ aider les étudiants à comprendre la matière, à surmonter leurs peurs des mathématiques et à résoudre leurs problèmes personnels ‒ était quelque chose qui la passionnait.
Ce fut un changement significatif par rapport à l'éducation qu'elle avait reçue en Union soviétique.
«En URSS, les professeurs avaient une approche plus stricte: vous les rencontriez une première fois et vous deviez ensuite vous débrouiller par vous-même, relate-t-elle. En Californie, c'était plus pratique: les professeurs vous aidaient à choisir votre matériel, vous guidaient, conscients peut-être que vous risquiez de mal les évaluer s’ils ne le faisaient pas. C'était vraiment un changement de culture.»
Ses années d'études supérieures ont également été très enrichissantes: nouvelles amitiés, nouveaux sujets à explorer, recherche de sa voie de l'autre côté de l'équation de l'éducation: l'activité scientifique.
«J'ai beaucoup grandi en tant que personne au cours de ces années, dit-elle. J'ai noué des amitiés pour la vie et j'ai réalisé que, en ce qui concerne la recherche, je suis plus intéressée par l’apprentissage automatique que par les branches plus “classiques” du raisonnement automatique.
«Je suis également tombée sous le charme de la “théorie de l'information” de Claude Shannon et j'ai assisté à ce qu'on appelait alors une révolution dans le domaine du traitement du signal, lorsqu'un simple algorithme de “propagation des croyances” s'est avéré produire une précision de décodage proche de la limite de Shannon. J'étais très enthousiaste, car cela était étroitement lié à mon champ de recherche: les algorithmes approximatifs pour l'inférence probabiliste.»
Sauter à IBM
Titulaire d’une maîtrise (1994) et d’un doctorat (1999), tous deux en informatique avec une spécialisation en intelligence artificielle, de l’Université de Californie à Irvine, Irina Rish s'est vu proposer un poste de professeure adjointe à l'Université de Washington à Saint Louis. Mais elle a plutôt choisi la recherche industrielle.
«Je suis allée travailler chez IBM, indique-t-elle. C'était vraiment passionnant: il y avait un énorme laboratoire qui employait de nombreux chercheurs en physique, en biologie, en intelligence artificielle; beaucoup de gens venaient à mes conférences et me posaient des questions. C'était comme être à une conférence scientifique tout au long de l'année, c’était très stimulant.»
Son choix de ne pas rester à l'université a surpris à la fois son père et sa directrice de thèse Rina Dechter, mais Mme Rish savait qu'elle avait fait le bon choix. «J'ai senti qu’après sept ans dans le même environnement il était temps d'essayer quelque chose de très différent.»
Elle était loin de se douter qu'elle allait passer les 20 prochaines années chez IBM.
«Dans l'industrie, les spécialistes comme moi ne restent généralement que quelques années, voire parfois quelques mois, au même endroit, déclare-t-elle. Mais IBM était l'endroit idéal pour moi. C'est un laboratoire immense et dynamique, et ce que j'y ai appris m'a permis de garder l'esprit ouvert et de voir les directions que je pouvais prendre, puis de me concentrer pour obtenir des résultats.»
Un emploi à l'UdeM
Irina Rish est arrivée à l'UdeM avec cette même ouverture d’esprit. L'idée de quitter IBM, de déménager sa famille et de commencer une seconde carrière au Canada lui est venue lors d'une rencontre en 2018 avec sa collègue en intelligence artificielle Joëlle Pineau, chercheuse à MILA, professeure agrégée à l'Université McGill et responsable du laboratoire de recherche en IA de Facebook à Montréal.
«Nous nous sommes rencontrées à une conférence et elle m'a parlé d'un poste attaché à la CERC qui s'était ouvert à MILA et m'a encouragée à postuler, se rappelle Mme Rish. Je me suis dit que, après quelques années dans l'industrie, il était logique d'accepter enfin un poste dans une université, car j'ai toujours aimé enseigner et travailler avec les étudiants. Cela aurait probablement rendu mon père heureux.»
À l'automne 2019, Mme Rish s’est installée à Montréal avec sa famille ‒ son mari, Sergey Panitkin (comme elle, un amoureux de ski alpin), et leurs enfants, Natalie, 16 ans, écrivaine en herbe, et le jeune Alexander (Sasha), 8 ans. Ils ont quitté Rye Brook, dans le Westchester County (New York), pour une maison louée dans le quartier Côte-des-Neiges, non loin du campus principal de l'UdeM.
Son mari, qui travaillait en physique des hautes énergies au Brookhaven National Laboratory du gouvernement américain à Upton et au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, à Genève, a accepté un poste de consultant au Département de physique de l'UdeM tout en cherchant un emploi à plein temps.
Puis, alors que Mme Rish commençait à enseigner à MILA, la pandémie de COVID-19 a frappé, et la nouvelle vie de la famille a été mise en suspens.
«Nous sommes arrivés en octobre et j'ai commencé à enseigner à MILA en janvier, mentionne Mme Rish. Après la fermeture de MILA, un groupe de travail interdisciplinaire sur la COVID-19 a été formé et des projets ont vu le jour: l'analyse des données génomiques pour mieux comprendre la maladie, dirigée conjointement avec mon collaborateur Guy Wolf et d'autres collègues de l'UdeM; la mise au point de l’application COVI, destinée à la recherche de contacts potentiellement infectés par le virus et à l'évaluation des risques de contamination, que dirigent Yoshua Bengio et son équipe, en collaboration avec de nombreuses autres personnes, dont moi-même.»
«Une expérience unique»
Ces quelques mois ont été intenses, signale-t-elle: «Une expérience unique, travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour faire avancer des projets, rencontrer plusieurs nouvelles personnes et nouer des collaborations avec des collègues du monde entier. Même si, en fin de compte, le gouvernement canadien a décidé d'opter pour une application différente et plus simple qui n'implique pas d'apprentissage automatique [Alerte COVID], nous pensons que notre travail montre que l'intelligence artificielle peut être très utile pour lutter contre la propagation des maladies, puisque le recours à l'estimation des risques et à l'analyse des données peut nous permettre d'alerter les gens beaucoup plus tôt qu'avec la recherche standard des contacts, ce qui pourrait sauver des vies.»
L'IA suscite encore la suspicion du public, reconnaît-elle.
«Ce n'est pas tant la crainte que les machines prennent le dessus. C'est le mode d'apprentissage nourri par les données. La collecte de données et le respect de la vie privée sont des questions très sensibles et il est très difficile de convaincre les gens que leurs données sont en sécurité. Même si la protection de la vie privée était la priorité absolue lors du développement de l'application COVI, il est compréhensible que, sur le plan émotionnel, les gens puissent avoir du mal à faire entièrement confiance aux systèmes automatisés pour ce qui est de leurs renseignements personnels. C'est pourquoi il est aussi important que l’intelligence artificielle devienne plus sûre, plus solide et plus éthique.»
Tout cela rend sa mission ‒ faire en sorte que le public fasse confiance à la science, à la logique, au raisonnement ‒ d'autant plus primordiale aujourd'hui.
«En fin de compte, tout se résume à ceci: comment résoudre les problèmes? Quelle est l'ampoule qui s’allume dans notre cerveau et qui nous permet de comprendre les choses? Comment pouvons-nous améliorer à la fois notre cerveau et l'IA? C'est ce que je veux découvrir.»