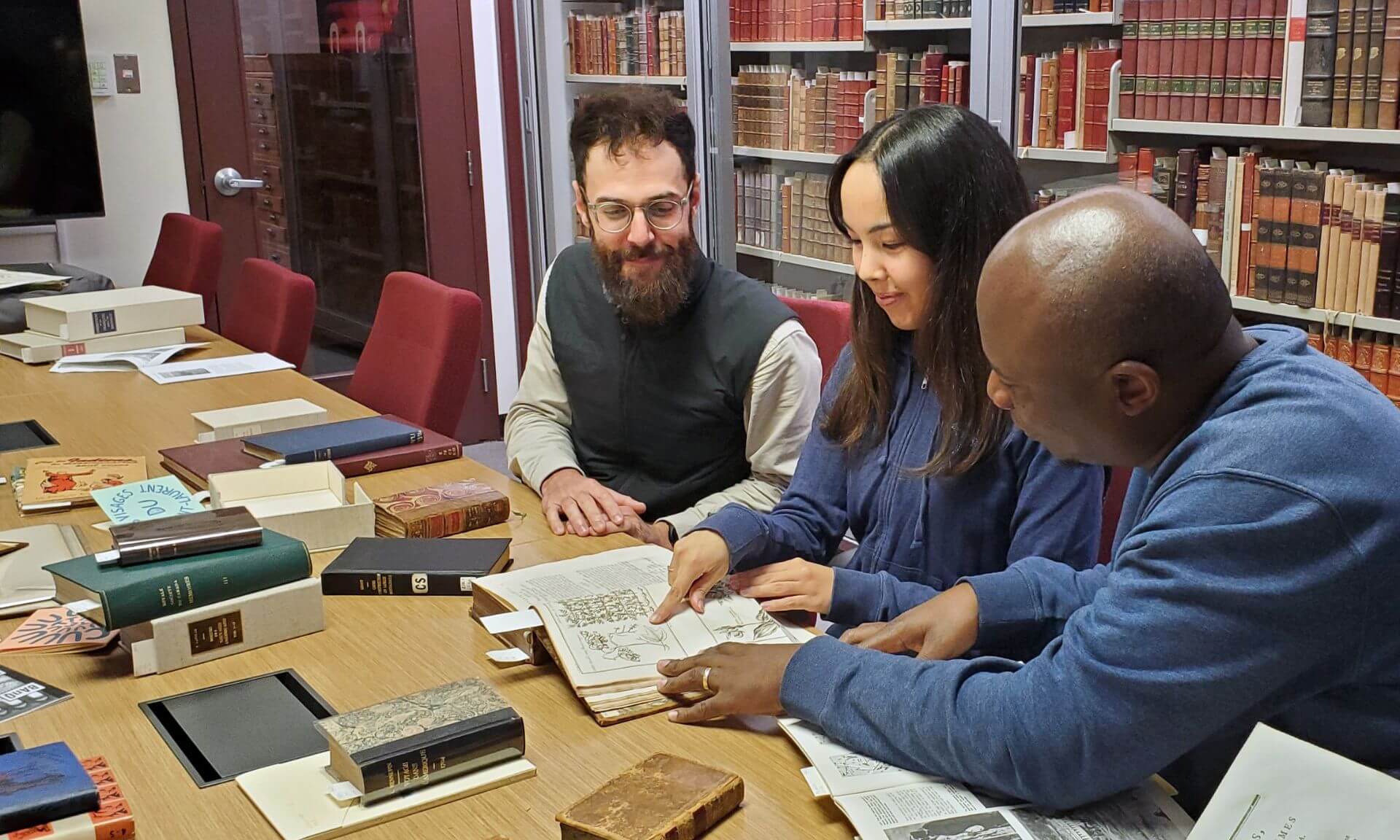Dix millions de dollars pour des publications scientifiques en français plus accessibles

Le 31 mai, les Fonds de recherche du Québec ont annoncé la création du Réseau québécois de recherche et de mutualisation pour les revues scientifiques, dirigé par Francis Gingras, professeur au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal.
Financé à hauteur de 10 M$ sur cinq ans, ce projet vise à renforcer l’écosystème de la publication scientifique en français au Québec. Il souhaite garantir la pérennité et le développement des revues scientifiques québécoises tout en facilitant leur transition vers un modèle de publication en libre accès, où ni les auteurs ni les lecteurs ne paient de frais. Par ce modèle «diamant», on veut promouvoir une science ouverte, soutenue par la communauté universitaire.
Établir un nouveau modèle économique de publication

L'objectif du Réseau est de contrer le modèle économique actuel, dominé par des conglomérats de revues scientifiques à but lucratif. Le système éditorial québécois, bien que subventionné par des fonds publics, repose encore en partie sur les revenus d’abonnements. «Nous voulons favoriser la diffusion des contenus scientifiques auprès du plus grand nombre et sans entraves à la fois en valorisant un modèle qui ne repose pas sur la recherche du profit et en assurant le bon fonctionnement des revues», explique Francis Gingras. Le Réseau ambitionne de créer un modèle économique viable, ce qui suppose un financement pérenne et prévisible. Pour ce faire, il devra exercer un véritable leadership dans l’espace francophone tout en tenant compte de ce qui se fait en Europe ou dans d’autres contextes linguistiques, par exemple en Amérique latine.
Ce projet comporte également une dimension de valorisation du travail éditorial que les professeurs et professeures font dans les revues et qui n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur dans les universités, poursuit Francis Gingras.
Quatre pôles de recherche
Quatre pôles de recherche ont été créés pour ce projet.
Espace REVUES: dirigé par Anne-Marie Fortier, professeure à l’Université Laval, ce pôle mettra notamment en place des services mutualisés pour soutenir la production de revues québécoises et prodiguera des conseils sur la science ouverte.
L.A. Plateforme: sous la direction de Tanja Niemann, directrice générale du consortium Érudit, ce pôle poursuivra le travail accompli par Érudit, la principale plateforme de diffusion de revues scientifiques au Québec. Il soutiendra l’édition, la diffusion et la valorisation numériques des revues scientifiques québécoises et facilitera le passage au libre accès.
Bibliotheques.com: Stéphanie Gagnon, directrice générale des bibliothèques de l’Université de Montréal, sera responsable de ce pôle consacré au partage des bonnes pratiques éditoriales. «Les bibliothèques jouent un rôle essentiel dans la diffusion du savoir scientifique en étant au cœur de la gestion des abonnements aux revues savantes, mais aussi à travers l’expertise des bibliothécaires en matière d’indexation et de référencement. Depuis plusieurs années, des bibliothèques universitaires québécoises ont également mis sur pied des services directs en appui aux revues scientifiques. À travers le Réseau, leur expertise sera partagée avec l’ensemble des revues savantes québécoises», mentionne Francis Gingras.
Découvrabilité 2.0: dirigé par Vincent Larivière, professeur en bibliothéconomie et en sciences de l’information à l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Québec sur la découvrabilité des contenus scientifiques en français, ce pôle s’assurera d’une meilleure découvrabilité des contenus scientifiques en français.
Des expertises d’universitaires de tout le Québec
Une cinquantaine de chercheurs et de chercheuses de presque toutes les universités québécoises vont travailler sur cet ambitieux projet mené par l’Université de Montréal. Parmi eux citons Véronique Guèvremont, professeure de droit à l'Université Laval et spécialiste des questions de découvrabilité; Lynne Bowker, professeure à l’Université Laval et spécialiste de la traduction automatique; Marie-Nathalie Leblanc, professeure à l’UQAM et vice-rectrice à l’Agence universitaire de la Francophonie; et Sophie Montreuil, directrice générale de l'Acfas.
«La science étant un bien public partagé, il faut s'assurer que ce bien public est justement accessible à tous et à toutes. L’objectif est de réussir à donner au Québec une structure pérenne et stable pour le libre accès tout en protégeant la diversité des revues et en reconnaissant l’importance et la valeur du travail éditorial», conclut Francis Gingras.