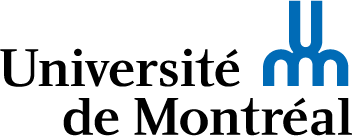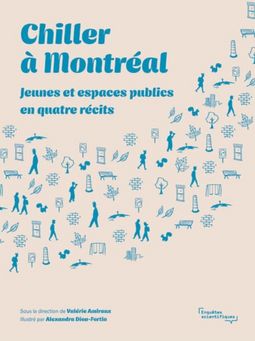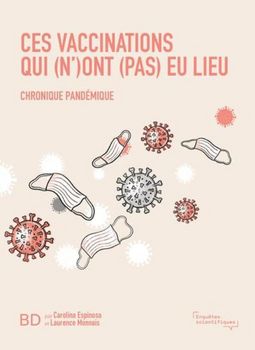«Enquêtes scientifiques»: quand la science s'illustre autrement
- UdeMNouvelles
Le 10 octobre 2024
- Virginie Soffer
Les PUM lancent une collection de bandes dessinées. Les deux premiers volumes abordent les problèmes d’accès à la vaccination pendant la pandémie et la sociologie des jeunes dans les lieux publics.
Une nouvelle collection intitulée «Enquêtes scientifiques» voit le jour cet automne aux Presses de l’Université de Montréal (PUM), proposant une approche originale et accessible pour diffuser des démarches scientifiques sous forme de bandes dessinées. Dirigée par Valérie Amiraux, professeure de sociologie et vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux à l'Université de Montréal, et Laurence Monnais, professeure en histoire de la médecine et de la santé publique à l’Institut des humanités en médecine de l’Université de Lausanne et professeure associée au Département d’histoire de l’UdeM, la collection met en lumière des recherches éclectiques et s’appuie sur le talent de deux bédéistes québécoises pour les premiers volumes, Alexandra Dion-Fortin et Carolina Espinosa.
Chiller à Montréal, dirigée par Valérie Amiraux et illustrée par Alexandra Dion-Fortin, qui se penche sur les comportements des jeunes dans les endroits publics, et Ces vaccinations qui (n')ont (pas) eu lieu: chronique pandémique, par Laurence Monnais et Carolina Espinosa, qui aborde les questions d’accès aux soins dévoilées par un projet de recherche-action mené pendant la pandémie de COVID-19, inaugurent la série.
Une nouvelle collection aux PUM
La collection «Enquêtes scientifiques» est née d'une réflexion sur la manière de diffuser la connaissance scientifique au-delà des formats habituels. Valérie Amiraux, amatrice de romans graphiques et de bandes dessinées, avait déjà testé la BD avec Salomé et les hommes en noir, coécrite avec Francis Desharnais (Bayard, 2015). Elle trouve dans cette forme d’écriture une manière d’accéder à un public plus large, mais aussi d’incarner différemment le résultat d’un travail de recherche. «Le mouvement vers des modes de diffusion différents des résultats de recherche s’observe d’ailleurs davantage depuis une dizaine d'années en sciences humaines et sociales, parfois dès le mémoire de maîtrise ou la thèse de doctorat», constate-t-elle.
La collection vise à inciter les chercheurs et chercheuses à envisager ces nouvelles façons de présenter leurs travaux en restant fidèles à des presses universitaires. «C’est une autre forme de langage, un autre moyen de traduire et transmettre sa recherche. Les PUM nous offrent un écrin de choix et ont accepté de prendre le risque de se lancer dans quelque chose de totalement inédit sans renoncer à la rigueur de leur travail éditorial», déclare Valérie Amiraux. La collection s’adresse à des publics qui pourraient ne pas être spontanément attirés par des conférences ou la lecture d’articles scientifiques, mais qui se trouveraient séduits en feuilletant un tel ouvrage sur les tablettes d’une librairie de quartier. «Cette nouvelle collection des PUM mise pour le dire autrement sur l’accessibilité: le format, le prix, le travail d’édition, tout a été pensé pour que ces ouvrages soient accessibles», poursuit-elle.
Illustrer le fonctionnement d'une enquête scientifique
La série valorise la démarche d’enquête. Valérie Amiraux et Laurence Monnais souhaitent y montrer comment les scientifiques mènent leurs recherches, de la formulation des hypothèses à la validation des résultats en passant par la collecte des données, tout en intégrant les doutes, les erreurs et les ajustements propres au processus scientifique.
Valérie Amiraux explique: «La pandémie m'a fait réaliser, de manière brutale, à quel point le rôle de la science est contesté dans les sphères médiatique et politique, sur tous les fronts, quelle que soit la discipline. Le travail scientifique est souvent non seulement méconnu, mais aussi dévalorisé. Cette collection, centrée sur la démarche de l'enquête, explique comment les scientifiques travaillent, comment leurs découvertes se construisent, leurs hypothèses se vérifient ou pas. Il est très important pour moi de montrer que la recherche scientifique n'est pas une question d'opinion ou d'idéologie, mais qu’elle repose sur une démarche d'enquête rigoureuse.»
Elle insiste sur l'importance de rendre visible ce processus: «L’enquête, un mot simple souvent associé aux policiers ou aux journalistes, illustre bien cette idée de progression par étapes, de réflexion guidée par des hypothèses et nourrie de l’interprétation d’indices. Certains résultats ouvrent parfois d’autres pistes qui n’étaient pas envisagées, ce que montrent Laurence [Monnais] et Carolina [Espinosa] dans leur ouvrage sur les hésitations face à la vaccination en contexte pandémique, analysées dans l’urgence et qui ont permis de réaliser à quel point la sous-vaccination dans certains endroits n’avait pas grand-chose à voir avec des réticences à l’endroit du produit biologique. Il est essentiel de rendre ce travail accessible et de valoriser ces démarches pour nous aider à penser collectivement notre monde commun.»
«Chiller à Montréal», dirigé par Valérie Amiraux et illustré par Alexandra Dion-Fortin
Chiller à Montréal explore les comportements des jeunes dans les parcs publics de la ville à travers quatre récits. Que font les jeunes dans les parcs la nuit? Quelles sont leurs expériences de ces lieux? Quelle place leur est faite? Les réponses à ces questions apparaissent au fil des histoires.
Basé sur des enquêtes ethnographiques réalisées en équipe dans le cadre du projet TRYSPACES: jeunes, espaces et transformations, cet ouvrage est le fruit d'une collaboration multidisciplinaire réunissant des chercheurs et des chercheuses en géographie, sociologie, anthropologie et études urbaines. Ils ont observé des jeunes dans les parcs, de Montréal-Nord à Pointe-aux-Trembles, pour mieux comprendre les interactions entre eux et les lieux publics urbains, apportant ainsi un regard neuf sur un sujet souvent débattu.
Valérie Amiraux souligne l’importance de dépasser les opinions simplistes concernant les jeunes. «La science n’est pas une opinion. Il ne s’agit pas d’énoncer par exemple que ce que font les jeunes est conforme ou non à certaines valeurs, attentes, règles. Après des centaines d’heures d’observation dans les parcs, Nathalie Boucher et Sarah-Maude Cossette dressent, dans l’un des quatre récits, le constat simple mais politiquement puissant que les adolescentes n’ont aucune place où “être” dans l’espace public. En raison de la conception du mobilier urbain – pour de très jeunes enfants – ou de l’aménagement des lieux – pour des sports collectifs, pour des hommes», dit-elle.
Le choix de l’équipe de recherche d’opter pour le terme chiller dans le titre du livre, un mot issu du langage des jeunes devenu courant, reprend ce constat transversal aux quatre récits: «Chiller, c’est être dans l’espace public sans forcément avoir une activité précise. Ce n’est pas une démonstration sportive ou musicale, c’est simplement “être là”. Mais cet état d’être se heurte à des contraintes sociales, des réalités urbaines, des différences de genre et d’origine sociale. Tout le monde n’a pas la possibilité de traîner dans un parc la nuit ou de naviguer aisément dans des quartiers différents du sien», indique Valérie Amiraux. Ce livre cherche à offrir un nouveau regard sur la réalité quotidienne de nombreux jeunes à Montréal en révélant des dynamiques souvent invisibles ou incomprises dans l’espace public.
«Ces vaccinations qui (n')ont (pas) eu lieu: chronique pandémique», par Carolina Espinosa et Laurence Monnais
Ces vaccinations qui (n')ont (pas) eu lieu: chronique pandémique s'inscrit dans la continuité des travaux de Laurence Monnais, notamment Vaccinations: le mythe du refus, paru aux PUM en 2019. Cet ouvrage propose une réflexion approfondie sur les enjeux contemporains liés à la vaccination à travers l’expérience de la pandémie de COVID-19 telle qu’elle a été vécue et appréhendée par les communautés les plus vulnérables, et les plus invisibilisées, de Montréal. Les auteures abordent la complexité des décisions individuelles face à la vaccination, complexité qui s’est, dans une certaine mesure, tout particulièrement révélée dans l’urgence de la campagne lancée au tournant de 2021 et qui, en même temps, est restée largement ignorée dans les prises de décision et les discours publics.
La bande dessinée revient ainsi sur des expériences collectives susceptibles d’avoir nourri une certaine méfiance auprès de plusieurs communautés. Mais surtout, les auteures y soulignent les conséquences d’obstacles économiques, géographiques, administratifs, culturels à la vaccination. «Il ne suffit pas qu’un vaccin soit gratuit pour qu’il soit accessible», rappelle Laurence Monnais et c’est là une réalité historique qu’on ne finit pas d’oublier.
«Ce qui m'a beaucoup intéressée en tant qu’historienne de la santé, c'est d’essayer de comprendre comment des expériences passées, de violence médicale ou de négligence par l’État en particulier, ont pu influencer certaines résistances et appréhensions face à la vaccination», explique-t-elle. En filigrane du livre, on trouve une critique du discours public qui a stigmatisé les personnes non vaccinées. Laurence Monnais insiste sur la nécessité de reconnaître l'hétérogénéité des positions et surtout de chercher à comprendre les raisons de ces non-vaccinations en contexte de pandémie et d’urgence sanitaire mais aussi au-delà. Pour le dire autrement, pour elle «il est urgent de se saisir de questions d’accessibilité et d’inquiétudes légitimes».
À travers leur ouvrage, Laurence Monnais et Carolina Espinosa proposent que soient renouvelées en santé publique les façons de faire auprès des individus et des groupes les plus invisibilisés dans l’espace public et médicosanitaire. Laurence Monnais conclut en disant que «cette bande dessinée permet de mieux réfléchir pour faire mieux la prochaine fois parce qu'il y aura d'autres pandémies et d'autres campagnes massives de vaccination».