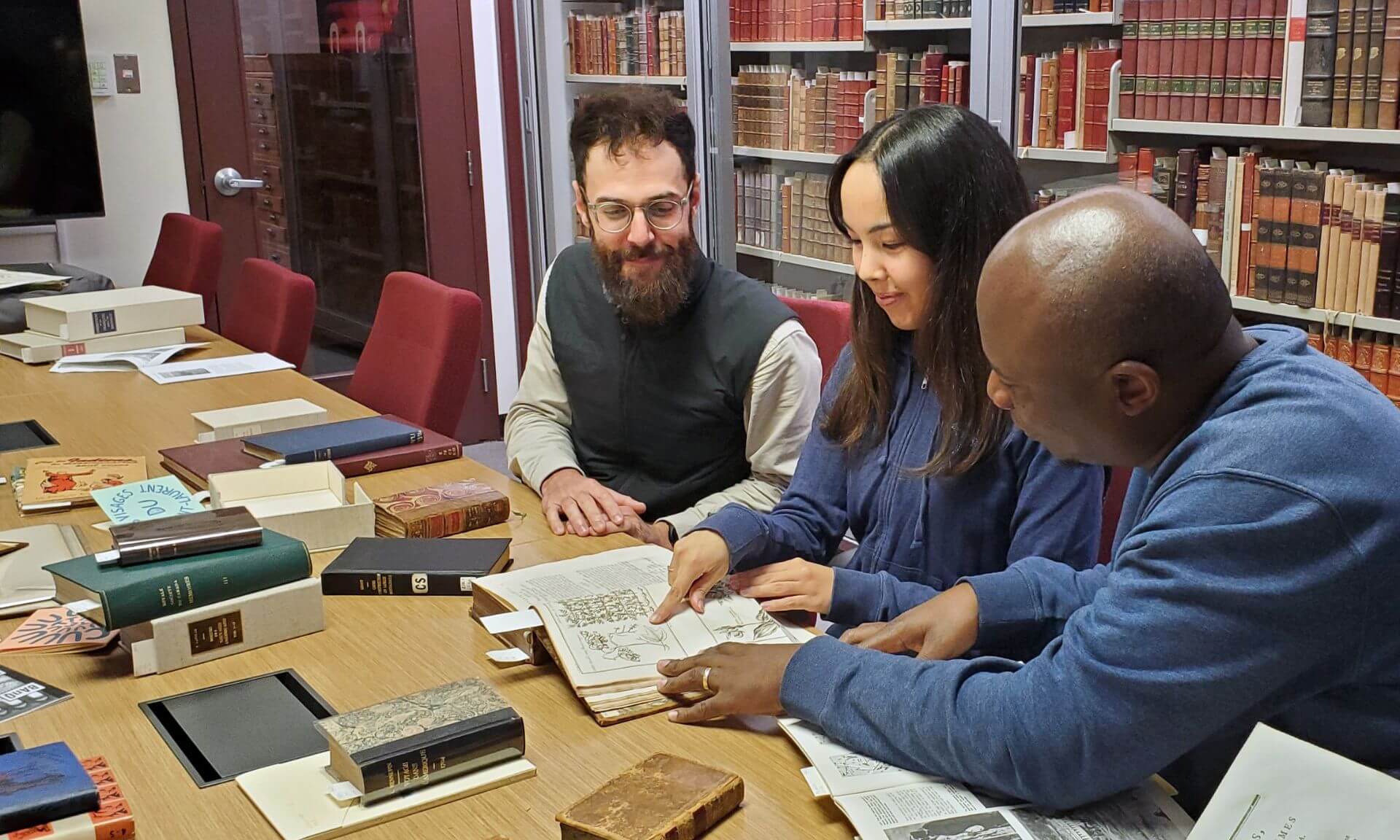La Faculté de médecine de l'UdeM: un siècle de recherche et de persévérance

L’ouvrage La recherche biomédicale au Québec: du chercheur isolé aux grandes équipes de recherche 1900-2023, de Denis Goulet, retrace plus d’un siècle d'histoire de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. De ses modestes débuts aux premiers instituts jusqu'à l'émergence des grandes équipes de recherche durant la Révolution tranquille, il dépeint la remarquable métamorphose de ses activités scientifiques.
Pourquoi ce nouveau livre sur l'histoire de la recherche biomédicale au Québec?
J’ai consacré ma carrière d’historien à raconter l’histoire des maladies, mais aussi l’évolution des savoirs médicaux, leurs retombées sur les soins hospitaliers ainsi que sur la formation des médecins. Cet ouvrage fait donc suite à des travaux de recherche que je mène depuis quelques décennies. Au fil du temps, j’ai retracé la carrière de plusieurs chercheurs qui ont marqué la genèse et le développement de la recherche biomédicale au Québec. Certains d’entre eux – Wilder Penfield, Armand Frappier, Hans Selye, Jacques Genest – sont reconnus encore aujourd’hui comme des pionniers et font l’objet de diverses publications. En revanche, je me suis rendu compte qu’il y avait plusieurs «grands oubliés» qui, à leur époque, ont pourtant influé sur le cours de la recherche biomédicale, non seulement à l’échelon national, mais aussi à l’échelle internationale. Bref, j’en suis venu à la conclusion que le temps était venu d’écrire une synthèse de cette histoire.
Le développement de la recherche médicale à la Faculté de médecine de l'UdeM s’est amorcé lentement au début du 20e siècle. Quels ont été les principaux défis et obstacles qui l’ont ralenti?
Entre 1900 et 1930, la recherche biomédicale à l’Hôpital Notre-Dame ou à l’Hôtel-Dieu de Montréal émerge timidement, portée par des cliniciens généralistes et de jeunes spécialistes inspirés par la révolution bactériologique qui éclot en France et en Allemagne grâce à Louis Pasteur et à Robert Koch. Mais les bactériologistes ne disposent que de petits laboratoires souvent mal équipés. Malgré quelques initiatives prometteuses – comme la tentative de créer un institut Pasteur, d'établir une chaire d'anatomie et pathologie ou de mettre sur pied un centre de physiologie expérimentale à l’Université de Montréal –, le développement de la recherche est freiné par le manque de soutien moral, institutionnel et financier. Le contexte d'entre-deux-guerres, la crise économique et l'emprise religieuse sur les hôpitaux constituent autant d'obstacles à son essor.
La création d'instituts de recherche dans les années 1930-1960 semble jouer un rôle crucial pour la suite. En quoi ce modèle d'organisation s'avère-t-il si déterminant pour la Faculté de médecine?
Durant cette «ère des instituts», des cliniciens formés à l'étranger importent les modèles de recherche européens et américains. Avec l'appui d'organismes privés et publics, ils créent des centres comme l'Institut d'anatomie pathologique, l'Institut Armand-Frappier, l’Institut de médecine et de chirurgie expérimentale, l’Institut de cardiologie de Montréal et l’Institut de recherches cliniques de Montréal, tous rattachés à l’Université de Montréal. Ces instituts, d'envergure internationale, deviennent des pépinières pour former une nouvelle génération de chercheurs, accélérant ainsi le développement des activités scientifiques de la Faculté de médecine.
La Révolution tranquille marque un tournant avec la hausse du financement de la recherche. Quelles ont été selon vous les conséquences les plus significatives de ces nouvelles ressources sur le développement de la faculté?
La création du Fonds de recherche en santé du Québec au début des années 1960 transforme le paysage de la recherche. Ce financement public permet à la Faculté de médecine de recruter de jeunes chercheuses et chercheurs prometteurs et d'étendre ses lieux de recherche. Les hôpitaux affiliés mettent en place leurs propres structures de recherche, tandis que de nouvelles fondations contribuent à leur financement. Ces changements font de la faculté, dès les années 1980, un centre de recherche biomédicale d'envergure internationale.
Aujourd’hui, la Faculté de médecine est un joueur de premier plan en matière de recherche. Qu’est-ce qui a permis ce rattrapage?
Le succès actuel de la faculté repose sur de grandes équipes de recherche multidisciplinaires soutenues par des fonds publics et privés. Ces équipes, dotées d'installations modernes, mènent des programmes de recherche à long terme en privilégiant l'interdisciplinarité et les nouvelles technologies. Cette évolution remarquable résulte, d’une part, de la croissance et de la diversification des fonds de recherche et, d’autre part, des efforts concertés de plusieurs générations de chercheurs et de chercheuses. Aujourd'hui, tout en maintenant son excellence scientifique, la Faculté de médecine intègre une réflexion éthique sur les nouvelles questions biomédicales liées notamment à l’intelligence artificielle et à la surmédicalisation.