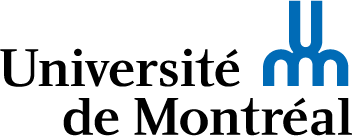Comment les jeunes détrans perçoivent-ils les discours sur la détransition?
- UdeMNouvelles
Le 18 mars 2025
- Virginie Soffer
Une étude menée auprès de 25 jeunes ayant détransitionné montre qu’ils se sentent très mal représentés dans les médias.
Alors que les discussions sur la détransition sont de plus en plus présentes dans l’espace médiatique, qu’en pensent les jeunes concernés?
Pour le savoir, des entretiens semi-dirigés ont été menés à l’échelle internationale de 2020 à 2022 auprès de jeunes âgés de 16 à 25 ans ayant interrompu une transition sociale ou médicale.
Cette étude a fait l’objet d’un article publié dans la revue Sexuality Research and Social Policy coécrit à l’Université de Montréal par Morgane Gelly, conseillère principale de recherche à l’École de travail social, Annie Pullen Sansfaçon, professeure à l'École de travail social, et Sidonie Atgé-Delbays, anciennement doctorante en sciences humaines appliquées. Cet article met en lumière des thèmes récurrents: un sentiment d’absence dans les représentations sociétales, une mauvaise représentation de leurs parcours et un effet négatif des discours dominants sur leur expérience.
Étudier ce que les jeunes pensent de la détransition
Pour réaliser cette étude, 25 jeunes qui ont fait une détransition ont été recrutés, c’est-à-dire «qu’ils sont partis d'un genre assigné à la naissance, ont fait une transition vers un autre genre et sont retournés vers leur genre assigné à la naissance ou s’identifient maintenant à un autre genre comme une identité plutôt non binaire», explique Annie Pullen Sansfaçon.
Ces jeunes vivent en Amérique du Nord, en Europe et en Indonésie. Huit avaient effectué une transition uniquement sociale, tandis que dix-sept avaient entrepris à la fois une transition sociale et une transition médicale.
La question centrale qui leur a été posée était: «Nous entendons de plus en plus parler de détransition dans les médias grand public. Quelle est votre perception des médias et de la représentation sociale de la détransition?» En complément, d’autres aspects ont été explorés, comme leur vision du genre, leur perception des parcours médicaux de transition et de l’accès aux soins.
«L’analyse thématique inductive était particulièrement importante pour garantir que toutes les voix soient entendues, sans imposer un cadre préconçu sur ce que devrait être la détransition», souligne Annie Pullen Sansfaçon.
«Cette approche nous a permis d’accueillir les récits des jeunes, qu’ils aient choisi de revenir à leur identité assignée à la naissance avec des regrets ou qu’ils se reconnaissent aujourd’hui dans une identité non binaire. Il était fondamental pour nous d’adopter une démarche antioppressive et affirmative du genre de la personne, quelle qu’elle soit», poursuit-elle.
Une représentation absente ou biaisée de la détransition
De nombreux jeunes interrogés ont déclaré ne jamais avoir entendu parler de détransition avant d’y être confrontés eux-mêmes. Certains ne savaient même pas qu’il existait de terme pour décrire leur expérience. Comme l’indique Morgane Gelly, «les participants et participantes nous ont dit qu’il existait très peu d’informations accessibles sur la détransition. Les ressources sur les façons d’entreprendre une détransition, en particulier pour les parcours médicaux, sont rares. Certains jeunes ont d’ailleurs participé à cette recherche pour faire avancer les connaissances sur le sujet».
Lorsqu’elle est abordée dans les médias, la détransition est souvent dépeinte sous un angle unique, on insiste sur le regret et la souffrance, au détriment de la diversité des parcours. «La narration dominante présente souvent la détransition comme un échec ou une erreur. Pourtant, les expériences sont bien plus nuancées. Certaines personnes s’identifient toujours comme trans, mais ont dû interrompre leur transition pour des raisons personnelles, financières ou médicales. D’autres, en revanche, remettent en question leur identité de genre», précise Morgane Gelly.
En parallèle, certains discours transaffirmatifs tendent à minimiser ou à nier l’existence de la détransition, la réduisant à une conséquence des pressions sociales ou de la transphobie.
Une instrumentalisation politique
Un autre enjeu soulevé est la politisation de la détransition par des groupes aux intérêts opposés. Certains mouvements critiques du genre exploitent ces récits pour discréditer les identités trans, tandis que d’autres cherchent à invisibiliser ces parcours pour ne pas alimenter des discours antitrans.
Theo, une des personnes interrogées, affirme ainsi: «Je suppose qu’il y a des gens qui essaient d’utiliser les personnes détrans comme des pions contre la transition, ce que les personnes trans ne méritent pas et que les personnes détrans ne méritent pas. Les seules personnes qui en bénéficient sont les politiciens de droite avec leurs guerres culturelles idiotes et personne d’autre, ce qui est, je pense, assez triste.»
Une injustice épistémique
Enfin, l’étude révèle une injustice épistémique, remettant en question les capacités des jeunes trans de se définir comme producteurs de savoir. Il y a une injustice testimoniale: la parole des jeunes détrans est souvent décrédibilisée. D’un côté, certains les considèrent comme influencés ou manipulés, leur refusant une capacité de choix. De l’autre, certains milieux trans les perçoivent comme des traîtres ou des exceptions.
«Dire que la détransition est toujours le résultat d’une erreur ou d’une contrainte revient à nier la diversité des expériences. Cela invisibilise les différents parcours et crée des injustices en termes de représentation dans la société qui ont des effets concrets sur la vie des gens», déclare Morgane Gelly.
Un besoin de représentation plus nuancée de la détransition
L’étude met donc en lumière un besoin de représentations plus nuancées de la détransition. Mieux comprendre ces parcours permettrait d’offrir un meilleur accompagnement aux jeunes concernés. En reconnaissant la diversité des expériences, il devient possible de construire un dialogue plus inclusif et respectueux de toutes les identités de genre.
«Par le passé, la vision de la transition des jeunes était très stéréotypée: on imaginait un parcours unique, souvent celui d’une personne blanche ayant recours à des soins médicaux, passant par l’hormonothérapie puis une chirurgie de réassignation. Or, les recherches récentes montrent que la transition est un phénomène bien plus diversifié. De la même manière, la détransition ne suit pas un schéma unique. Aujourd’hui, il est nécessaire de favoriser le dialogue entre les jeunes ayant vécu une transition et ceux ayant détransitionné afin de mieux comprendre leurs parcours et d’améliorer les pratiques, plutôt que de créer des divisions», conclut Annie Pullen Sansfaçon.
Un colloque sur ce sujet aura lieu à l’occasion du 92e Congrès de l’Acfas le 6 mai sur le thème «Transition et détransition chez les jeunes: comprendre et s'unir face à la désinformation et à la division».
À propos de cette étude
L'article «“They’re Unable to See my Decision to Detransition for What it is”: How Detrans Youth Perceive and Receive Discourses on Detransition», par Morgane Audrey Gelly, Sidonie Atgé-Delbays et Annie Pullen Sansfaçon, a été publié dans la revue Sexuality Research and Social Policy.