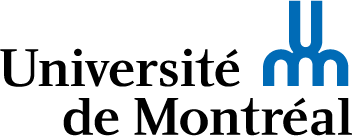De juge à travailleur frontalier
- UdeMNouvelles
Le 27 mars 2025
- Catherine Couturier
L’étudiante de doctorat Meritxell Abellan-Almenara explore la jurisprudence pour mieux comprendre comment les juges québécois gèrent le pouvoir d’interdiction du territoire pour motif de criminalité.
Un conflit qui dégénère, un coup donné avec un parapluie. Une dispute qui s’envenime et l'un des vis-à-vis qui tire les cheveux de l’autre.
Saviez-vous que pour les non-citoyens – qu’ils soient immigrants temporaires, étudiants étrangers ou même résidents permanents depuis plusieurs années – ce genre d’altercation peut entraîner la déportation? «Il y a des affaires qui ont fait scandale parce que quelqu’un peut être renvoyé dans un pays où il n’a passé que quelques jours. Certaines personnes, arrivées très jeunes au Canada, ignorent parfois qu’elles ne sont pas citoyennes et qu’elles s’exposent à ce genre de conséquence», illustre Meritxell Abellan-Almenara.
L’étudiante de doctorat en criminologie sous la direction de Chloé Leclerc et Karine Côté-Boucher, professeures à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, a voulu se pencher sur cette «double peine», travaux qui lui ont valu une bourse d’études supérieures du Canada Vanier. Les conclusions du premier volet de sa thèse viennent d’être publiées dans la revue Criminologie.
De grands pouvoirs dans les mains des juges
Adoptée après les attentats du 11 septembre 2001, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés impose depuis 2002 une interdiction d’entrer ou de rester sur le territoire canadien aux personnes qui ne sont pas citoyennes lorsqu’elles commentent un délit qui appartient à la catégorie dite de la «grande criminalité». S’il en est ainsi depuis plus de deux décennies, ce n’est qu’en 2013 que la Cour suprême a rappelé aux juges canadiens qu’ils devaient prendre en compte les conséquences en matière d’immigration lors de leurs décisions sur la détermination de la peine.
«Auparavant, la chose la plus sérieuse qu’un juge pouvait décider était de condamner quelqu’un à des années de prison. Depuis, on leur a indirectement ajouté le pouvoir de déporter quelqu’un et de lui interdire de revenir au pays. C’est un pouvoir qui dépasse largement celui d’envoyer un individu en prison qui, dans la plupart des cas, en sortira et sera réhabilité», résume l’étudiante. D’autant plus que, depuis 2013, la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers a restreint le droit des résidents permanents de faire appel de cette décision.
Mais tous les juges n’interprètent pas ce nouveau pouvoir de la même manière. La doctorante a voulu dans sa thèse décortiquer ce processus de réflexion. «Depuis que je suis toute petite, le raisonnement des juges me fascine. Leur raisonnement est comme une boîte noire», remarque Meritxell Abellan-Almenara. Étant donné les conséquences lourdes pour les personnes immigrantes, le sujet était d’autant plus pertinent, croit-elle.
Se plonger dans la jurisprudence écrite
Dans un premier temps, l’étudiante a utilisé la base de données CanLII, qui répertorie toutes les décisions rendues dans les tribunaux au Canada, en s’intéressant au Québec. Le corpus final comprenait 59 décisions en matière pénale faisant mention de la loi sur l’immigration.
La lecture de ces décisions lui a permis de répartir les juges dans deux groupes principaux (divisés chacun en trois sous-groupes), selon leur attitude quant à ce pouvoir de transformer la frontière. Certains juges acceptent ainsi ces nouvelles fonctions d’«agent frontalier» (borderworker) et utilisent ce pouvoir soit pour renforcer la frontière, soit au contraire pour éviter que la personne se fasse déporter.
«Les démanteleurs», d’abord, tentent d’éviter, d’atténuer ou de réduire au maximum les conséquences en lien avec l’immigration qui découlent de leur décision, et parfois de manière plutôt créative. «Une des façons de déterminer si le crime appartient à la catégorie de la grande criminalité, c’est la durée de la peine, qui est alors de plus de six mois. Ces juges vont donc imposer des peines sous cette barre, par exemple en donnant deux peines de six mois moins un jour au lieu d’une peine d’un an», dit Meritxell Abellan-Almenara. À l’inverse, d’autres juges («les constructeurs») semblent fiers de ce pouvoir et «s’en servent pour renforcer et étendre la frontière au-delà de ce qui est strictement prévu par la loi», indique-t-elle.
Entre les deux, la position d’«agent d’entretien» est la plus courante. «Ces juges acceptent de façon assez passive que leurs décisions aient des conséquences en matière d’immigration pour la personne et ne les prennent pas vraiment en considération dans la réalité», explique-t-elle.
L’autre grand groupe est celui des juges qui refusent ce nouveau rôle d’agent frontalier. Qu’ils soient dans le groupe des «sourds», des «muets» ou des «aveugles», ils font abstraction des conséquences possibles de leurs décisions sur la déportation. «Ces juges continuent de considérer qu’ils ont un rôle de décideur pénal et estiment que les questions d’immigration ne leur appartiennent pas. Cela n’empêche toutefois pas qu'il y aura des conséquences», avance-t-elle.
Outre cet examen des décisions écrites, les travaux de doctorat de la jeune femme comportent un deuxième volet, où elle mènera des entrevues avec des juges pour percer à jour le processus de réflexion derrière ce pouvoir qui a transformé la pénalité canadienne.
Soutenir des actions
Les crimes qui mènent à la déportation sont plus courants qu’on pourrait le penser. «Ce qu’on désigne comme de la grande criminalité, ce ne sont pas uniquement des meurtres en série, du terrorisme ou du trafic de drogue. Certains estiment que près de 75 % des actes définis par le Code criminel entrent dans cette définition», souligne Meritxell Abellan-Almenara. Un simple parapluie peut ainsi être considéré comme une arme, ce qui fait entrer l’acte dans la catégorie de la grande criminalité. «À mon avis, le concept a perdu tout son sens; c’est devenu tellement large», affirme-t-elle.
L’étudiante souhaite que ses travaux servent à la société civile et à la défense de ces personnes, dans un climat politique où les immigrants sont souvent montrés du doigt. Elle collabore d’ailleurs avec la clinique juridique Solutions justes. «On fait pression pour que soit présenté un projet de loi qui reconnaîtrait que la déportation est disproportionnée, surtout pour les résidents de longue durée. Ma thèse fournira des données empiriques pour soutenir cette démarche», espère-t-elle.
À propos de cette étude
L’article «La double peine des non-citoyens au Canada: étude des rôles des juges du système de justice pénale à la lumière des interdictions de territoire pour motif de criminalité», par Meritxell Abellan-Almenara, Chloé Leclerc et Karine Côté-Boucher, a été publié dans la revue Criminologie.