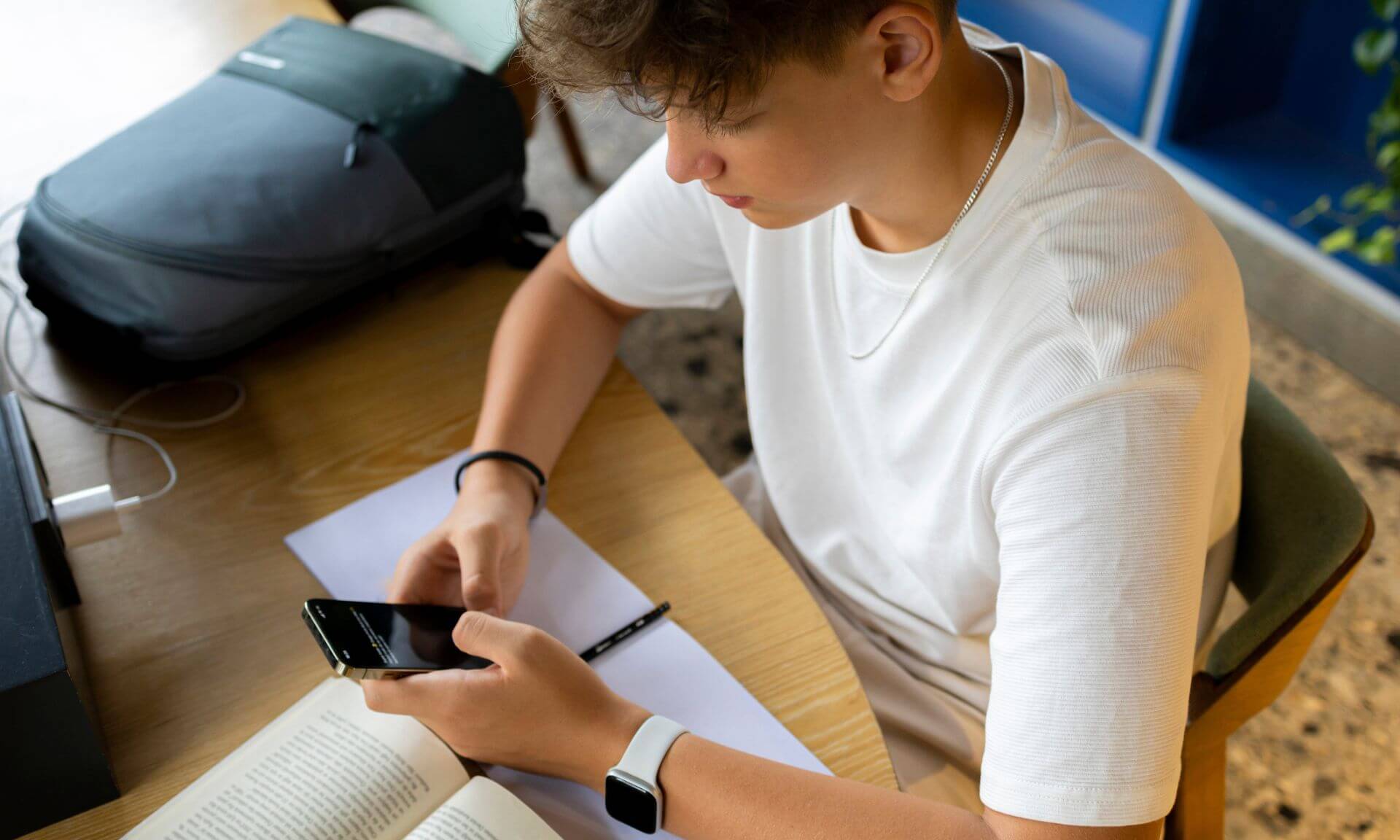La rétroaction corrective, un facteur clé de l'apprentissage d'une langue seconde

Selon vous, lequel de ces deux énoncés est correctement formulé?
1. Au fil des années, il apprenait à jouer du piano.
2. Au fil des années, il a appris à jouer du piano.
Si votre langue maternelle est le français, il y a de fortes chances que vous ayez fait la distinction entre l’imparfait et le passé composé et trouvé la bonne réponse. Mais pour ceux et celles qui apprennent le français langue seconde, c’est loin d’être évident!
Selon les études relatives à l’apprentissage d’une deuxième langue, l’enseignement basé sur les tâches, une approche qui privilégie la communication directe plutôt que les exercices répétitifs, soutient le développement langagier. Cette approche implique notamment que l’enseignant ou l’enseignante donne une rétroaction corrective à ses élèves.
Mais à quel moment doit-on donner cette rétroaction afin qu’elle soit optimale pour l’acquisition de la nouvelle langue?
C’est ce qu’a voulu élucider le professeur Gabriel Michaud, de la Faculté des sciences de l'éducation de l’Université de Montréal, dans un projet de recherche dont les résultats seront publiés dans l’édition de juin de la revue System.
Rétroaction en direct ou différée… telle est la question!

L’objectif de Gabriel Michaud était d’examiner comment les différences individuelles, entre autres la mémoire de travail et l'aptitude linguistique, agissent sur l'efficacité des rétroactions immédiates et différées dans des tâches d'écriture collaborative.
Pour ce faire, il a recruté 76 étudiants et étudiantes d’université apprenant le français de niveau B1 (utilisateur indépendant) qu’il a répartis en trois groupes distincts. Le premier groupe recevait des corrections immédiates pendant l'écriture via Google Docs, le deuxième groupe recevait le même type de rétroaction écrite, mais au cours suivant une semaine plus tard, tandis que le dernier groupe ne bénéficiait d'aucune rétroaction.
L'idée consistait à vérifier si ces nouveaux outils numériques qui rapprochent l'écriture et la correction peuvent améliorer la qualité de la rétroaction et sa prise en compte par l'élève.
«De façon générale, la rétroaction corrective immédiate semble avoir un effet bénéfique sur l’apprentissage, mais la complexité des structures de la langue joue sur l’efficacité de la rétroaction selon le moment où celle-ci est donnée, explique-t-il. Par exemple, pour les structures plus complexes, comme la distinction entre le passé composé et l'imparfait, une rétroaction immédiate s’avère plus efficace parce que le contexte de l’apprentissage est plus clair aux yeux des apprenants.»
La mémoire de travail: un facteur déterminant
Selon Gabriel Michaud, l’étude permet de mieux comprendre l'influence de la mémoire de travail. «Nous avons observé un effet significatif de la rétroaction immédiate chez les élèves qui ont une plus grande mémoire de travail, qui sont davantage en mesure de comprendre les commentaires et de mieux assimiler les éléments de la rétroaction», souligne-t-il.
De fait, dans le groupe bénéficiant d'une rétroaction immédiate, les apprenants devaient simultanément planifier, écrire, réviser et traiter les corrections. Et cette tâche complexe avantage ceux qui disposent d'une bonne mémoire de travail. À l’opposé, lorsque la rétroaction était donnée en différé, son traitement étant séparé de l'écriture, la charge cognitive était réduite, ce qui nivelle davantage les différences individuelles.
«Cette découverte remet en question l'approche universelle souvent adoptée dans l'enseignement des langues et laisse entendre qu'une personnalisation des stratégies pédagogiques en fonction des profils cognitifs pourrait optimiser l'apprentissage», estime-t-il.
L'aptitude linguistique: un atout parfois trompeur
En contrepartie, l'étude révèle que l'aptitude linguistique a été un prédicteur négatif dans le groupe recevant une rétroaction différée. Les personnes avec une forte aptitude analytique ont parfois obtenu des résultats moins bons que leurs pairs.
Ce résultat paradoxal pourrait s'expliquer par une tendance à la sursimplification des règles grammaticales complexes. Par exemple, les distinctions entre le passé composé et l'imparfait en français nécessitent une compréhension contextuelle qui va au-delà des règles explicites.
«Ce n'est pas facile de faire comprendre la différence entre ces deux temps de verbe, indique Gabriel Michaud. C'est intuitif pour les gens dont la langue maternelle est le français, mais difficile à expliquer aux apprenants, car l’enseignant essaie de schématiser avec des règles simples qui ne permettent pas de saisir toute la subtilité du phénomène.»
L'écriture collaborative comme levier d'apprentissage
La méthodologie de cette recherche met également en lumière l'efficacité de l'écriture collaborative dans l'apprentissage des langues.
Dans l’une des expériences réalisée pendant le projet de recherche, les participants travaillaient en binômes pour rédiger des textes inspirés par des courts métrages. Dans le groupe recevant une rétroaction immédiate, les duos rédigeaient ensemble sur Google Docs tandis que l'enseignant passait virtuellement d'un document à l'autre pour fournir des corrections en temps réel, créant ainsi un véritable dialogue pédagogique.
«Cela a permis de démontrer que l'écriture collaborative en langue seconde facilite l'apprentissage grâce à l'entraide entre les binômes, illustre-t-il. L'étayage collectif est supérieur à ce qu'on peut faire individuellement, puisque cette approche permet non seulement de répartir la charge cognitive, mais aussi d'encourager la négociation et l'échafaudage entre pairs.»
Des applications possibles dans l'enseignement des langues
Selon Gabriel Michaud, cette étude offre plusieurs pistes pour améliorer les pratiques pédagogiques. «Le message principal est que la présence active de l'enseignant ou de l’enseignante pendant le processus d'écriture contribue davantage à l'apprentissage que la simple correction du produit final», résume-t-il.
Les résultats font également ressortir l’intérêt d’une approche plus nuancée de la rétroaction corrective. «Pour éviter la surcharge cognitive, les enseignants devraient doser leurs interventions, conclut le professeur. Si la rétroaction est immédiate, mieux vaut y aller modérément et cibler certaines erreurs, puis revenir avec une deuxième rétroaction plus tard pour les éléments plus difficiles.»