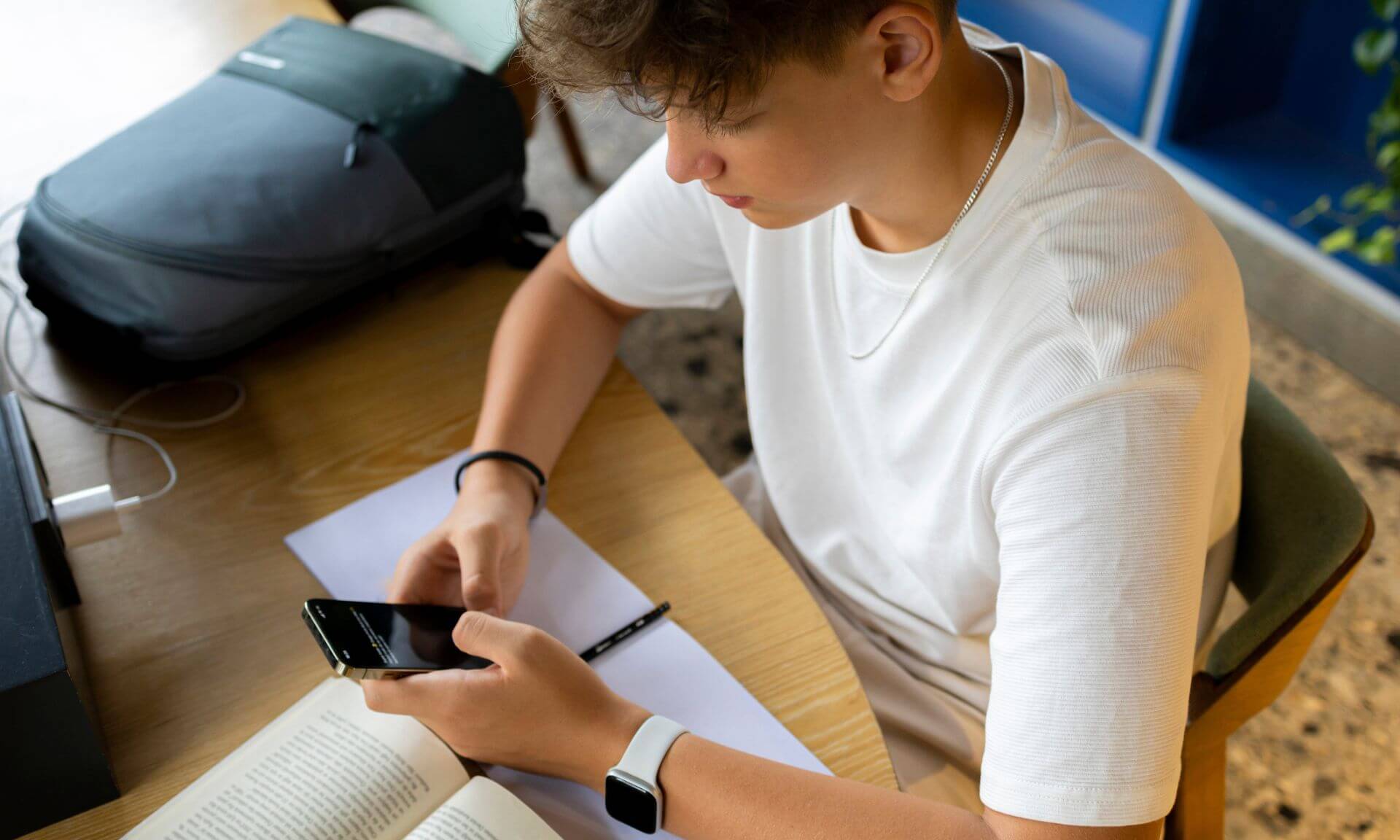Pour l’amour de la langue

L’ambiance était fébrile au pavillon Marie-Victorin en ce dernier jour de session. Le colloque des finissantes et finissants des programmes de baccalauréat en éducation de l’Université de Montréal, qui s’est déroulé le 30 avril, a pris la forme d’une présentation par affiches de plus d’une centaine de projets sur une foule de sujets, de la zoothérapie à l’enseignement en plein air en passant par les effets du jeu de rôle sur l’enseignement de l’histoire.
Ces travaux (qui comptaient pour deux crédits) ont permis aux étudiants et étudiantes d’explorer plus en profondeur des questions soulevées durant leurs stages. Quelques-uns se sont intéressés à la qualité de la langue française et à la façon d’en faire la promotion en classe. «On retrouve la langue française dans toutes les matières; c’est donc quelque chose de très important à travailler», souligne Rhoccïlus Choute, finissant au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement du primaire (BEPEP) de la Faculté des sciences de l'éducation.
La dictée métacognitive, une méthode innovante

«Nous nous sommes rendu compte que la compétence à l’écrit en français était lacunaire chez plusieurs élèves de 5e secondaire; au moins la moitié ne la maîtrisaient pas», raconte Sarah Marcotte, finissante au BEPEP. Cette statistique alarmante l’a poussée, avec son équipe (Victoria Yip, Rhoccïlus Choute et Karine St-Laurent), à se pencher sur cet aspect de l’apprentissage du français. «Il faut agir dès le primaire», précise-t-elle.
L’équipe a décidé de tester deux types de dictées métacognitives pour observer leur effet sur le taux de réussite de leurs classes de 3e et 4e année du primaire. «La dictée métacognitive est au service de l’apprentissage. Le but est que les élèves comprennent pourquoi ils font des erreurs», résume Rhoccïlus Choute.
La dictée zéro faute, d’abord, combine la lecture d’un court texte suivie d’une période de questions où la réflexion des élèves est encouragée. La dictée phrase du jour, quant à elle, consiste en une seule phrase lue par l’enseignante ou l’enseignant; les élèves doivent par la suite se consulter pour consigner les différentes manières de l’écrire. Les variantes sont finalement reportées au tableau et utilisées afin de poursuivre la discussion.
Les connaissances limitées des jeunes à ce stade de leur parcours scolaire ont parfois rendu difficile l’exercice, qui s’est avéré tout de même positif. L’équipe a ainsi noté une certaine amélioration des résultats après l’utilisation de ces deux types de dictées métacognitives, malgré les limites de l’étude (petits échantillons, élèves absents, etc.). «Ça permet non seulement aux élèves de réfléchir sur leur écriture et de mobiliser les stratégies qu’ils ont vues en classe, mais aussi aux enseignants d’adapter leurs méthodes pédagogiques et de voir ce que les enfants ont compris de la matière», confie Victoria Yip. «Les élèves réfléchissaient davantage à la qualité de leur écriture», poursuit Sarah Marcotte. Un succès en soi.
Le français, source de plaisir

Pour améliorer la qualité de la langue, la motivation est un enjeu primordial. Un manque de motivation peut, à terme, avoir des conséquences importantes: selon le ministère de l’Éducation, 25 % des jeunes de 6e année risquaient l’échec en 2008.
«On remarquait dans nos stages que les enseignants recouraient peu à la littérature jeunesse et, en parallèle, que l’intérêt des élèves pour le français était moins grand qu’avant», relate Amanda Rioux. Et si la littérature jeunesse devenait une source de motivation? C’est ce qu’elle et son équipe du BEPEP (Camille Bourgon et Maïlyss Carvin) ont voulu tester.
Les trois futures enseignantes ont comparé deux périodes d’enseignement, l’une qui faisait appel à une activité papier-crayon, l’autre qui se basait sur la littérature jeunesse. Leurs trois stages se déroulaient dans des classes différentes (1re, 3e et 6e année du primaire) et dans des milieux socioculturels diversifiés. Si l’utilisation de la littérature jeunesse s’est avérée positive quant à l’engagement de leurs élèves, «ce n’est pas une solution magique. Ce n’est pas parce qu’on lit un livre à des élèves qu’ils vont être plus motivés», constate Camille Bourgon.
Même si les résultats de cette recherche sont limités, étant donné l’échantillon restreint, elle donne quelques pistes à l’équipe sur la façon d’utiliser la littérature jeunesse dans leurs classes. «La grande conclusion, c’est qu’on ne peut pas juste se servir d’un livre de littérature jeunesse pour susciter à coup sûr l’engagement. Oui, c’est un bon moyen, mais ça dépend de l’exploitation qui en est faite», résume Maïlyss Carvin.
Apprendre en s’autocorrigeant
Durant leurs stages dans des classes de 1er et 5e secondaire, Kate Christin et sa collègue Rosemarie Coursol, du baccalauréat en enseignement du français au secondaire, sont arrivées à un constat: «Les erreurs que j’observais en 1re secondaire étaient les mêmes que celles que Rosemarie voyait en 5e secondaire. Il n’y a pas d’amélioration, d’évolution, les élèves refont constamment les mêmes erreurs», relate Kate Christin.
Une revue de la littérature a mis en lumière quelques pistes, notamment le manque d’habiletés dans l’utilisation des ouvrages de référence. «Les élèves n’accordent pas suffisamment de temps à la période de correction dans des évaluations et ne maîtrisent pas leurs stratégies d’autocorrection; ce ne sont pas des automatismes», ajoute-t-elle.
En combinant la dictée zéro faute et l’écriture collaborative, les futures enseignantes ont créé une séquence didactique alliant stratégies d’autocorrection et travail d’équipe. «L’objectif était de travailler la collaboration, mais surtout de stimuler la métacognition entre les élèves pour qu’ils se posent plus de questions et qu’ils apprennent de leurs erreurs ou des questions des autres», indique Rosemarie Coursol. Dans deux classes de 5e secondaire sur trois, elle a pu observer une réduction des erreurs dans l’écriture d’une courte lettre ouverte. «Le fait de réviser avec un pair ajoute peut-être une pression sociale pour essayer de s’améliorer», évoque-t-elle.