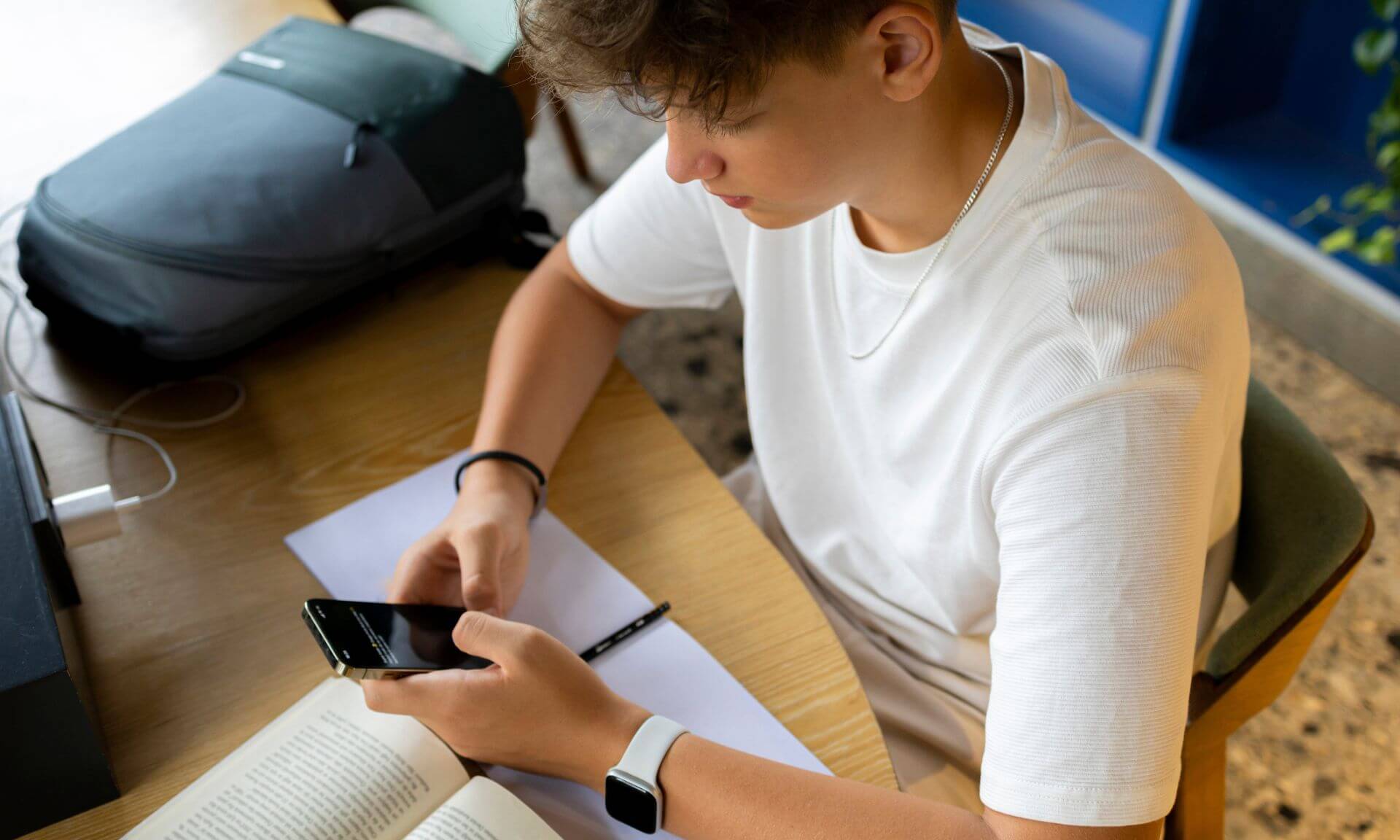Depuis neuf ans, Éric Morissette parcourt les écoles du Québec avec la mission d’améliorer le climat scolaire. Son approche directe et concrète a été adoptée par plus de 15 000 personnes – des communautés enseignante et non enseignante – dans les écoles primaires et secondaires de la province.
Son mandat consiste à nouer des partenariats pour accompagner les directions d'école et leur personnel dans l'amélioration du climat dans les établissements scolaires. Seulement en septembre, il a donné des conférences auxquelles ont participé environ 2000 enseignants et enseignantes.
«Mon intervention donne de meilleurs résultats sur le plan de la diffusion que si j'avais écrit un livre sur le sujet», affirme le professeur de formation pratique à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal.
Son approche privilégie le contact direct plutôt que la théorie abstraite. Depuis 2016, tout au long de l’année scolaire, il prononce une vingtaine de conférences d'une durée de deux à trois heures afin de créer un pont entre la recherche universitaire et la pratique quotidienne en milieu scolaire. Cette méthode permet à la Faculté des sciences de l’éducation de l’UdeM de répondre aux besoins des équipes éducatives.
Les écoles qui bénéficient de ses services ne sont pas sélectionnées au hasard: ce sont les directions elles-mêmes qui font appel à Éric Morissette, ce qui témoigne d'une demande réelle sur le terrain. Par la suite, il travaille en accompagnement des comités éducatifs de ces écoles afin d’élaborer un plan d'action et, surtout, de le mettre en œuvre de manière concrète et mesurable.