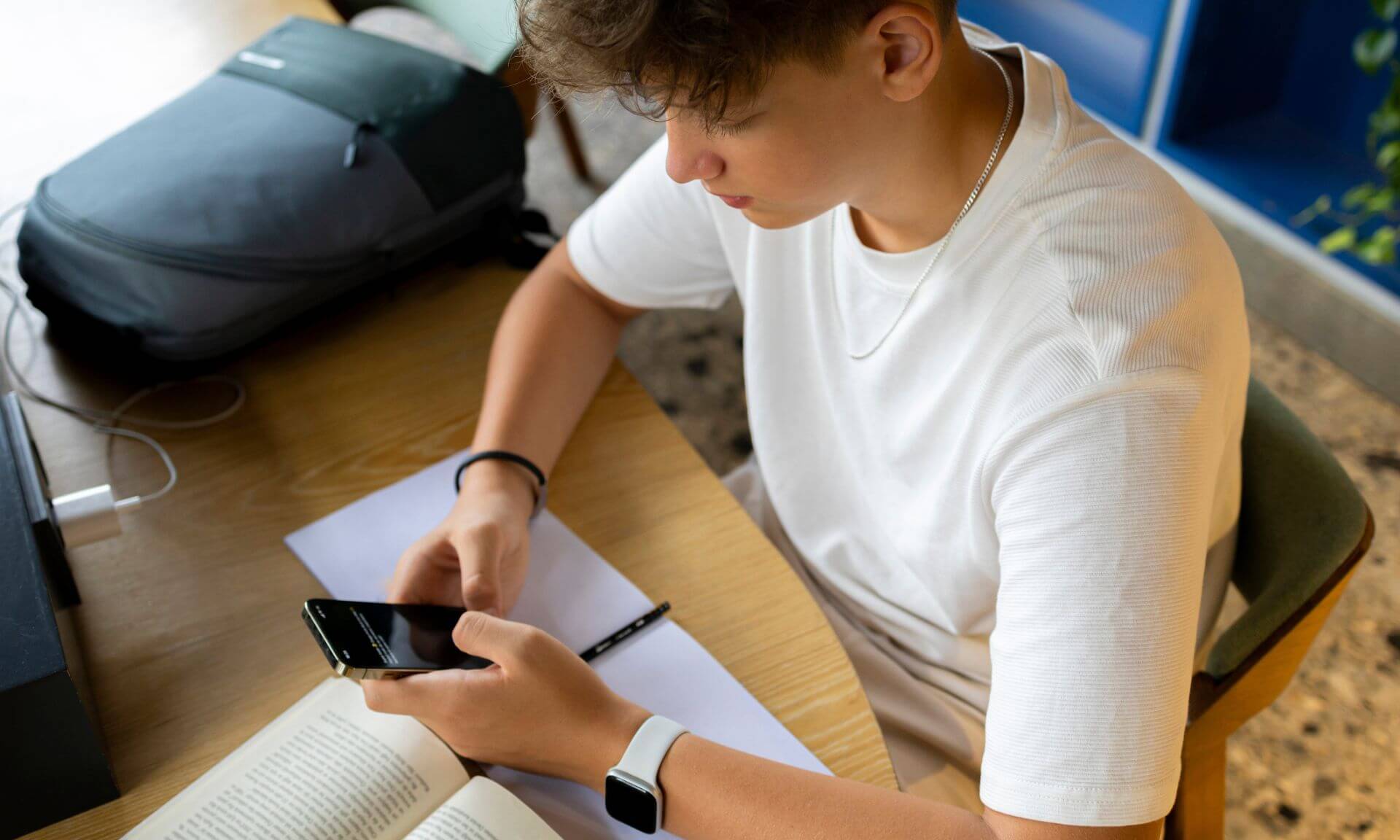Laïcité inclusive à l'école: des chercheuses plaident pour le dialogue et la diversité

Tandis que s’amorcera sous peu l’étude article par article du projet de loi no 94 visant à renforcer la laïcité dans le réseau de l’éducation québécois, un groupe de recherche spécialisé en éducation lance un appel à la nuance: dans un mémoire déposé auprès du Comité d’étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’État et sur les influences religieuses, il met en doute la nécessité des nouvelles mesures prévues et plaide pour une approche inclusive qui valorise la diversité religieuse à l'école.
Ce mémoire est le fruit d’une réflexion menée par l'équipe Inclusion et diversité ethnoculturelle en éducation (IDEE), composée de neuf chercheuses, dont les professeures Marie-Odile Magnan et Julie Larochelle-Audet, du Département d'administration et fondements de l'éducation de l'Université de Montréal, et de plus de 50 étudiantes et étudiants de diverses universités québécoises.
D’entrée de jeu, les auteures précisent que leur mémoire «ne remet pas en question les principes fondamentaux de la laïcité, mais propose une vision où celle-ci devient un levier pour construire une société plus juste et inclusive».
Un manque de transparence qui alimente un narratif construit

La formule actuelle du projet de loi no 94, Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l’éducation et modifiant diverses dispositions législatives, «va non seulement à l’encontre de la littérature scientifique sur le sujet, mais le gouvernement ne dispose pas de données prouvant la nécessité de renforcer la Loi sur la laïcité de l’État, qui prévoit déjà des balises», déplore Marie-Odile Magnan.
Julie Larochelle-Audet partage cette préoccupation. «Nous avons de la difficulté à voir le problème que le projet de loi prétend vouloir régler, affirme-t-elle. Le projet de loi repose largement sur des données non publiques et compromet certains piliers éducatifs du Québec, dont le droit à l'égalité des chances et la socialisation.»
L’équipe IDEE se questionne particulièrement sur le fait que le gouvernement s’appuie sur l’affaire de l’école Bedford, à Montréal, afin de justifier le renforcement de la laïcité pour l’ensemble des écoles au Québec.
«Le rapport officiel qui a suivi l'enquête dans ce dossier a mis en évidence un conflit de travail et des manquements à la Loi sur l'instruction publique, mais il ne révèle aucun manquement à la Loi sur la laïcité de l’État, souligne Julie Larochelle-Audet. De même, un seul manquement à cette loi a été clairement établi par le rapport sur 17 autres écoles.»
Elle note par ailleurs l’inaccessibilité des données issues du terrain qui ont mené à la rédaction du rapport ainsi que sur la nature des plaintes ayant conduit à l’ouverture des enquêtes. «Selon certaines sources, les manquements invoqués sont essentiellement d'ordre administratif», dit-elle.
Les chercheuses s'inquiètent ainsi de la construction d'un narratif de «manquements à la laïcité» basé sur des rapports limités et des données incomplètes, «ce qui soulève des questions sur la réalité et l'ampleur du problème allégué».
Les effets pervers de la Loi sur la laïcité de l’État
Une partie significative du mémoire analyse les conséquences négatives de la Loi sur la laïcité de l'État, adoptée en 2019. Cette loi, qui interdit le port de signes religieux aux employés de l'État en position d'autorité, est critiquée pour ses effets discriminatoires, particulièrement envers les femmes musulmanes.
«Nous sommes préoccupées par l'effet d'exclusion et de discrimination que le projet de loi pourrait entraîner, explique Julie Larochelle-Audet. Le modèle valorisé par le gouvernement a eu pour conséquence d'accroître le sentiment d'exclusion des enseignantes concernées et de jouer sur leur sentiment d'appartenance à la société québécoise.»
En revanche, les recherches citées dans le mémoire montrent qu’il existe une solidarité du milieu scolaire envers les enseignantes portant le voile. «D'ailleurs, pour ce qui est du port de signes religieux en classe, aucune donnée ne démontre qu'il aurait un effet négatif sur les élèves», précise Marie-Odile Magnan.
Julie Larochelle-Audet ajoute qu’il «n'existe, à notre connaissance, aucun cas attesté de prosélytisme par un ou une membre du personnel scolaire qui porte un signe religieux».
Les études citées dans le mémoire démontrent que la prise en compte de la diversité religieuse, comme de la diversité linguistique d’ailleurs, a un effet positif sur l'engagement et le rendement scolaire des élèves. «La religiosité pourrait même agir comme un facteur de protection contre la radicalisation des jeunes et le sentiment d'isolement», font valoir les auteures.
Le mémoire défend aussi les accommodements raisonnables comme un outil essentiel pour assurer le droit à l'égalité, protégé par la Charte des droits et libertés de la personne, et corriger les formes indirectes de discrimination, comme celles découlant d'un calendrier scolaire basé sur la tradition chrétienne. À ce chapitre, les auteures proposent d’améliorer la formation offerte aux gestionnaires scolaires en matière d’accommodements.
Pour une laïcité inclusive
«Avant 2019, nous vivions dans une laïcité ouverte qui favorisait l'inclusion et qui ne s’appuyait pas sur le repli identitaire, fait observer Marie-Odile Magnan. C’est pourquoi l’équipe IDEE demande le retrait du projet de loi no 94, car il n'existe pas de preuve empirique pour appuyer son objectif.»
«Nous avons besoin de plus de données et de réaliser davantage d'études sur le sujet, car le gouvernement n'a pas fait ses devoirs quant aux conséquences du renforcement de la laïcité, notamment en milieu éducatif, conclut Julie Larochelle-Audet. Nous voulons rappeler le rôle de l'école, qui est un lieu d'apprentissage de la laïcité, du vivre-ensemble, et nous ne voulons pas que ces apprentissages soient brimés par cette loi.»