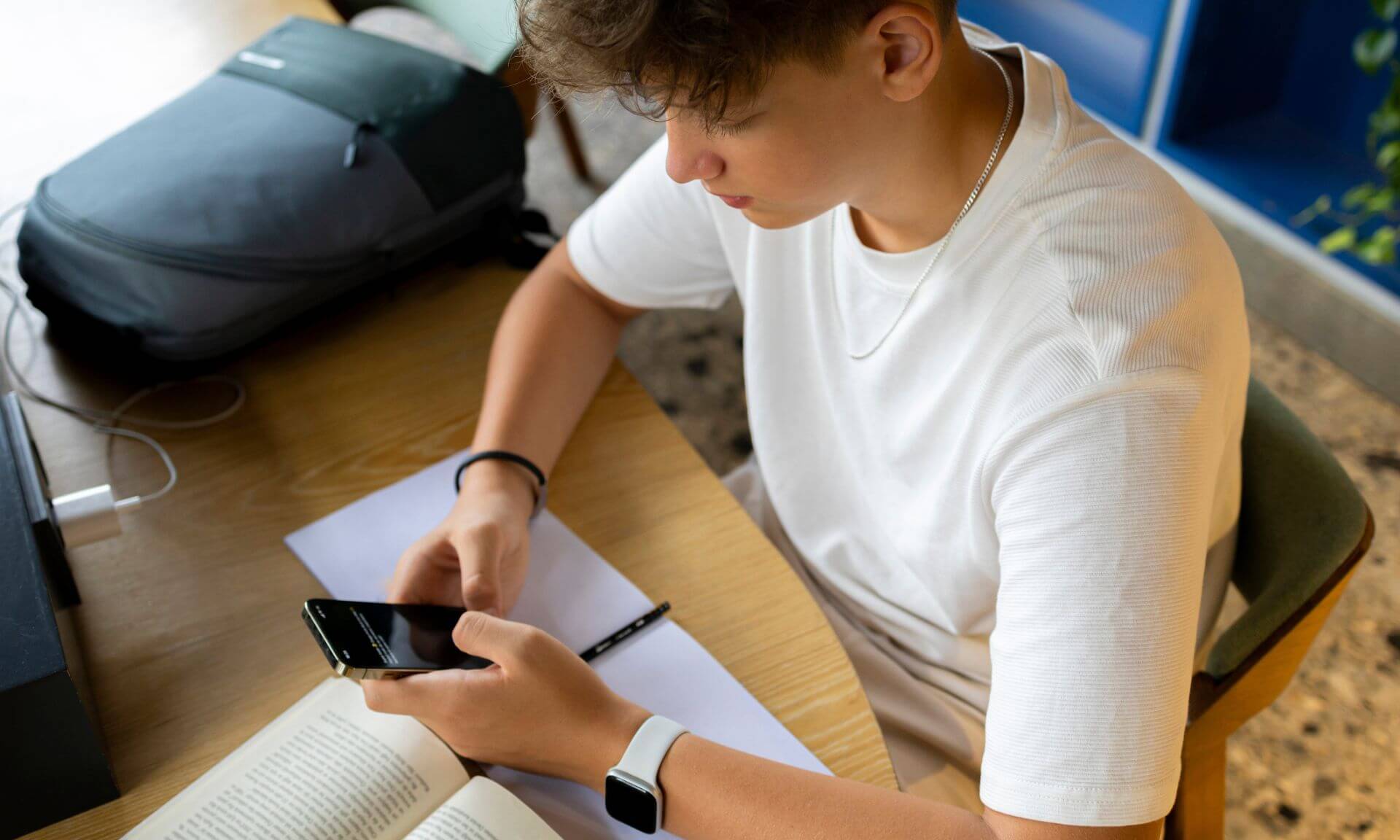Des années scolaires 2020-2021 à 2024-2025, le nombre d’agressions recensées dans les écoles montréalaises est passé de 60 à 107. Au cours de la même période, un jeune sur cinq arrêté pour terrorisme en Europe avait moins de 18 ans.
Devant cette réalité, quatre experts réunis le 12 novembre à l'Université de Montréal ont croisé leurs regards sur un phénomène qui déborde largement les murs de l'école.
Animé par la journaliste Maude Goyer, ce grand entretien de la Faculté des sciences de l'éducation (FSE) a rassemblé Diana Miconi et François Bowen, professeurs au Département de psychopédagogie et d'andragogie, Isabelle Ouellet-Morin, professeure à l'École de criminologie, et Fady Dagher, directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Leur constat: la violence en milieu scolaire est d'abord un problème collectif et systémique.
Comprendre pour mieux intervenir
Selon Diana Miconi, l'intimidation se définit par des actes répétés qui nuisent à une personne dans un contexte de déséquilibre des pouvoirs, souvent motivés par la haine. Isabelle Ouellet-Morin a ajouté que la victime vit une grande détresse, aggravée par un sentiment d'impuissance. François Bowen a précisé que «toute forme de violence n'est pas de l'intimidation, même si toute violence est intentionnelle et vise à atteindre quelqu'un, que ce soit socialement, psychologiquement ou physiquement».
Le professeur a ainsi distingué l'agressivité proactive – calculée, répétée et recourant aux habiletés sociales pour nuire – de l'intimidation réactive, marquée par l'impulsivité et un répertoire limité de réponses sociales. «Sur le plan éducatif et en intervention, ça permet de savoir sur quoi travailler», a-t-il dit. Dans les deux cas, le renforcement d'apprentissages socioémotionnels s'impose. Les plus jeunes sont généralement plus réactifs, alors que les adolescents adoptent davantage de comportements proactifs.
Isabelle Ouellet-Morin a insisté sur la dimension multisystémique des facteurs de risque. Il peut s’agir «de violence familiale, d’un historique de violence dans le quartier, de normes sociales qui encouragent ou découragent certains comportements… Ça va au-delà des personnes», a-t-elle souligné.
Fady Dagher a complété le tableau en rappelant que les chiffres des agressions dans les écoles montréalaises comprennent les voies de fait, les agressions sexuelles et les vols qualifiés. Il a déploré l'absence de coordination entre le ministère de l'Éducation et les services policiers dans le partage de ces données et s'est interrogé sur le rôle des policiers sociocommunautaires présents dans les écoles depuis 1998, «qui jouent parfois un rôle de travailleurs sociaux qu'ils ne devraient pas assumer».
De nouveaux visages de la violence
La violence en milieu scolaire revêt aujourd'hui des formes qui inquiètent particulièrement les spécialistes.
Diana Miconi a parlé de la montée des violences idéologiques et extrémistes, un phénomène mondial qui «force à essayer de comprendre ce qui est au-delà des jeunes, ce qui est plus large, systémique». Les motifs d'intimidation peuvent être multiples – timidité, différence physique, identité de genre, orientation sexuelle, origines ethniques, religion –, mais ils s'inscrivent toujours dans un environnement qui les favorise ou non.
Fady Dagher a évoqué le cas des jeunes radicalisés du Collège de Maisonneuve il y a une dizaine d'années. Il a relaté que «ces 17 jeunes sans antécédent, bénévoles et performants» avaient basculé vers l'État islamique notamment après avoir vu leurs mères marginalisées par un politicien populiste de la région de Québec. «Dans l'esprit du jeune, comment il se déprogramme pour se reprogrammer vers la radicalisation?» a-t-il demandé. Il a rappelé que ce phénomène mondial touche également Marseille, où des enfants soldats sont manipulés par des réseaux criminels. «On fait de bonnes choses, mais il faut innover différemment pour atteindre les jeunes qui restent insensibles à nos interventions», a-t-il plaidé.
La cyberintimidation constitue un autre visage préoccupant de la violence. Celle-ci s'est déplacée de la cour d'école vers l'univers virtuel, avec une banalisation inquiétante du transfert d'images et de sextos. Le SPVM envisage de créer un poste de patrouille virtuelle pour surveiller cet «angle mort devenu un fléau».
François Bowen y a toutefois vu un moyen pour s’adresser aux parents, puisque la cyberintimidation relève des habitudes de vie à l'extérieur de l'école. Diana Miconi a cependant mentionné que la cyberintimidation «n'est pas un monde à part, mais est liée à la violence quotidienne». Isabelle Ouellet-Morin a insisté pour sa part sur ses effets à long terme. «Ce n'est pas juste un problème transitoire de jeunes, c'est une expérience difficile dont les conséquences vont durer longtemps, parfois tout au long de la vie», a-t-elle soutenu.