Le métier de technicien en scène de crime attire peu les aspirants policiers

Les techniciennes et techniciens en scène de crime (TSC) sont les artisans de l’ombre des enquêtes policières. Au Québec, ces professionnels sont des policières et policiers assermentés, formés pendant trois ans en Techniques policières, puis à l’École nationale de Police du Québec avant de se spécialiser dans le domaine au Collège canadien de police. Mais qui rêve vraiment de ce métier?
Il semble que l’intérêt des futurs constables pour ce poste est non seulement faible, mais qu’il décline au fil de leur formation, selon une étude réalisée par Vincent Mousseau, maintenant chercheur postdoctoral au Centre for Forensic Science de l’Université technologique de Sydney, alors qu’il était étudiant au doctorat en criminologie, avec Annie Gendron, de l’École nationale de police du Québec et les professeurs Rémi Boivin et Frédéric Ouellet, de l’École de criminologie de l’Université de Montréal.
Publiée récemment dans la revue Science & Justice, l’étude longitudinale a permis de suivre 300 étudiantes et étudiants issus de 12 cégeps et inscrits en techniques policières, du début de leur programme en 2019 à la fin en 2022.
Interrogés à trois reprises pour savoir quel métier professionnel ils aimeraient occuper dans les 10 prochaines années, seuls 26,4 % à 34,3 % d’entre eux envisageaient de devenir technicien ou technicienne en scène de crime. Un score qui place ce métier entre la 6e et la 9e position sur dix postes possibles, loin derrière celui d’enquêteur ou enquêteuse (78,7 %) et tout juste devant celui de patrouilleur ou patrouilleuse à cheval ou à moto.
Un intérêt qui décline avec le temps

Les données indiquent qu’en général, l’intérêt des aspirantes et aspirants policiers chute entre la deuxième et la troisième année de formation, coïncidant avec l’introduction d’un cours sur les scènes de crime.
«Le contenu théorique ne semble pas susciter l’enthousiasme, au contraire, note Rémi Boivin. Ce déclin pourrait s’expliquer par la confrontation entre les attentes idéalisées des recrues et la réalité technique et méthodique du métier.»
L’étude met aussi en lumière une différence selon le genre: si les femmes montrent initialement un intérêt plus marqué (3,02 sur 5) que les hommes (2,41), leur enthousiasme s’érode rapidement, tombant à 2,37 en troisième année, soit près de l’équivalent de l’intérêt affiché par les hommes, lequel reste relativement stable tout au long du programme d’études.
Un intérêt qui peut néanmoins varier dans le temps
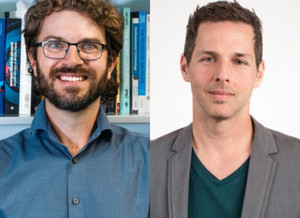
Si les résultats indiquent que 50 % des jeunes ayant pris part à l’étude maintiennent un intérêt stable à l’endroit du métier de TSC, cet intérêt diminue pour 30 % d’entre eux, tandis qu’il augmente pour ceux qui composent le 20 % restants.
«Certains arrivent avec une idée claire et ne changent pas d’avis, tandis que d’autres découvrent une passion inattendue», nuance Rémi Boivin.
Cependant, l’étude montre que les recrues les plus intéressées à devenir expertes en scène de crime, au départ, sont aussi les plus susceptibles de manifester une baisse d’intérêt pour la spécialisation avec le temps. Un paradoxe qui remet en cause l’utilisation de l’intérêt initial comme critère de recrutement.
«Cela montre que l’intérêt est dynamique et ne devrait peut-être pas être considéré comme un indicateur fiable à long terme», ajoute Vincent Mousseau.
Pourquoi le désamour envers une carrière de TSC est-il si grand?
Selon l’équipe de recherche, le problème vient en partie du recrutement généraliste en techniques policières, dans les cégeps.
«On forme des policiers et policières généralistes, un peu comme des couteaux suisses, mais les techniciens et techniciennes en scène de crime ont besoin d’acquérir des compétences spécifiques», souligne Rémi Boivin.
«Les jeunes arrivent avec des idées romantiques, inspirées des séries télé, mais la réalité les rattrape, ajoute Vincent Mousseau. Le métier de TSC, qui est technique et méthodique, est loin de l’action spectaculaire des écrans.»
Vers une nouvelle approche du recrutement
Parmi les suggestions qu’elle propose afin d’améliorer le recrutement des futurs agents et agentes de police, l’équipe de recherche estime qu’on devrait offrir des stages pratiques dès la première année du programme en techniques policières pour démystifier le métier de technicien ou technicienne en scène de crime.
«Si les recrues voient tôt à quoi ressemble une scène de crime, elles pourront faire un choix éclairé, suggère Rémi Boivin. Ensuite, on pourrait revoir les programmes de formation pour inclure plus de contenu sur l’investigation criminalistique, tout en donnant plus d’information relative à la réalité du métier, loin des clichés hollywoodiens.»
Compte tenu de l’intérêt limité des aspirantes et aspirants policiers, l’équipe s’interroge également sur la possibilité de recruter dans la population civile plutôt que dans les rangs policiers, afin d’élargir le bassin de candidatures pour certains postes spécialisés, dont celui de technicien ou technicienne en scène de crime.
«Dans certaines villes du Québec, comme Trois-Rivières, et ailleurs dans le monde, des techniciennes et techniciens en scène de crime non policiers sont déjà intégrés», rappelle Vincent Mousseau.
Selon MM. Boivin et Mousseau, leur recherche offre une base solide pour repenser la façon dont on forme et recrute les personnes qui, dans l’ombre, font parler les indices. «Il ne s’agit pas de recruter seulement des techniciennes et techniciens en mesure d’utiliser des outils, mais des gens passionnés capables de repérer et de prélever des indices qui pourront être transformés en preuves scientifiques», concluent-ils.



