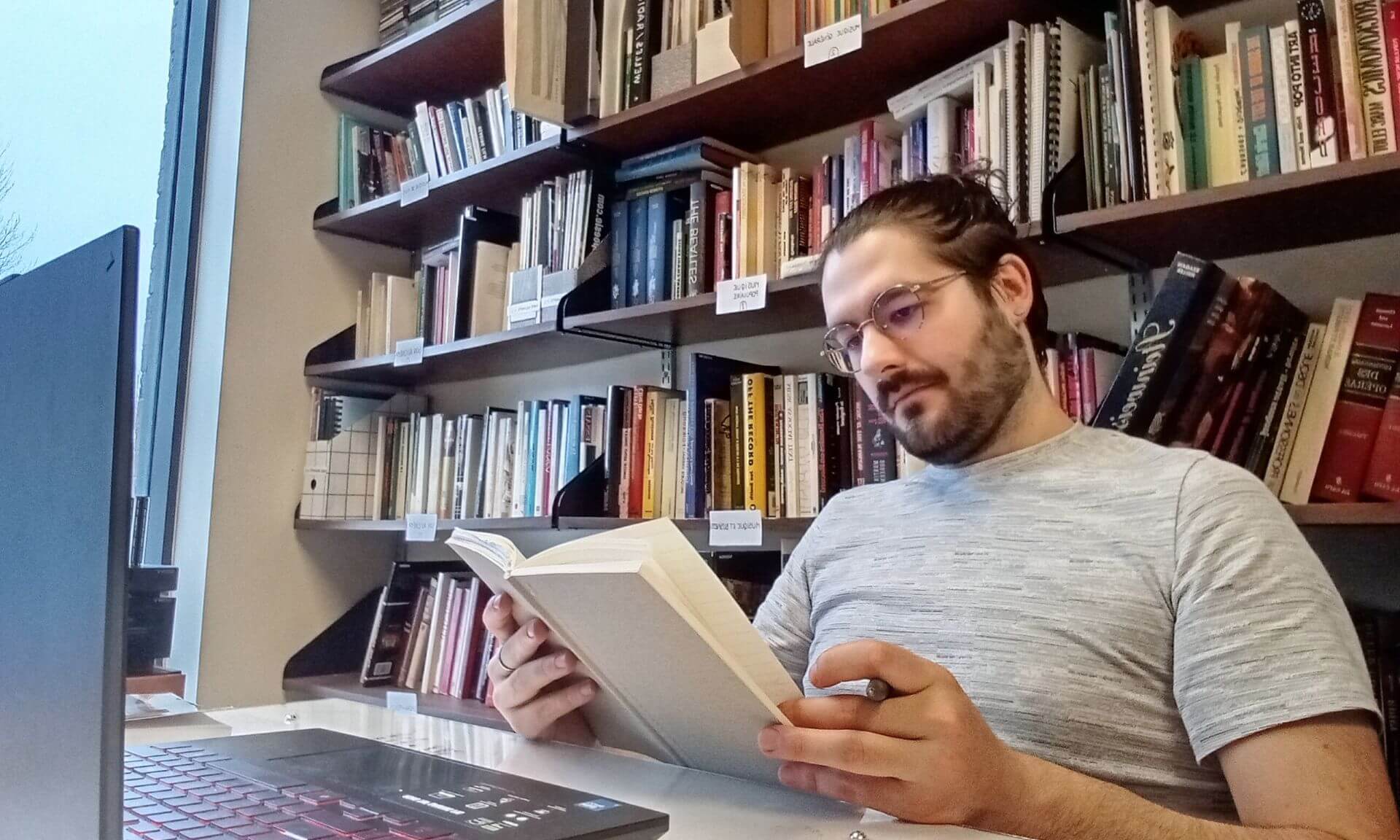La musique ne nous rendrait pas plus empathiques


Parmi les lieux communs les plus répandus sur les bienfaits de la musique figure celui selon lequel elle nous rendrait plus empathiques. Qu’il s’agisse d’enfants jouant dans un orchestre ou d’adultes chantant dans une chorale, la pratique musicale est souvent perçue comme un vecteur naturel de développement social et émotionnel. Mais que disent les données? C’est à cette question qu’a voulu répondre une équipe de recherche du Département de psychologie de l’Université de Montréal composée des étudiantes Dorothée Morand-Grondin et Beatriz Oliveira et des professeurs Floris van Vugt et Simon Rigoulot.
En scrutant la littérature existante, l’équipe a relevé des résultats contradictoires: certaines études trouvent une corrélation positive entre musique et empathie, d’autres non, et d’autres même une corrélation inverse. Les chercheurs ont donc recruté de 169 musiciens et non-musiciens adultes pour étudier s’il y a réellement un lien entre la pratique musicale en général, l’empathie et la prosocialité.
Mesurer l’empathie et la prosocialité sous toutes leurs coutures
L’étude a été conduite auprès de 80 musiciens et 89 non-musiciens âgés de 18 à 60 ans. Pour être considérée comme musicienne, une personne devait jouer d'un instrument ou pratiquer le chant depuis au moins deux ans, à raison d’une heure par semaine au minimum. L’âge et le revenu étaient similaires entre les groupes, bien qu’il y ait eu plus de femmes dans le groupe des non-musiciens, un facteur contrôlé dans les analyses.
Les chercheurs ont voulu mesurer l’empathie, c’est-à-dire «l’habileté qui permet de comprendre et d’être sensible aux états émotionnels des autres», dit Dorothée Morand-Grondin. Elle se décline en trois composantes: «Il y a d’abord l’empathie cognitive, soit la capacité de reconnaître et de comprendre les émotions d’autrui. Ensuite, la contagion émotionnelle, qui correspond au fait de ressentir une émotion analogue à celle d’une autre personne – par exemple, éprouver de la tristesse en voyant quelqu’un de triste. Enfin, une composante souvent peu considérée: la déconnexion émotionnelle, qui permet de distinguer ses propres émotions de celles des autres. On peut ressentir une émotion partagée tout en sachant qu’elle ne nous appartient pas», explique-t-elle.
Pour évaluer ces différentes dimensions, l'équipe a eu recours à trois outils:
- le Basic Empathy Scale in Adults, un questionnaire d’autoévaluation qui distingue les trois composantes de l’empathie;
- le Reading the Mind in the Eyes Test, où les participants et participantes doivent reconnaître des émotions à partir de photographies de regards;
- le Multifaceted Empathy Test, qui combine la reconnaissance d’états mentaux et l’évaluation de ce qu’on ressent face aux émotions représentées sur des photos.
Pour évaluer la prosocialité, les sujets de l'étude ont joué à une série de sept jeux économiques où ils devaient faire des choix entre leurs propres intérêts et ceux des autres joueurs.
Des résultats déconcertants
L’étude n’a révélé aucune différence significative entre musiciens et non-musiciens quant à la majorité des mesures d’empathie et de prosocialité. «Nous avons analysé les résultats aussi en fonction du nombre d’heures de répétition et nous n’avons pas trouvé de corrélation non plus», précise Dorothée Morand-Grondin. Pour ce qui est des comportements prosociaux, les deux groupes ont présenté des niveaux similaires dans les jeux économiques. Le fait d’avoir une activité musicale régulière ne semble donc pas influencer directement la propension à coopérer, à partager ou à sacrifier ses propres intérêts pour ceux des autres.
La musique, vecteur social… sous conditions?
Ces résultats vont à l’encontre de plusieurs études menées auprès d’enfants qui avaient montré les effets positifs de la musique sur les habiletés sociales. Comment expliquer cette discordance?
Dorothée Morand-Grondin avance plusieurs hypothèses. La première est liée à l’âge au début de l'activité musicale. Les analyses exploratoires indiquent que les personnes ayant commencé la musique tôt dans l’enfance obtiennent des résultats légèrement supérieurs quant à certaines mesures d’empathie, indépendamment de leur pratique actuelle. Cela donne à penser que les expériences musicales précoces pourraient jouer un rôle structurant, notamment sur le plan du développement socioémotionnel.
Autre hypothèse: le contexte de réalisation. «Beaucoup d’études portent sur des activités musicales de groupe où la coordination, l’écoute et la régulation émotionnelle sont sollicitées, souligne la chercheuse. Les adultes recrutés faisaient de la musique ou chantaient probablement dans un ensemble de contextes différents. Cela nous permet de dire que la musique en général – donc dans n’importe quel contexte – ne permet pas d’améliorer l’empathie, mais c’est possible que celle faite en groupe, plus spécifiquement, ait un effet.»
En d’autres termes, ce n’est peut-être pas la musique en tant que telle qui favoriserait l’empathie ou la prosocialité, mais les contextes sociaux dans lesquels elle est vécue.