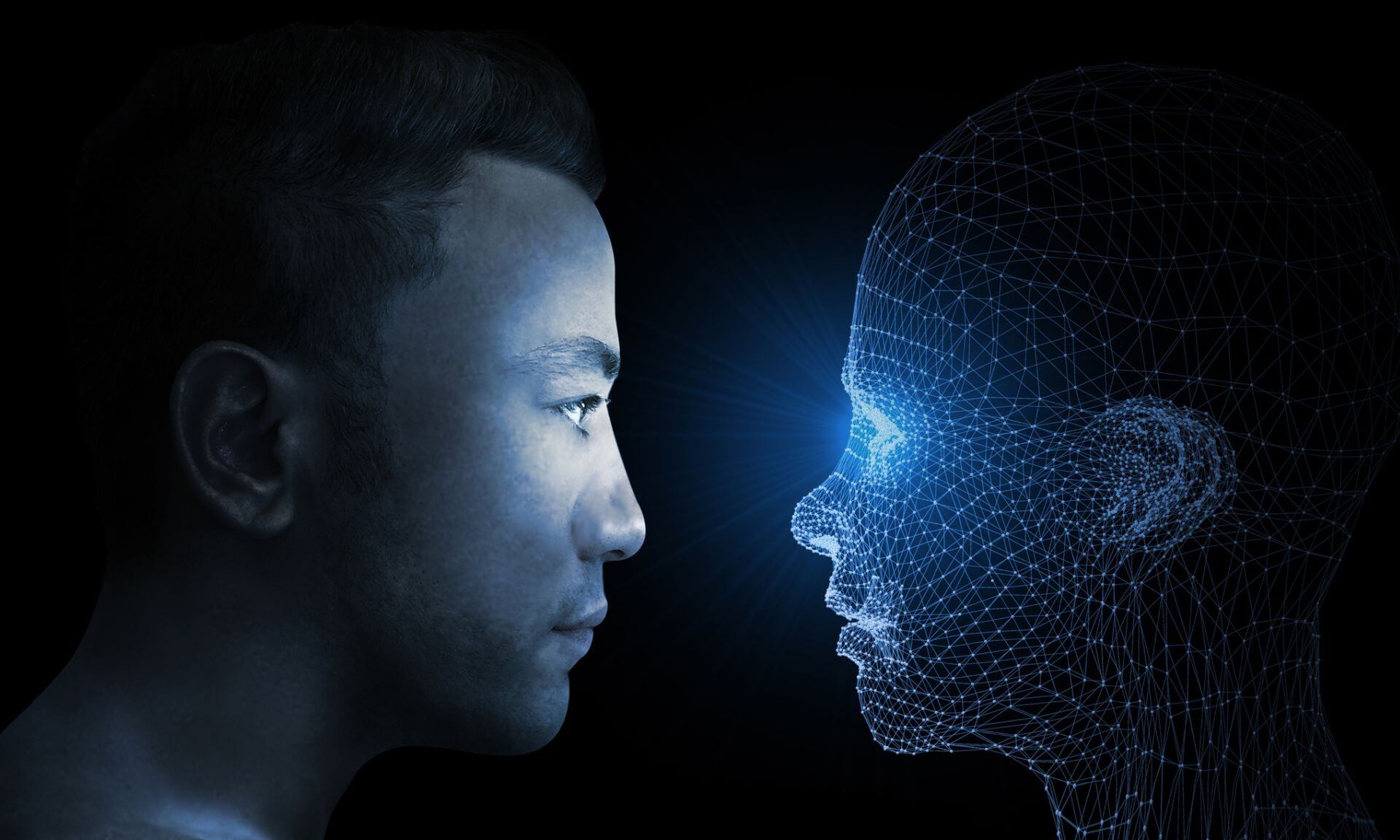Cet été est paru le rapport de la Lancet One Health Commission, un groupe qui rassemble plus de 40 spécialistes à travers la planète pour faire le point sur l’évolution et la mise en œuvre de l’approche Une seule santé (One Health).
Ce document vise principalement à faire des recommandations pour s’attaquer à des défis sanitaires touchant les humains, les animaux, les végétaux et les écosystèmes: les changements climatiques, la résistance aux antibiotiques, les maladies non transmissibles, l’insécurité alimentaire, etc.
Adressé principalement aux décideurs politiques, le rapport est considéré comme un jalon mondial important pour l’approche Une seule santé, dans le contexte où viendront bientôt à échéance les objectifs de développement durable fixés par l’Organisation des Nations unies pour un avenir durable.
Parmi ces spécialistes se trouvent les professeures de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal Cécile Aenishaenslin et Hélène Carabin, qui ont agi respectivement à titre de conseillère scientifique et de commissaire.