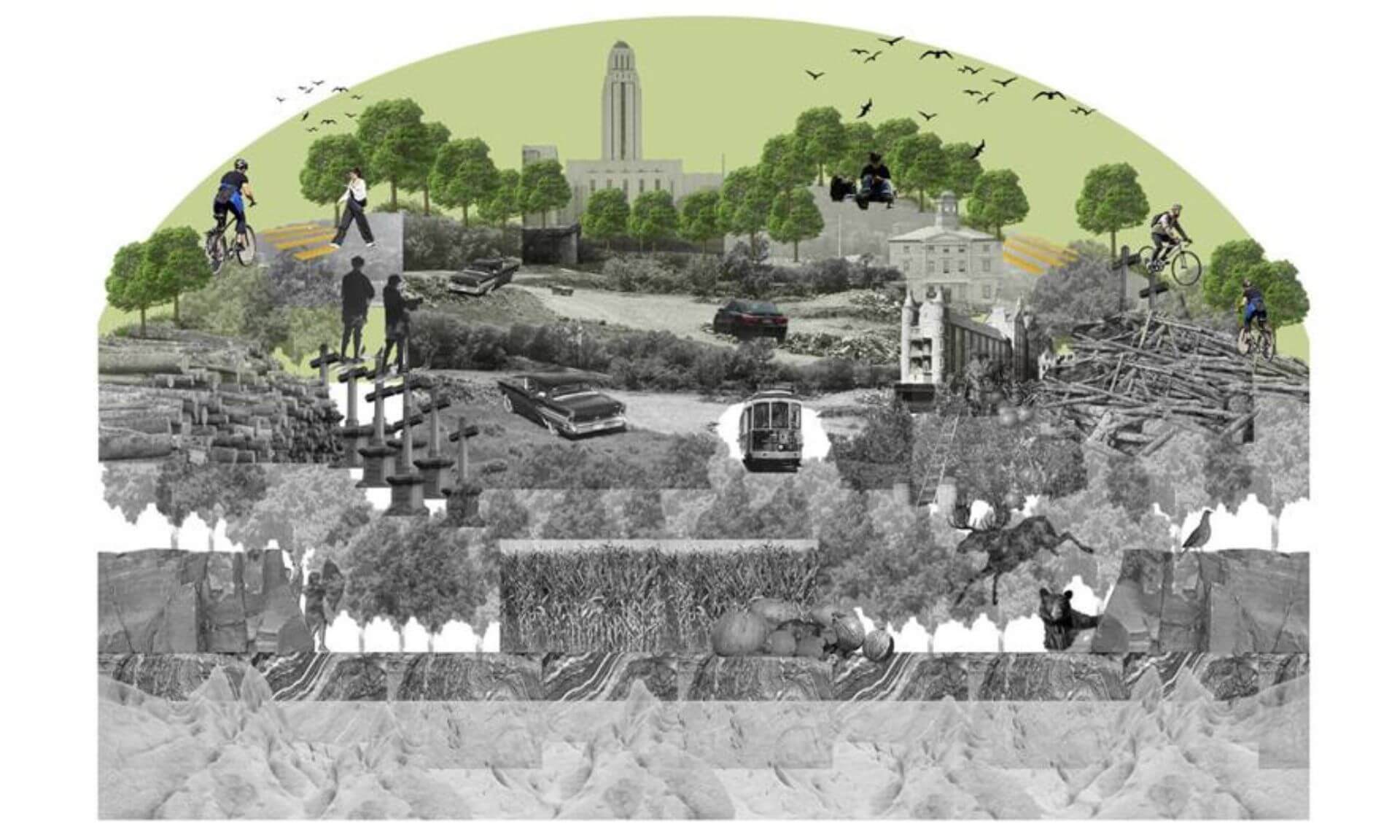Montréal comme Lyon sont reconnues comme des villes festives, où se tiennent de multiples évènements chaque année. Mais tout le monde n’a pas le droit à la fête. «Les festivals sont des lieux de contradictions. Ce sont des fêtes censées être ouvertes à tout le monde; pourtant, elles excluent», affirme d’emblée Laurène Smith, étudiante de maîtrise en architecture sous la direction du professeur Jean-Pierre Chupin, de l’Université de Montréal.
Pour tenter de répondre à la question «La ville festive est-elle inclusive?» et pour parler de leurs travaux de recherche, ces représentants de l’École d’architecture de l’UdeM ont participé aux Entretiens Jacques Cartier 2025, qui avaient lieu cette année à Lyon du 6 au 8 octobre. «L’an dernier, j’avais organisé à l’occasion des Entretiens une série de tables rondes sur la sensibilisation à l’accessibilité universelle. Dans le prolongement de cette réflexion, l’organisme Cité anthropocène nous a proposé de nous pencher sur la ville festive», résume le professeur, qui travaille sur la question de l’inclusion dans l'organisation des villes.