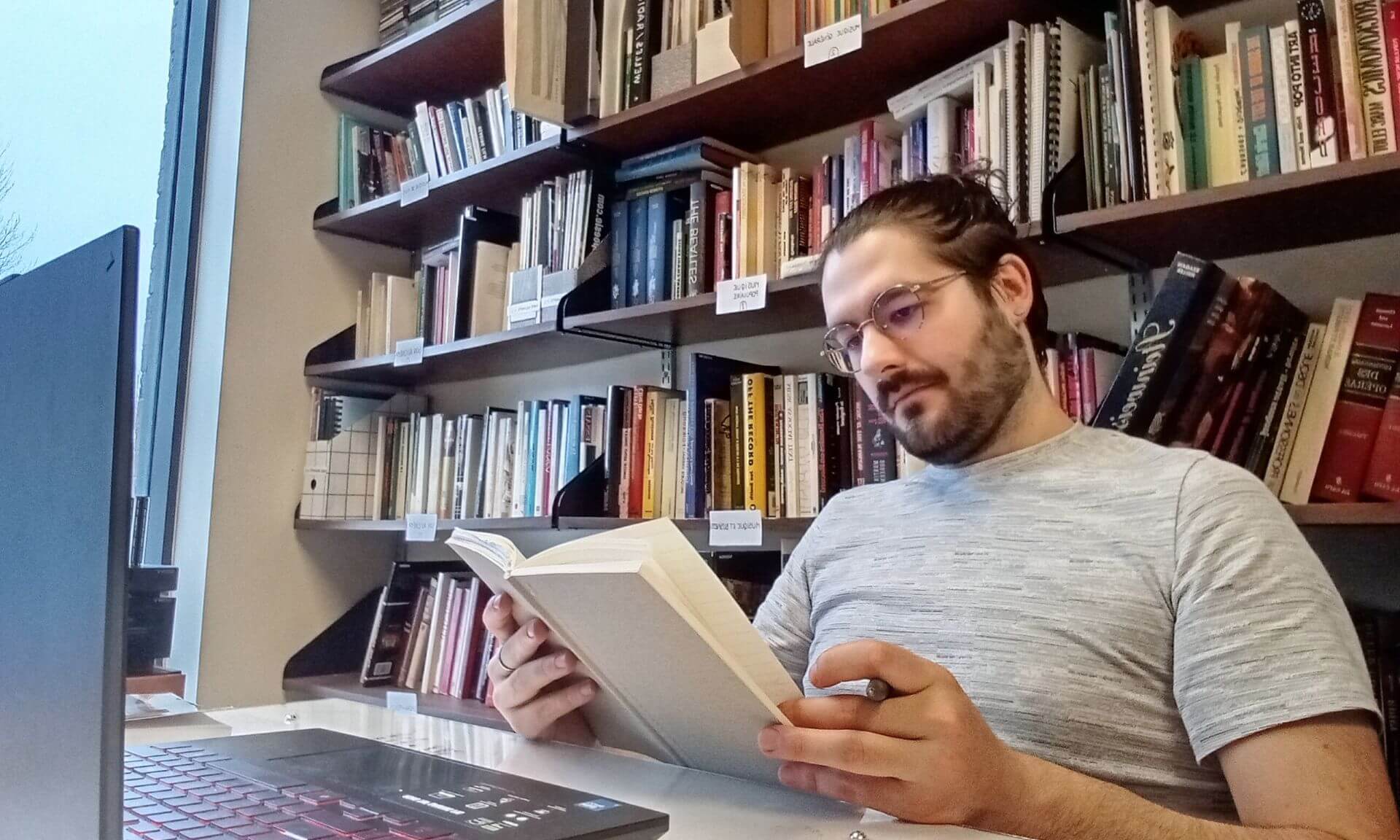Sur le plan théorique, l’étude visait notamment à tester deux théories contradictoires sur le lien entre classes sociales et musique.
D'un côté, la thèse classique du sociologue Pierre Bourdieu postule que les élites préfèrent des genres «sophistiqués» comme le jazz ou la musique classique, tandis que les classes populaires se tournent vers des styles plus accessibles. De l'autre, l'hypothèse de l'«omnivore» propose que ces frontières se sont estompées avec l'émergence de la classe moyenne et de la fragmentation des médias.
Les résultats penchent nettement vers la seconde hypothèse. «Il y a de plus en plus d'hétérogénéité en termes de préférences musicales au sein même des différentes classes sociales, confirme Catherine Ouellet. La musique dite populaire s'avère aujourd'hui appréciée dans tous les groupes socioéconomiques, même si certaines tendances persistent: le hip-hop et la pop restent plus écoutés chez les personnes à faible revenu, tandis que le rock et le rock alternatif dominent chez ceux qui gagnent davantage.»
Cette tendance à l’homogénéisation des goûts reflète une société où les barrières culturelles traditionnelles deviennent plus perméables, selon elle. Avant l'ère industrielle et la fragmentation des médias, il existait une cohérence plus marquée entre le statut socioéconomique et les préférences culturelles, alors qu’aujourd’hui ce lien est affaibli.
Personnalité et musique: des liens révélateurs
Au-delà de la question des classes sociales, l'étude révèle que les personnes qui affectionnent le country, le folk-rock et le rap affichent des degrés d'extraversion plus élevés, tandis que les amateurs de rock alternatif, de hard rock et de métal tendent vers l'introversion.
Mais les résultats les plus marquants concernent la dimension de l'«agréabilité». «Il y a une corrélation entre des préférences musicales et des traits de personnalité: les adeptes de certains types de musique ont des scores plus bas sur l'échelle d'agréabilité», note la professeure. Ainsi, les amateurs de métal, de rap, de folk-rock et de rock se distinguent par des scores significativement plus faibles quant à cette dimension, qui mesure la tendance à être coopératif, empathique et conciliant.
Ces mêmes groupes affichent aussi les scores les plus faibles en matière de conscienciosité (fait d’être consciencieux) et se perçoivent comme moins stables émotionnellement. Cela laisse entendre que les choix musicaux ne sont pas le fruit du hasard, mais reflètent des aspects profonds de la psychologie des individus.
Conservateurs et métal: un lien pas si surprenant
Au chapitre des résultats touchant aux allégeances politiques, «les gens ayant voté pour le Parti conservateur sont plus susceptibles d'être amateurs de country et de métal, et ce, au fédéral comme au provincial», indique Catherine Ouellet.
La surreprésentation des conservateurs parmi les adeptes de métal est particulièrement claire: ce genre musical est presque aussi populaire que le rock et le rock alternatif dans ce groupe politique.
À l'inverse, ces mêmes électeurs montrent moins d'affinités avec la musique électronique et le folk-rock. «Les modèles statistiques confirment que l'écoute de métal constitue un prédicteur fort du vote conservateur, équivalant à certaines variables classiques comme le genre, l'âge ou le revenu», ajoute-t-elle.
Au Québec, on observe des tendances similaires. Les électeurs du Parti conservateur du Québec reproduisent cette même préférence pour le métal et le country, tandis que la chanson française augmente la probabilité de voter pour le Parti québécois. Le folk, quant à lui, est davantage associé aux partis de gauche comme Québec Solidaire.
«Les conservateurs sont plus homogènes dans les grandes tendances musicales, alors qu'il est plus difficile de voir des ressemblances au sein des électorats des autres partis», observe la chercheuse.
Des traces numériques qui en disent trop?
Faut-il en conclure que tous les amateurs de métal ou de country sont forcément conservateurs?
«Non! Ce sont de grandes tendances sur le plan musical, nuance Catherine Ouellet. Elles corroborent d’ailleurs des travaux semblables réalisés aux États-Unis. L'important, c'est de comprendre qu'il existe des variables à priori non politiques qui peuvent être révélatrices de prédispositions politiques plus profondes.»
Selon elle et son équipe, la musique fonctionne comme un marqueur de socialisation et de formation identitaire. L’identification à un genre musical particulier peut être indicative de valeurs, de visions du monde partagées – qui elles-mêmes peuvent être corrélées aux préférences politiques, ce qui amène une certaine cohérence entre styles de vie et orientations idéologiques.
Par ailleurs, cette recherche s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'utilisation des données personnelles à l'ère numérique, où les listes de partage sur Apple Music ou Spotify deviennent des mines d'informations sur l’identité des utilisateurs.
«Nous sommes collectivement et individuellement devenus des producteurs d'informations et ces données ont une valeur qu'on ne soupçonne pas toujours, avertit Catherine Ouellet. Si les plateformes de diffusion en continu collectent et analysent déjà ces informations pour personnaliser leurs suggestions, qu'est-ce qui empêcherait des stratèges politiques d'exploiter ces données pour cibler des tranches de l'électorat?»
Au Canada et au Québec, les partis politiques n’ont certes pas les moyens financiers ni le cadre légal de leurs homologues américains pour exploiter massivement ces données… mais la possibilité existe.
«C’est pourquoi il faut s’interroger plus largement sur les traces numériques que nous laissons continuellement comme électeurs et comme consommateurs, car ce que nous écoutons en dit peut-être plus sur nous que ce que nous souhaitons montrer», conclut Catherine Ouellet.