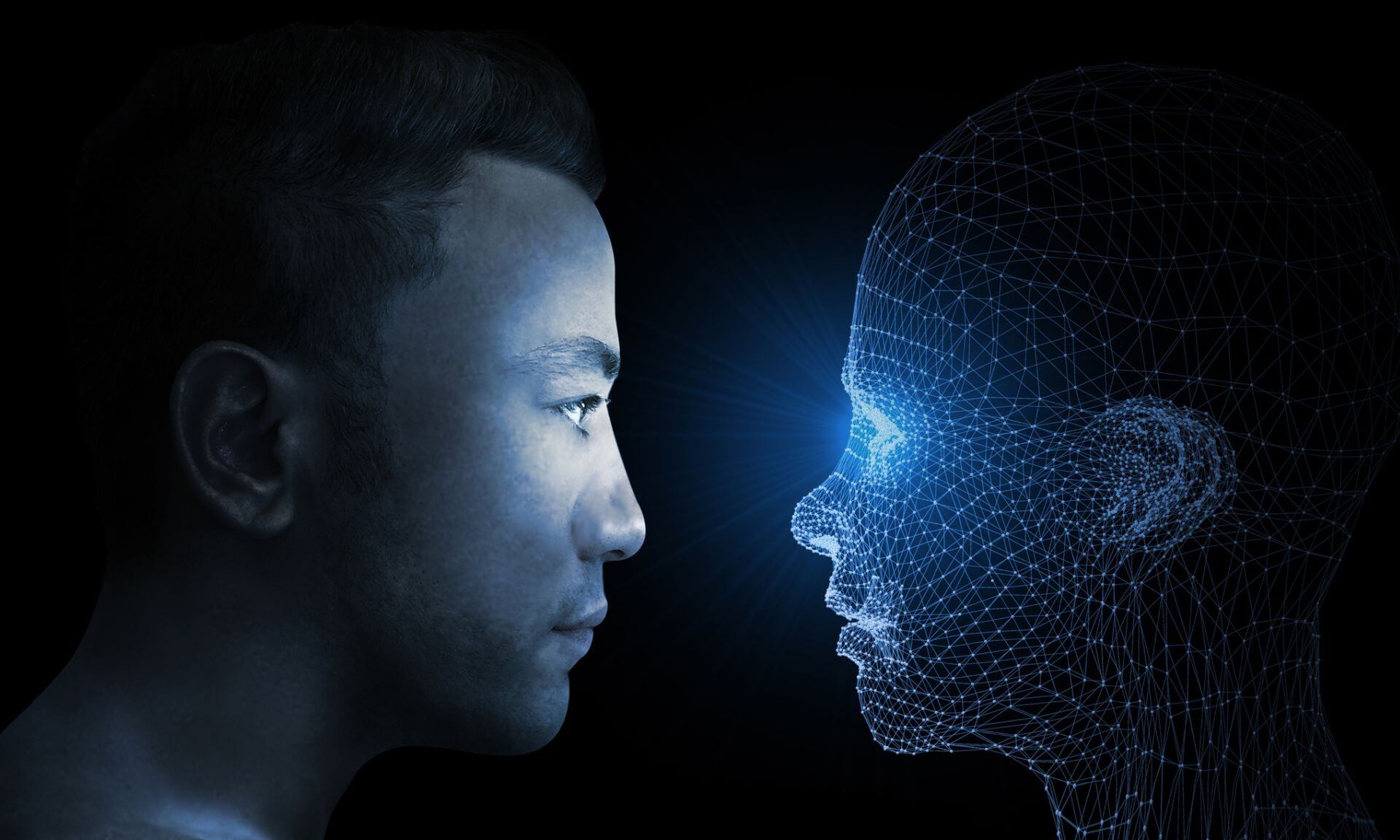En seconde partie de la soirée, on a pu entendre la Dre Bjerre, titulaire de la Chaire de médecine familiale à l’Université d’Ottawa, qui a recours aux mégadonnées et à l’intelligence artificielle pour des recherches portant entre autres sur l’accès aux soins; René Lortie; le Dr Nikiema, professeur adjoint en santé numérique et analyse de mégadonnées à l’Université de Montréal; et le Dr Petruccelli, candidat au doctorat en intelligence artificielle et médecin résident en chirurgie orthopédique à l’UdeM. Selon eux, l’IA peut déjà transformer la pratique médicale, mais les obstacles administratifs, techniques et culturels freinent son adoption.
Lise M. Bjerre, médecin de famille, utilise dans sa pratique un logiciel de transcription numérique basé sur l’intelligence artificielle ou scribe IA, un outil qui enregistre et résume ses échanges avec le patient et qui produit automatiquement des notes de dossier. «L’IA a le potentiel de nous aider à accroître l’efficacité et l’équité de notre système de santé. Elle peut réduire le fardeau administratif, améliorer les diagnostics, offrir une meilleure expérience aux patients et aux soignants», a-t-elle déclaré. Mais elle a mis en garde contre la pensée magique: «C’est un outil, pas une baguette magique. Il faut de l’éducation, de la formation et surtout du courage pour ne pas s’empêtrer dans une règlementation excessive.»
Ancien responsable médical du scribe IA CoeurWay, maintenant utilisé par plus de 10 500 professionnels de la santé, le Dr Petruccelli a souligné que le principal obstacle à ces solutions n'est pas technique, mais administratif: obtenir les approbations éthiques, administratives et de cybersécurité reste le plus grand défi.
René Lortie, patient et proche aidant, a apporté une perspective citoyenne: «Je ne suis pas médecin, mais je suis expert de la maladie de ma mère. L’IA me semble prometteuse pour améliorer les diagnostics et personnaliser les soins», a-t-il dit. Mais il a exprimé deux grandes inquiétudes: «Le risque de déshumanisation des soins et les biais des données. Si les données sont biaisées, les décisions le seront aussi.»
Jean Noël Nikiema, chercheur, a quant à lui tempéré les attentes: «Il y a de cela cinq ans, nous avions fait le même exercice en énumérant des promesses: l’IA va révolutionner le diagnostic, la thérapeutique, le soutien au patient. Et cinq ans plus tard, nous sommes encore à l’étape des promesses.» Selon lui, la vraie valeur de l’intelligence artificielle se situe ailleurs: «Plutôt que de participer à l’établissement du diagnostic, elle doit nous aider dans la conduite à tenir, dans la gestion de cas, dans la décision clinique», a observé le médecin.