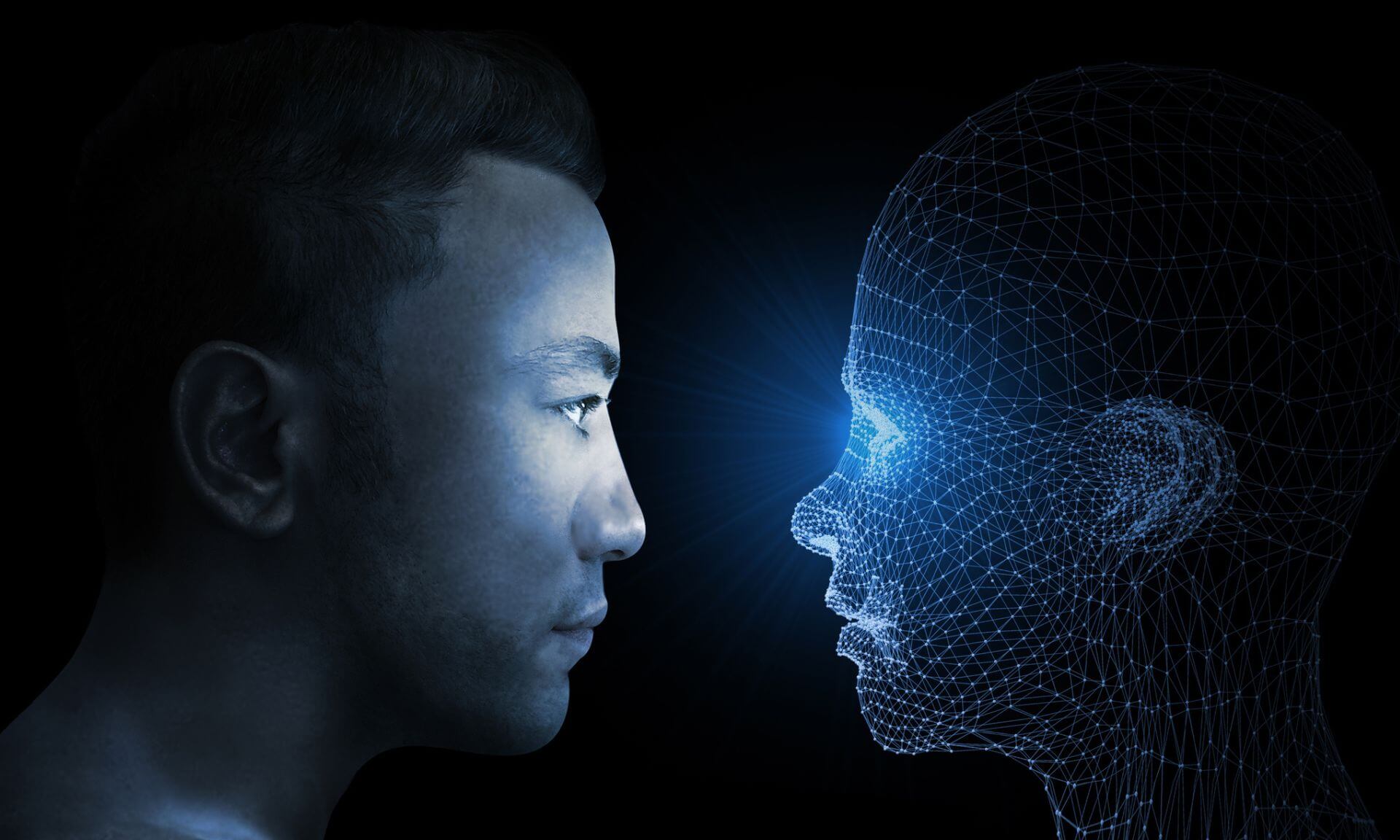Le point sur cette transition alimentaire mondiale inquiétante
Rappelons que les aliments ultratransformés sont des formulations industrielles contenant des ingrédients absents de la cuisine maison, comme des colorants, des agents de conservation ou des arômes artificiels. Ils sont conçus pour être attrayants par leur forte teneur en sucre, en gras et en sel, mais aussi parce qu’ils sont peu coûteux et très publicisés. Pour ces raisons, ils encouragent la consommation.
Cette transformation, amorcée au 20ᵉ siècle dans les pays à revenu élevé comme le Canada, les États-Unis ou l’Australie, s’étend désormais à grande vitesse dans les pays du Sud global, du Sénégal aux îles Fidji en passant par la Colombie, indique Jean-Claude Moubarac.
«Aujourd’hui, on la voit se produire en temps réel dans plusieurs régions du monde et avoir des effets particulièrement marqués sur les populations vulnérables», ajoute le chercheur en nutrition publique et internationale.
Et les conséquences de ces aliments sur la santé ne sont plus à prouver: hausse de l’obésité, du diabète et de l’hypertension. Une récente étude de Jean-Claude Moubarac montrait justement que leur consommation serait responsable de près de 40 % des maladies cardiovasculaires au Canada. Des preuves qui justifient une action immédiate en matière de santé publique, insistent les auteurs des articles.
Une danse politique
Selon Jean-Claude Moubarac, les politiques alimentaires sont dominées par le secteur privé et exposent ainsi l’ensemble de la société à une offre majoritairement ultratransformée, que ce soit dans les écoles, les hôpitaux ou les milieux de travail.
Pour espérer un changement durable, dit le chercheur, il faut repenser en profondeur notre rapport à l’alimentation. «On la considère trop souvent comme une marchandise», déplore-t-il.
Le professeur dénonce également l’inaction à l’égard de la publicité destinée aux enfants – interdite dans certains pays comme le Chili – et la censure autour des aliments ultratransformés.
«Au Québec, certaines organisations préfèrent éviter le mot ultratransformé. Par exemple, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec [MAPAQ] préfère parler des ingrédients, des sucres, des gras et du sel, et de la reformulation alimentaire. Cette stratégie entraîne la fabrication de produits moins sucrés et moins salés, mais pas nécessairement sains. Or, l’OMS recommande aujourd’hui d’aller au-delà des nutriments et de considérer la transformation alimentaire. Il faut mettre de la pression pour que le MAPAQ entre dans la danse», explique-t-il.
Des solutions accessibles
Jean-Claude Moubarac le martèle: les politiques publiques devraient au contraire placer l’alimentation au cœur des priorités nationales en la valorisant dans toutes ses dimensions – santé physique et santé mentale, identité culturelle, lien social et durabilité.
Parmi les mesures prometteuses, le Brésil fait figure d’exemple. Son programme national d’alimentation scolaire exige que 90 % des aliments servis soient peu ou pas transformés et qu’ils proviennent de l’agriculture locale.
«C’est ce qu’on aimerait voir au Canada, affirme le chercheur. On aimerait que la qualité de l’alimentation soit incluse dans le choix des aliments vendus en milieu institutionnel parce que, présentement, c’est seulement le prix qui est considéré. Ainsi, les recherches du réseau INFORMAS ont révélé que 99 % de nos hôpitaux au Canada offrent des boissons sucrées.»
Pour lui, la clé réside dans la mobilisation citoyenne et la recherche. «Notre rôle, comme chercheurs, c’est d’éclairer les liens entre alimentation et santé et d’étudier la qualité des environnements alimentaires et les politiques publiques qui les façonnent», conclut-il.