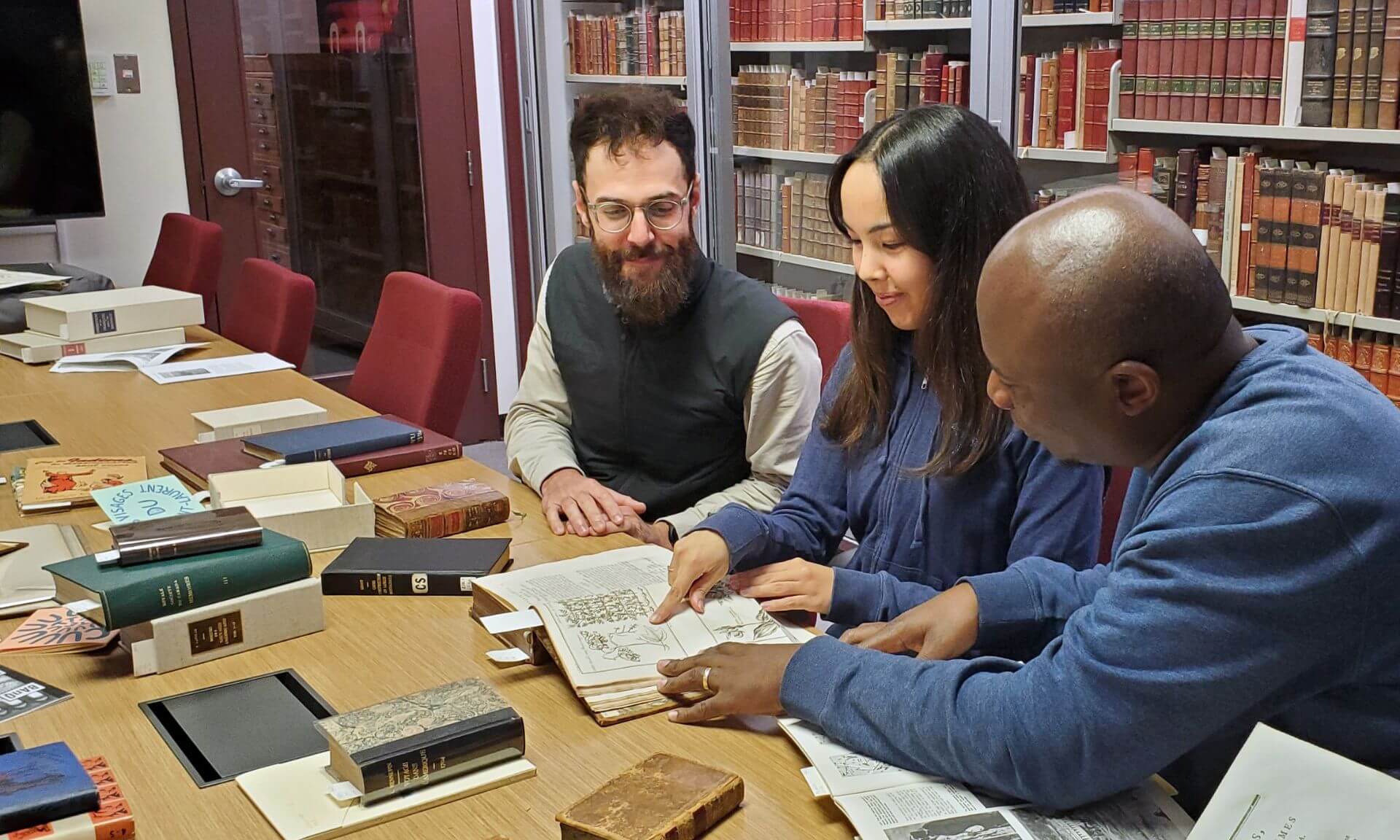«J’écris parce que quelque chose me happe que je ne saisis pas, puis survient ce combat, je veux comprendre, mais cela échappe à la raison, les mots me devancent, sautent sur la page comme des punaises, je les écrase et ils recommencent et j’essaie de fabriquer un récit comme on crée un rêve», écrit dans Soigner, écrire Ouanessa Younsi, psychiatre, écrivaine et professeure adjointe de clinique à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.
Son livre, qui avait déjà remporté le Prix de la revue Études françaises, vient d’être récompensé par le prestigieux Prix du Gouverneur général dans la catégorie des essais.
Le chemin de croix vers la psychiatrie
«J’ai fait ma médecine comme on fait son chemin de croix, car ma passion première restait les mots, la littérature, peut-on lire dans l’ouvrage d’Ouanessa Younsi, qui confie écrire depuis son jeune âge. J’ai toujours écrit, même enfant. C’est venu de ma mère et de ma grand-mère, deux femmes qui aimaient les mots. Enfant, c’était ma façon de garder vivantes certaines parties de moi que j’avais du mal à exprimer autrement.»
Née à Québec, Ouanessa Younsi entre en médecine à l’Université Laval directement après ses études collégiales. Elle fait partie des premières de classe. Mais très vite, quelque chose résiste. «C’est comme s’il manquait quelque chose. C’était peut-être lié à mes aspirations pour la littérature, l’art et l’écriture. À l’époque, il y avait beaucoup de cours magistraux, beaucoup d’apprentissages par cœur. J’avais l’impression qu’on réduisait la médecine à une science froide, à une série de protocoles», mentionne-t-elle.
Ce besoin d’un espace plus souple la conduit vers la psychiatrie, la seule spécialité pour laquelle elle postule. «Je m’étais dit que, si je n’étais pas prise en psychiatrie, je ferais autre chose de ma peau», se souvient la docteure. Cette discipline lui apparaît comme «la zone grise», celle où la parole et le récit du patient comptent autant que les données biologiques. «Certains trouvent cela anxiogène, qu’il n’y ait pas de réponses parfaites. Mais moi, je trouve ça stimulant, poursuit-elle. J’aime cette absence de certitudes et cette cocréation avec le patient d’un espace thérapeutique.»
Elle effectue sa spécialisation en psychiatrie à l’Université de Montréal. Là, elle découvre la pratique clinique. «Apprendre les critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et les aspects scientifiques du métier, c’était comme apprendre ses gammes au piano, illustre-t-elle. Ce que j’ai aimé ensuite, c’est apprendre à en jouer.»
Et elle apprend alors à écouter ses patients. Dans Soigner, écrire, Ouanessa Younsi raconte cette découverte: «Écouter n’est pas uniquement une question de minutes, mais une attitude: une oreille tendue vers le patient – pas seulement vers ses mots, non, tout entendre, l’intonation de la voix, la façon de bouger les lèvres, les pupilles moulues comme du poivre, le tremblement de la main droite, parce que le lithium, parce que l’anxiété, parce que pas assez de propanolol, parce que l’existence.»
La poète et la psychiatre
Longtemps, Ouanessa Younsi a vécu ses deux identités comme un clivage: «Le jour, j’étais psychiatre. Le soir, j’écrivais.» Avec le temps, les frontières se sont estompées. «À force de travail sur moi, j’ai fini par intégrer ces deux dimensions. Ce sont des métiers du langage, des métiers de la vulnérabilité, des métiers sous le regard de la mort. Je cite souvent Gaston Miron, qui parle d’une “réconciliation batailleuse”. Aujourd’hui, je me sens plus réconciliée. Soigner, écrire, c’est un peu l’aboutissement de cette intégration de la psychiatrie et de la littérature», affirme-t-elle.
Le livre témoigne de cette porosité: «Moi j’aime follement les mots, je les aime, car ils me permettent d’écrire et en un sens de soigner, ils m’aident à penser, mais surtout à ressentir. Ils me permettent de rejoindre ma part la plus vulnérable et créative, mon vrai self comme le traduirait Winnicott. Le poème est là où je deviens patiente et, grâce à ce saut, où je deviens soignante.»
Et elle relate comment les deux se nourrissent: «La psychiatrie nourrit à son tour mon écriture, en lui injectant des doses de réel, car je ne connais rien de plus concret que la maladie et la mort, que je côtoie au quotidien à l’hôpital. Je deviens un corps dans l’écriture, un cœur de mots en témoignant du réel. Je ne suis pas journaliste, je ne suis qu’une médecin qui cherche à traduire ce qu’elle voit et vit, ce qui persiste et meurt derrière les portes de l’hôpital psychiatrique.»
Elle se décrit comme «une écrivaine de fiction malgré elle», témoin de ce qui se passe «derrière les portes closes», transformant les récits de ces patients pour en préserver la confidentialité. «Tout ce que j'écris est souvent de la fiction. Sauf quand je parle de moi et de ma mentore. C'est mon éthique personnelle. Je trouve important qu'on puisse parler de la maladie mentale et qu’on puisse parler des aspects souffrants qui nous relient comme humains. Je pense qu'on est tous dans le même bateau de la maladie et de la mort et qu’on partage tous cette même fragilité», indique-t-elle.
Enseigner pour apprendre à écouter
Parallèlement à sa pratique, Ouanessa Younsi est revenue à l’Université de Montréal, ayant alors l'occasion de travailler au même endroit que sa mentore, elle-même professeure à l'UdeM, et d'ailleurs un personnage de Soigner, écrire. Cette fois, non pour y étudier, mais pour y enseigner. «C’est comme essayer de quitter sa famille. J’ai essayé et puis je suis revenue un peu vite! Ce qui est stimulant dans l’enseignement, c’est que c’est une autre façon d’apprendre», observe-t-elle.
Elle souligne combien les étudiants et les étudiantes l’aident à retrouver le sens du soin: «Les étudiantes et étudiants me ramènent à l’essentiel: écouter et vouloir le bien des patients. Avec le temps, on peut oublier pourquoi l’on a choisi ce métier. Eux me ramènent à cette source.»
Admiratrice de la Dre Rita Charon, qui a conceptualisé et enseigne la médecine narrative, une approche qui intègre la narration à la pratique médicale pour humaniser les soins en se concentrant sur l'histoire du patient, Ouanessa Younsi a mis sur pied avec des collègues des ateliers de médecine narrative au Département de psychiatrie et d’addictologie de l’UdeM. Là, les futurs médecins lisent pour apprendre à écouter autrement. Elle explique: «On est parti du fait que, souvent, les patients ne se plaignent pas que leur médecin ait été incompétent techniquement. Ils disent plutôt: “On ne m’a pas entendu.”» En d’autres termes, «les patients arrivent avec des récits et l’on cherche des diagnostics. Alors, dans ces ateliers, on apprend à écouter un texte comme on apprend à écouter un être humain», dit la professeure.
Elle a aussi cocréé le cours Psychiatrie et sciences humaines, destiné à décloisonner ces deux disciplines. «On voulait aller chercher l'expertise des psychiatres qui ont aussi une formation en sciences humaines et inviter d'autres collaborateurs. Il y a de plus en plus d'initiatives qu’on doit saluer à l’Université de Montréal. Par exemple, je suis souvent invitée par des professeurs de littérature dans des initiatives de collaboration; je pense ici à Catherine Mavrikakis et Simon Harel, qui ont fait beaucoup pour rapprocher les questions du soin et de la littérature», remarque-t-elle.
Pour elle, écrire, enseigner et soigner participent d’un même mouvement. Elle prévoit justement continuer ses métiers: Soigner, écrire.