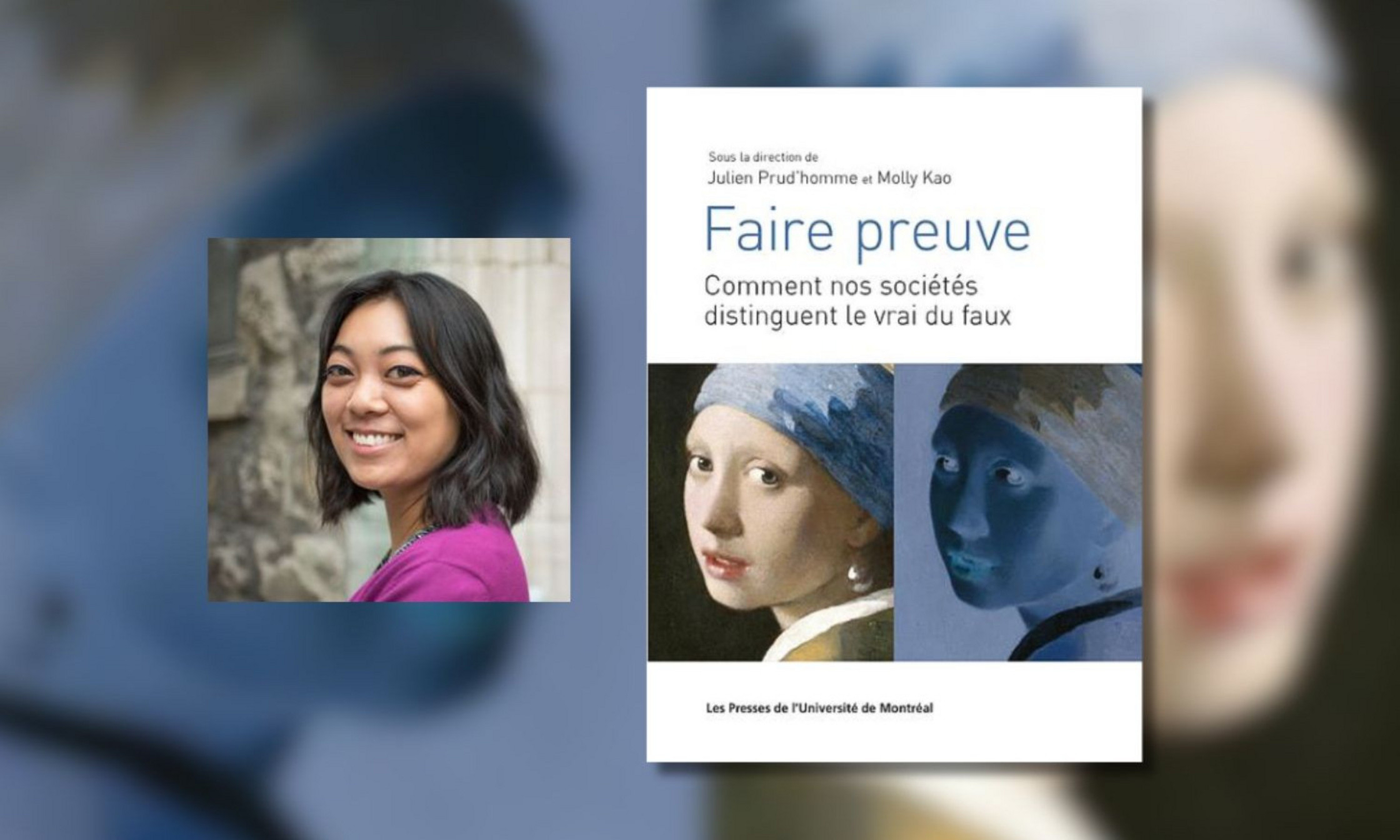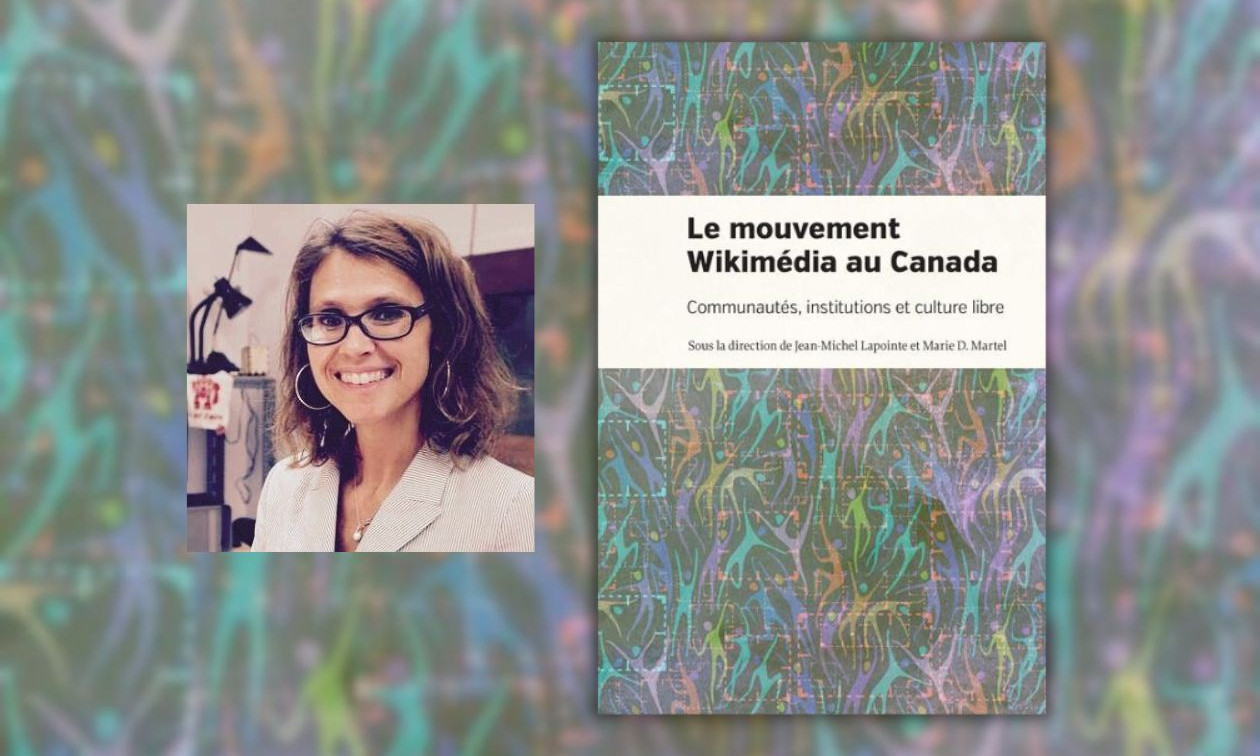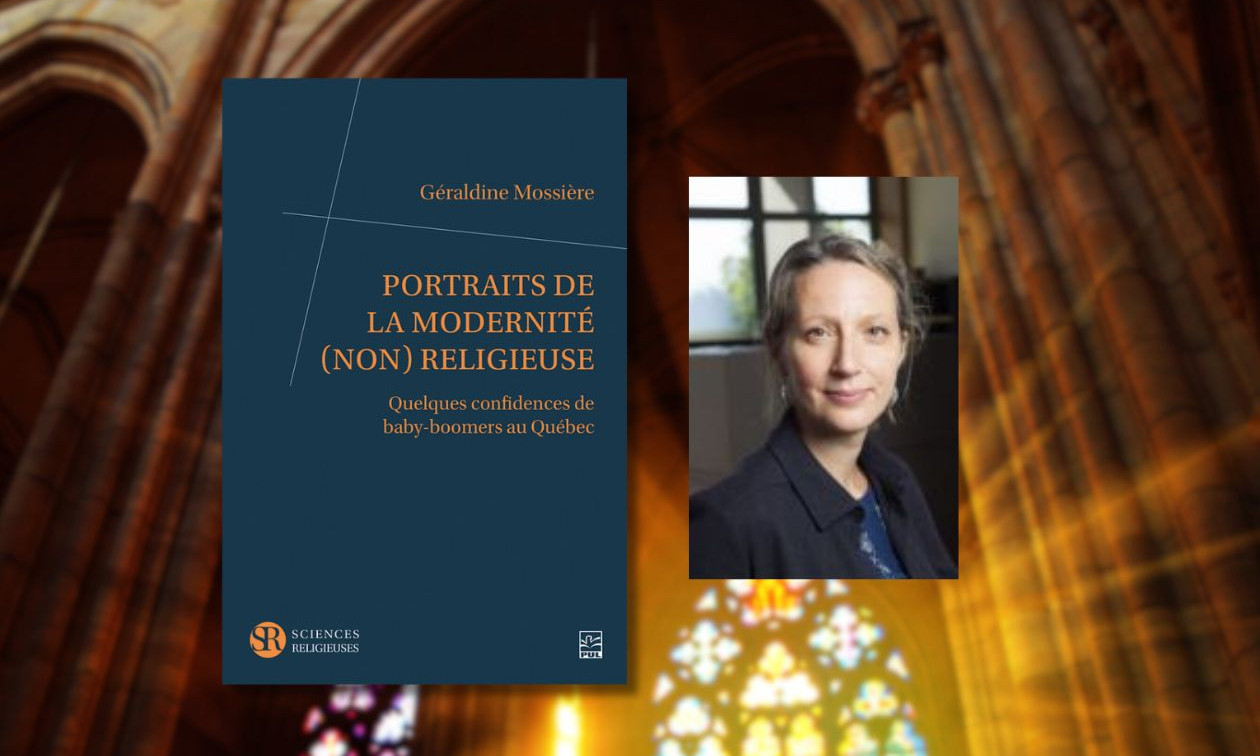«Doit-on donner un placebo à un malade? Vers 1990, la réponse des chercheurs était un «oui» convaincu. Administrer un faux médicament à un groupe témoin, tout en donnant en parallèle le vrai traitement à d’autres patients, apparaissait comme un critère de preuve nécessaire pour la recherche pharmaceutique. Comment, autrement, déterminer si un médicament fonctionne?
«Depuis, les choses sont devenues moins claires. D’une part, des observateurs ont montré des dérives de la recherche avec placebo: ainsi, cette équipe sur le traitement du VIH qui laissait des patients ougandais, sans soins réels ni filet préventif, répandre le virus pendant des mois. D’autre part, des joueurs sérieux, dont la Food and Drug Administration (FDA) et l’Office for Human Research Protections, aux États-Unis, ont mis en doute la nécessité intellectuelle du placebo comme dispositif de preuve et en recommandent un usage moins systématique», écrivent Julien Prud’homme, professeur au Département des sciences humaines de l’Université du Québec à Trois-Rivières, et Molly Kao, professeure au Département de philosophie de l’Université de Montréal dans l’ouvrage qu’ils ont dirigé Faire preuve: comment nos sociétés distinguent le vrai du faux.
À travers cet exemple, ils illustrent l’idée centrale de faire preuve: une preuve n’existe jamais seule, elle prend son sens dans un cadre social, scientifique et politique donné. Fruit d’une collaboration entre chercheurs issus de disciplines variées (philosophie, sociologie, science politique, histoire, sciences de l’information et de la communication), l’ouvrage se penche sur ce qui rend une preuve convaincante ou contestable. Des débats sur la reproductibilité scientifique à l’exploitation des données numériques en passant par le rôle de l’expertise dans l’espace public, il montre que toute preuve se construit, se discute et évolue au gré des méthodes, des interprétations et des valeurs qui la sous-tendent. Molly Kao nous en dit plus sur cet ouvrage.
Pourquoi ce livre?
Dans une société qui se veut démocratique et rationnelle, on veut des citoyens bien informés, capables de participer à la prise des décisions. On veut aussi des décideurs, des professionnels et des éducateurs en mesure de juger la valeur des affirmations scientifiques et de les utiliser adéquatement. Toutefois, on vit à une époque où circulent une énorme quantité d’informations, pas toutes de bonne qualité. De plus, les connaissances évoluent rapidement. Les experts comme les non-experts affrontent donc des situations où il n’existe pas de consensus absolu et où les idées doivent être révisées régulièrement.
Ce qu’il faut retenir, c’est que cette incertitude n'est pas le contraire de la connaissance. Elle en fait plutôt partie. Cela oblige à réfléchir sérieusement sur l’évaluation des «preuves», des arguments mobilisés en faveur de telle ou telle position. Mieux comprendre la nature de la preuve et de ses usages sociaux nous aidera, notamment, à avoir des échanges plus productifs en cas de désaccords.
En écrivant ce livre, nous visons deux objectifs: faire voir les subtilités qui affectent notre compréhension commune de ce qui est vrai; et montrer que l’incertitude, les choix politiques et l’évolution des critères de preuve font partie d’un processus normal, qui n'implique pas une dérive relativiste.
Comment définiriez-vous une preuve dans un contexte scientifique ou philosophique? En quoi cette définition diffère-t-elle selon les disciplines?
Une preuve n’est pas une chose: c’est un moyen. Les preuves sont des arguments, c’est-à-dire des objets que nous transformons en données acceptées pour défendre une thèse. Notre livre repose sur cette définition, disons pragmatique, de la preuve. Cette définition implique trois choses.
Premièrement, on ne trouve pas de preuves à l’état brut dans la nature. Une preuve est d’abord un objet – un fossile, un sondage, une solution mathématique – glané, construit et présenté comme une «donnée». Deuxièmement, pour qu’une telle donnée devienne une preuve valable, il faut qu’un auditoire l’approuve. Cela suppose notamment un certain consensus autour de conventions et de normes. Troisièmement, ces données deviennent des preuves lorsqu’on les mobilise à l’appui d’une thèse.
Une preuve sert un but, qui est de rendre une idée valide pour un auditoire donné – par exemple pour une certaine communauté scientifique, un ministère ou l’espace public. Or, tous les espaces sociaux ne suivent pas les mêmes règles. Ainsi, tout le monde ne s’entend pas sur le degré de certitude attendu d’une affirmation. Dans le champ scientifique, l’incertitude est tolérée et, en principe, valorisée. Dans l’espace public par contre, la moindre incertitude peut apparaître comme une faiblesse. Dans l’un ou l’autre cas, le défi pour nous n’est pas de juger si une preuve est «valide» ou non; il est de choisir à quelles conditions une preuve, forcément imparfaite, sera acceptée comme suffisante dans tel ou tel contexte. Cela exige une bonne compréhension du contexte et une réflexion critique.
À qui s'adresse ce livre?
Ce livre s’adresse aux chercheurs et chercheuses, aux étudiantes et étudiants, ainsi qu’au grand public, qui s’intéressent à la notion de preuve dans des contextes différents. J’ai déjà mentionné nos deux objectifs associés à cet ouvrage. Le livre les atteint à l’aide d’exemples concrets et variés, qui concernent à la fois la fabrique de la science par les scientifiques – avec des chapitres sur la reproductibilité en science, l’évolution des preuves en physique et en mathématiques, l’utilisation des données massives produites par de nouvelles technologies – et l’utilisation de la science dans le «vrai monde» – avec des chapitres sur l’expertise judiciaire, l’evidence-based, la vérité sur Internet, la place des patients en sciences biomédicales, la religion dans le débat public. Un lecteur pourrait donc lire le livre d’un trait ou bien consulter les chapitres selon ses centres d’intérêt.