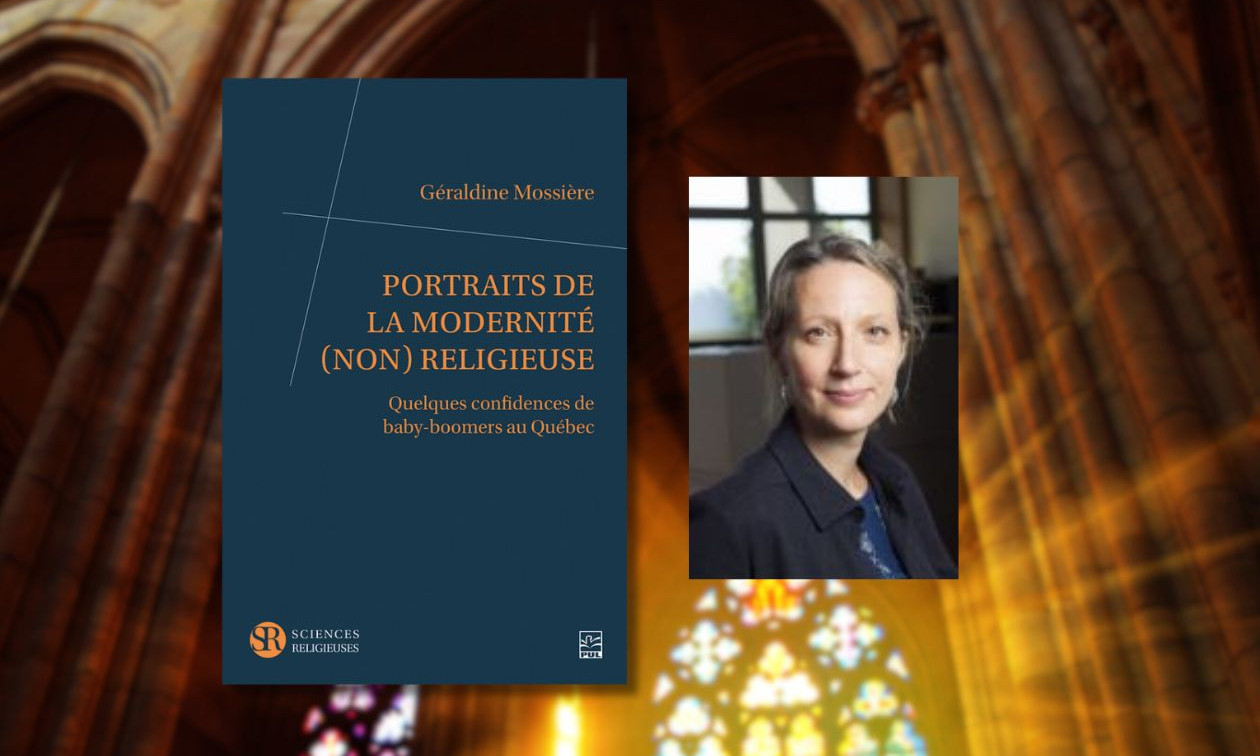Le mouvement Wikimédia au Canada

Dans la série
«Entre guillemets» Article 34 / 35
L’ouvrage Le mouvement Wikimédia au Canada explore l’aventure canadienne au sein du mouvement Wikimédia. À travers des contributions de bénévoles québécois, acadiens, atikamekw et anglophones, il montre comment les communautés cherchent à faire vivre leurs cultures et leurs langues dans un espace numérique mondialisé.
Trois grands thèmes structurent le livre: les enjeux identitaires liés à la représentation des cultures sur les plateformes comme Wikipédia et Wikidata; les collaborations entre institutions (musées, bibliothèques, gouvernements) et contributeurs; et les formes de littératie développées par ceux et celles qui participent à ces projets. L’ouvrage permet d’entendre les voix de bénévoles de différents endroits au pays grâce à une cartographie sonore en ligne.
Au fil des pages, on découvre un portrait vivant, critique et inspirant d’un mouvement qui redéfinit notre rapport au savoir, en misant sur l’intelligence collective.
Nous nous sommes entretenus avec Marie D. Martel, professeure à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, qui a codirigé ce livre.
Pourquoi ce livre?
Cette publication, que j’ai dirigée avec Jean-Michel Lapointe, répond à un manque: malgré une abondante littérature sur Wikipédia et la culture libre, rares sont les travaux qui examinent la participation spécifique d’un pays aux plateformes Wikimédia. Notre ambition est de documenter les initiatives canadiennes, en explorant comment les idéaux de partage, d’accès ouvert et de collaboration s’expriment au nord du 49e parallèle.
Plutôt que d’offrir une vue d’ensemble uniforme, le livre adopte une approche plurielle, à l’image du Canada lui-même: c’est un pays de tensions et de convergences, façonné par les régionalismes, les diversités linguistiques, les cultures autochtones, les communautés issues de l’immigration. Ce livre tente de rendre compte de cette complexité, à travers des voix multiples, des études de cas situées et des méthodes ancrées dans les pratiques contributives et collaboratives développées dans le mouvement.
Il s’agit aussi d’un acte de reconnaissance: reconnaître l’engagement patient et souvent invisible des bénévoles; reconnaître les défis structurels et les obstacles juridiques; et surtout, reconnaître que les projets Wikimédia, loin d’être de simples plateformes, sont aussi des terrains de médiation, de transmission et d’invention des communs. Notre livre veut contribuer à cette production de savoirs communs qui est en même temps une mémoire collective. Il s’agit donc à la fois d’un état des lieux, d’un plaidoyer et d’un outil pour nourrir les prochaines étapes du mouvement Wikimédia au Canada.
Quelle est la contribution des personnes canadiennes aux plateformes Wikimédia?
La contribution des personnes canadiennes aux projets Wikimédia ne se laisse pas facilement circonscrire — et c’est justement ce qui la rend si intrigante et riche. Ce sont des élans dispersés, mais tenaces: des initiatives portées par des communautés locales, des contributions en plus d’une dizaine de langues, motivées tantôt par le désir de rester en lien avec une culture d’origine, tantôt par la volonté de faire émerger des pans oubliés de l’histoire locale.
Derrière cette trame composite, il y a pourtant une dynamique structurante qui prend forme. Depuis la reconnaissance officielle de Wikimédia Canada en 2011, les bénévoles du pays jouent un rôle clé dans la consolidation d’un écosystème de savoirs partagés. Ce chapitre catalyse des projets inédits: la version en langue atikamekw de Wikipédia, des partenariats avec des institutions comme BAnQ ou des universités, des wikipédiens et wikipédiennes en résidence dans des bibliothèques et des musées.
Ce mouvement s’appuie aussi sur un engagement profond des personnes professionnelles des bibliothèques, des archives, des milieux éducatifs et culturels, qui intègrent les projets Wikimédia à leurs stratégies de médiation et de diffusion. Parallèlement, les personnes citoyennes engagées œuvrent à rendre le mouvement plus inclusif, plus équitable, en donnant une voix à des communautés historiquement marginalisées.
Tisser des communs de la connaissance, à partir du territoire, dans une logique de réciprocité entre institutions et communautés: voilà ce qui semble distinguer la trajectoire canadienne au sein de Wikimédia.
Qu’est-ce qui explique la persistance d’un profond déséquilibre entre les genres dans les ressources biographiques dans Wikimédia?
Ce déséquilibre s’explique par une combinaison de facteurs systémiques, épistémiques et culturels. D’abord, l’histoire encyclopédique dans laquelle s’inscrit Wikipédia est elle-même marquée par des siècles d’invisibilisation des femmes et des savoirs marginalisés. Les ouvrages de référence, qu’ils soient numériques ou imprimés, reproduisent souvent ces biais. Les analyses que nous avons menées à ce sujet, Simon Villeneuve et moi, révèlent qu’en moyenne moins de 15 % des biographies dans 80 dictionnaires et encyclopédies, provenant de tous les continents, sont consacrées à des personnes identifiées comme femmes — un écart qui se retrouve aussi sur Wikipédia et Wikidata, bien que dans une moindre mesure.
Mais au-delà des chiffres, le cœur du problème est structurel. Le principe de neutralité, la vérifiabilité des sources et l’interdiction des travaux inédits – piliers du projet Wikipédia – deviennent paradoxalement des freins à la visibilité des femmes, en excluant nombre de figures pour lesquelles les sources secondaires sont rares ou non reconnues. Ce cadre tend à favoriser les savoirs dominants et entrave les récits alternatifs. Ainsi, le fossé des genres n’est pas qu’un retard quantitatif: il est le reflet d’une injustice épistémique séculaire, d’un sexisme systémique profondément enraciné dans la production des savoirs, que même un projet ouvert comme Wikimédia ne peut surmonter sans réflexion critique ni action éditoriale concertée.