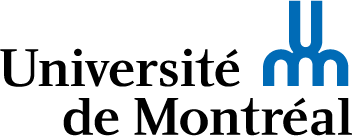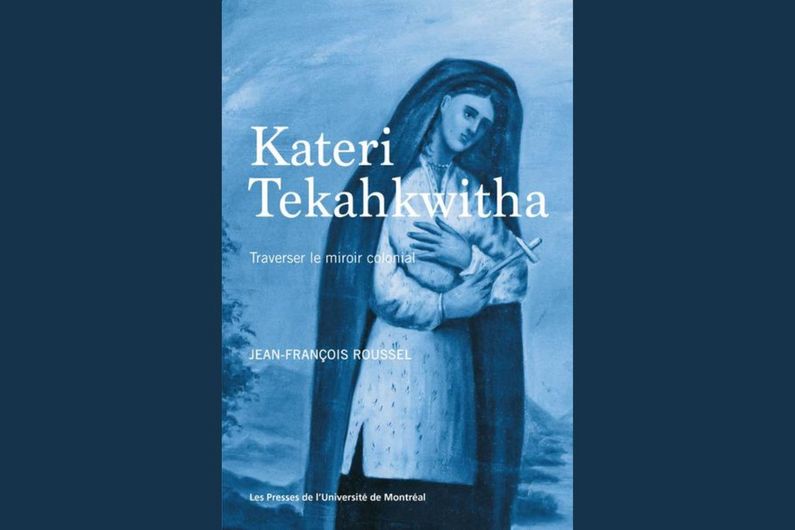Revisiter l’histoire coloniale avec Kateri Tekakwitha
- UdeMNouvelles
Le 30 novembre 2022
- Virginie Soffer
L’histoire de Kateri Tekakwitha a été écrite par des allochtones. En étudiant la construction de ce récit hagiographique, Jean-François Roussel signe un essai de théologie décoloniale interculturelle.
Le 21 octobre 2012, pendant les travaux de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, portant notamment sur un aspect sombre de l’héritage catholique en contexte autochtone, le pape Benoît XVI canonise Kateri Tekakwitha, qui devient la première sainte autochtone d’Amérique du Nord.
«Kateri nous impressionne par l’action de la grâce dans sa vie en l’absence de soutiens extérieurs et par son courage dans sa vocation si particulière dans sa culture. En elle, foi et culture s’enrichissent mutuellement! Que son exemple nous aide à vivre là où nous sommes, sans renier qui nous sommes, en aimant Jésus. Sainte Kateri, protectrice du Canada et première sainte amérindienne, nous te confions le renouveau de la foi dans les Premières Nations et dans toute l’Amérique du Nord», déclare alors le pape.
Jean-François Roussel, professeur à l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal, s’est penché sur cette histoire troublante. Pourquoi l’Église catholique a-t-elle choisi de s’intéresser à cette jeune Mohawk du 17e siècle et de l’ériger en modèle? Il revisite cette histoire dans une perspective de décolonisation dans le livre Kateri Tekahkwitha: traverser le miroir colonial.
Un modèle de paix et de réconciliation en des temps troublés
Curieusement, Kateri Tekakwitha est perçue comme faisant un pont entre la foi chrétienne et les cultures autochtones. Née en 1656 d’une mère algonquine et catholique et d’un père mohawk non baptisé, elle est présentée par l’Église catholique comme un modèle de paix et d’unité.
«Catherine avait pour mère une bonne chrétienne algonquine que les Iroquois prirent aux trois rivières pendant les anciennes guerres qu’ils faisaient contre les Hurons. […] La fortune de cette pauvre Algonquine captive fut d’être mariée aux Iroquois», a ainsi écrit l’hagiographe Claude Chauchetière en 1695.
Selon ce récit et plusieurs écrits hagiographiques, Kateri Tekakwitha perd sa mère et son frère dans des épidémies de variole. Elle en réchappe, mais sera défigurée pour le restant de sa vie et souffrira de demi-cécité, ce qui lui vaut le surnom de Tekakwitha, «elle avance en tâtonnant». Claude Chauchetière raconte, comme les autres hagiographes, qu’elle est une orpheline adoptée par un oncle cruel et par ses deux tantes.
En 1666, les soldats français rasent le village de Kateri Tekakwitha. Un nouveau village est construit. Les Mohawks et les Français font la paix. Des missionnaires arrivent et tentent de convertir les habitants. Avec difficulté, car le chef du village, l’oncle de Kateri, s’y oppose, si l’on en croit les récits hagiographiques. Lorsqu’en 1676 la jeune fille se fait baptiser, cela déclenche l’hostilité du village à son endroit. On ne comprend pas son vœu de chasteté et elle est persécutée pour ses choix religieux. Elle part alors pour la Mission Saint-François-Xavier à Kahnawake, où elle mène une vie pieuse. Les Jésuites mettent de l’avant cette figure marginale d’obéissance et la qualifient de «lys parmi les épines».
Elle meurt vers l’âge de 24 ans. Par la suite, elle est vénérée par les colons et par certains Iroquois catholiques et un culte de la guérison se répand dans diverses paroisses.
Décortiquer l’expression d’un imaginaire colonial
Le récit de Claude Chauchetière présente le mythe d’un colonialisme pacificateur. Pour confronter cet imaginaire religieux allochtone élaboré autour de Kateri Tekakwitha, Jean-François Roussel a croisé hagiographies, archives missionnaires, études historiques, études autochtones et études anthropologiques et théologiques.
«Les hagiographes œuvrent pour une conquête spirituelle, elle-même inscrite dans une conquête impériale: leurs textes sont faits pour convaincre, pour gagner un public», dit-il.
Kateri Tekakwitha n’a pas laissé de témoignages: elle ne savait pas écrire et ne parlait pas français. L’histoire provient principalement des jésuites Claude Chauchetière et Pierre Cholenec, qui l’ont connue à la Mission Saint-François-Xavier.
La jeune femme est décrite comme une personne marginalisée. «Une des raisons de sa marginalisation est qu'elle porte les séquelles de la variole. À cause de cette maladie, elle est devenue à demi aveugle et défigurée. On va ainsi trouver des représentations disant qu’elle est incapable de se joindre aux autres et qu'elle est méprisée. Mais on oublie que la variole est une maladie épidémique et que Kateri n’était qu’une personne parmi tant d'autres qui vivaient avec les séquelles de la variole. On fait également l’impasse sur la dimension collective de cette maladie, qui a été apportée par la colonisation», affirme Jean-François Roussel.
Or, en prenant en considération la culture mohawk, on pourrait plutôt penser qu’elle était une membre à part entière de sa communauté. L’historien mohawk Darren Bonaparte précise ainsi que «les sources nous enseignent que Kateri était connue pour ses compétences en tant qu’artisane traditionnelle, fabriquant tout, des paniers d’écorce, des pilons de maïs, des canots, des sangles de fardeau, des perles et même des ceintures de wampums». Pour apprendre ces difficiles techniques de perlage et de broderie, elle a dû être bien acceptée par les aînées de sa communauté. Et on devait lui témoigner une confiance toute particulière pour lui confier la fabrication de wampums, ces ceintures de perles permettant notamment d’officialiser des alliances politiques.
Autre construction narrative: comme dans un conte, Kateri Tekakwitha est présentée comme une pauvre orpheline recueillie par un oncle cruel. Or, il serait inapproprié de parler d’orphelins pour des Iroquois du 17e siècle. Les structures de parenté sont autres. «Les enfants sont plus proches de leurs oncles et tantes maternels que de leur père biologique. Les oncles maternels jouent pour les nièces et neveux le rôle de père», rappelle Jean-François Roussel.
Quant au personnage de l’oncle, «il est dépeint dans les hagiographies comme un tyran, comme un homme maître de maison extrêmement autoritaire et très impulsif, alors que les maisons sont gouvernées par des femmes, par des mères de clan», poursuit-il.
En définitive, les Jésuites tendent à décrire Kateri Tekakwitha comme une jeune fille française de cette époque plutôt que comme une Iroquoise.
L’imaginaire colonial de Kateri imprégné jusque dans les pensionnats
En rompant avec sa famille et ses traditions autochtones, Kateri Tekakwitha est présentée par l’Église catholique comme une sainte. Jean-François Roussel montre que cet imaginaire colonial qui met glorieusement en scène le déracinement de jeunes Autochtones se concrétisera tragiquement lors de la création des pensionnats. Ainsi peut-on lire ce témoignage glaçant d’une jeune femme sur son passage dans les pensionnats au cours des audiences de la Commission de vérité et réconciliation du Canada:
«Je détestais tout à fait mes propres parents. Non pas parce que je croyais qu’ils m’avaient abandonnée; je haïssais leurs visages basanés. Je les détestais parce qu’ils étaient indiens […] Alors j’ai regardé mon père et je l’ai défié. J’ai dit: “À partir de maintenant, nous ne parlerons qu’anglais dans cette maison.” Vous savez, lorsque, dans toute maison traditionnelle, comme celle où j’ai été élevée, la première chose qui nous est enseignée est de toujours respecter nos aînés, vous savez, les défier.»
Nous ne pouvons évidemment pas savoir si Kateri Tekakwitha a éprouvé de tels sentiments à l’égard de sa famille. Nous pouvons simplement lire son récit écrit par les missionnaires comme la célébration d’une rupture analogue et ne pouvons qu’être frappés par la reprise de cet élément lors de la canonisation de Kateri en 2012, au moment même où la Commission de vérité et réconciliation du Canada déclare qu’«une véritable réconciliation n’est possible qu’en remodelant la mémoire collective que nous partageons tous, c’est-à-dire la perception de notre identité et de ce qui nous a précédés».
Jean-François Roussel, Kateri Tekahkwitha: traverser le miroir colonial, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2022, 232 p.