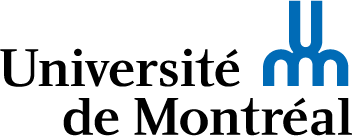Le trafic d'armes à feu au Québec: un phénomène loin d’être exclusif au crime organisé
- UdeMNouvelles
Le 16 décembre 2024
- Martin LaSalle
Le trafic d’armes à feu au Québec n’est pas tant alimenté par le crime organisé que par des gens opportunistes impliqués dans ce trafic de multiples façons, selon une étude réalisée à l’UdeM.
Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas tant les réseaux criminels organisés qui alimentent le commerce illégal d’armes à feu au Québec que des gens opportunistes et des fabricants artisanaux bien préparés.
C’est l’un des constats qui se dégage d’un projet de recherche réalisé par Étienne Blais, professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, et son collègue David Décary-Hétu, en collaboration avec Benoît Leclerc, de l’Institut Griffith de criminologie en Australie.
Publiée dans l’édition de novembre-décembre du Journal of Criminal Justice, l’étude repose sur 76 enquêtes de la Sûreté du Québec, menées pour la plupart entre 2010 et 2020. Les auteurs proposent une analyse de scripts, soit une méthode qui permet d'examiner le phénomène du trafic d’armes à feu depuis la préparation jusqu'à la vente en s'appuyant sur diverses sources d'information présentes dans les dossiers d’enquête: rapports d'incidents, transcriptions de déclarations, comptes rendus de surveillance et formulaires de saisie, etc.
Des trafiquants aux profils inattendus
Premier constat: environ 20 % des trafiquants sont impliqués dans le commerce à grande échelle (20 armes ou plus). «Dans la majorité des cas, les transactions sont effectuées de façon opportuniste, explique Étienne Blais. Il peut s'agir, par exemple, d'un cambrioleur qui trouve une arme non sécurisée lors d'un vol ou de propriétaires inscrits d'armes qui, ayant besoin d'argent, décident de les vendre illégalement.»
L'étude révèle que les suspects sont majoritairement des hommes blancs (92 %), âgés en moyenne de 39 ans. Fait notable, 42 % avaient des antécédents criminels et 34 % n'avaient pas le droit de posséder des armes. Généralement, de une à quatre personnes interviennent dans les transactions.
Comment expliquer que le crime organisé traditionnel soit peu présent dans ce trafic?
«Les membres du crime organisé ont déjà leurs armes et ne souhaitent pas vendre à n'importe qui en raison des dommages collatéraux qui pourraient survenir et éveiller les soupçons de la police, et aussi parce que ce n’est pas très payant, puisqu’il s’agit d’un bien durable, contrairement à la drogue par exemple», précise le chercheur. Selon lui, la situation pourrait avoir évolué récemment avec la demande croissante liée aux activités des gangs de rue.
Un arsenal diversifié et des méthodes sophistiquées
Le processus de trafic d’armes suit généralement six étapes distinctes: la préparation (incluant l'obtention de permis ou la formation), l'acquisition des armes (par achat légal ou illégal, vol ou fabrication), le stockage, la recherche de clients, la transaction proprement dite et la sortie.
L'un des aspects que l’étude met en lumière est l’accroissement de la fabrication artisanale d'armes. Les trafiquants se montrent particulièrement ingénieux à cet égard: ils suivent des formations de machiniste et acquièrent légalement le matériel nécessaire (feuilles d'acier, tubes en métal, presses hydrauliques, imprimantes 3D) pour produire des armes dans leur sous-sol ou leur garage.
Les transactions examinées mettent au jour le trafic d’un arsenal varié: 76 armes longues, 43 armes de poing, 9 armes automatiques ou prohibées et 52 armes fabriquées artisanalement. Des munitions étaient présentes dans 18 cas. De même, la majorité des transactions (84 %) portaient sur deux armes ou moins, semblant indiquer un trafic à petite échelle mais diffus.
Dans les cas de trafics à grande échelle, qui représentent 21 % des enquêtes, la planification est plus minutieuse, les opérations comprenant souvent plusieurs délinquants, des sources multiples d'acquisition et l'utilisation systématique d'intermédiaires.
Des stratégies de vente en évolution
Contrairement aux craintes souvent exprimées, le Web caché ne joue pas un rôle prépondérant dans le trafic d'armes au Québec. Les chercheurs notent que les contrevenants y sont peu présents en raison tant de la faible rentabilité des transactions que de la forte présence policière sur ces plateformes.
«Les méthodes de vente s'avèrent néanmoins variées et ingénieuses, indique Étienne Blais. Dans certains cas, les trafiquants surveillent les clubs de tir pour connaître les types d'armes commandées par leurs clients, tandis que d'autres exploitent les différences législatives en écoulant leurs armes dans une autre province, dont l’Ontario, qui ne tient pas de registre des armes à feu, ce qui permet de faire disparaître la trace des armes vendues.»
L'étude, qui a été financée par le ministère de la Sécurité publique du Québec, révèle aussi que les transactions ne concernent pas uniquement des armes prohibées. Certaines concernent des armes longues sans restriction qui ont été légalement acquises, mais qui sont échangées contre d'autres biens au décès de leur propriétaire.
Des recommandations pour prévenir le trafic d’armes à feu
Les auteurs de l’étude proposent différentes approches plus préventives que coercitives, entre autres de renforcer la surveillance des outils et matériaux pouvant servir à la fabrication d'armes artisanales.
Ils suggèrent également d'intensifier la formation des vendeurs d'armes pour mieux détecter les transactions suspectes.
L'harmonisation des registres d'armes entre provinces constitue une autre priorité, selon eux. «Cette mesure permettrait de combler les lacunes exploitées par les trafiquants, qui profitent actuellement des disparités règlementaires interprovinciales, conclut Étienne Blais. La coordination entre les différents acteurs apparaît aussi comme un élément clé: services de police, autorités frontalières, vendeurs d'armes doivent collaborer afin d’assurer une meilleure surveillance des transactions suspectes et une sensibilisation accrue du public.»
À propos de cette étude
L’article «1200 paths and counting: A script analysis of firearms trafficking in the Province of Quebec, Canada», par Étienne Blais et ses collègues, a été publié dans l’édition de novembre-décembre du Journal of Criminal Justice.