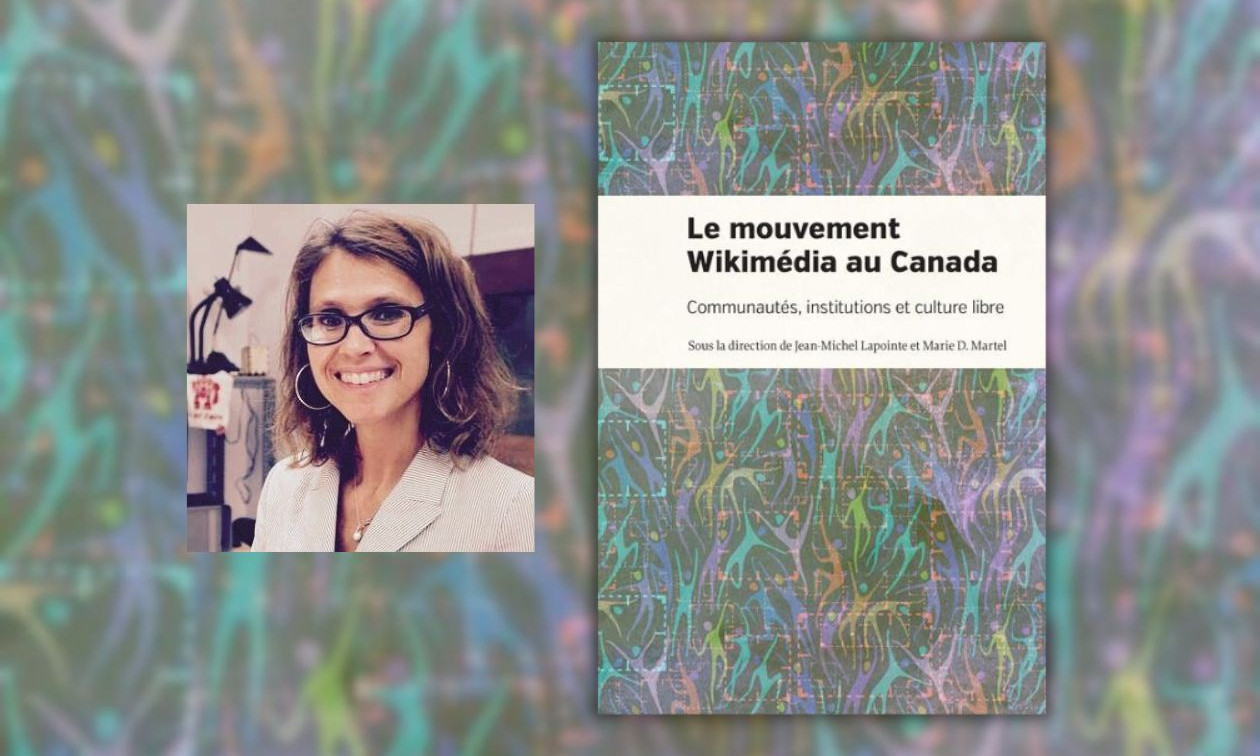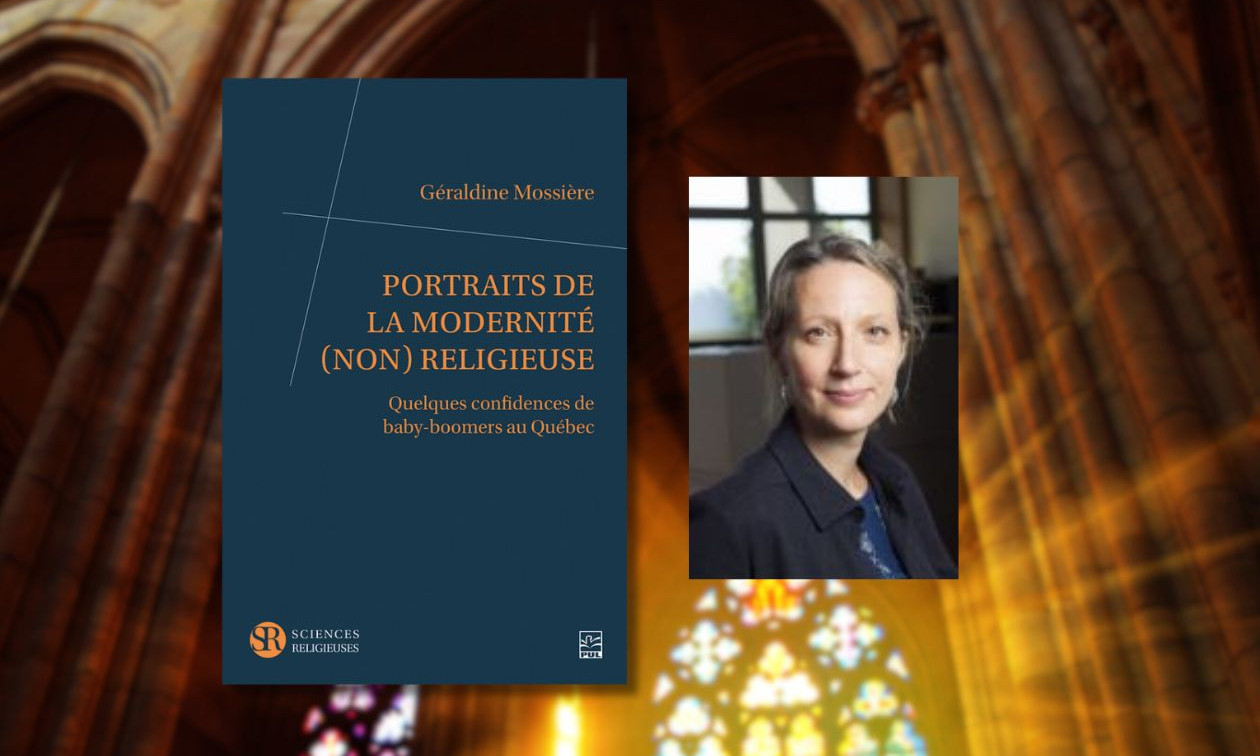Développer la pensée historienne à l'école

Dans la série
«Entre guillemets» Article 29 / 35
Comment l’histoire est-elle enseignée et comprise? Tel est l’objet du livre Développer la pensée historienne, dirigé par Marc-André Éthier, professeur de didactique à l’Université de Montréal, et David Lefrançois, professeur en sciences de l’éducation à l’Université du Québec en Outaouais. Cet ouvrage collectif met en avant l'importance de développer un regard critique chez les élèves et explique comment les enseignants et enseignantes d’histoire choisissent leurs outils et adaptent leurs pratiques. Il explore aussi les objectifs des programmes scolaires et la manière dont les élèves utilisent les connaissances historiques pour mieux comprendre le monde qui les entoure.
Nous nous sommes entretenus avec Marc-André Éthier.
Quelles motivations ont guidé la réalisation de cet ouvrage collectif? Y avait-il une volonté de répondre à des défis observés sur le terrain?
Ce livre est né du constat d’un manque: aucun ouvrage n’offrait une vue d’ensemble sur une question essentielle, aussi bien pour nos cours destinés aux futurs enseignants et enseignantes que pour les ateliers de formation continue dans les congrès professionnels. En histoire, il n’existait pas de synthèse sur les processus qui conduisent à enseigner, apprendre et évaluer la discipline à l’école, ce que la didactique appelle la «transposition didactique». Nous avons donc réuni des spécialistes pour faire le point sur les recherches récentes concernant la création de programmes, le matériel didactique comme les manuels, les représentations du personnel enseignant et des élèves ainsi que leurs pratiques et interactions. Nous avons choisi d’aborder ce sujet sous l’angle de la pensée historienne, un concept clé selon nous pour saisir les finalités et les effets de cette transposition.
Comment expliqueriez-vous la pensée historienne à quelqu’un qui ne connaît pas ce concept?
Je m’inspire d’abord d’André Ségal, didacticien aujourd’hui retraité. Selon lui, toute personne qui s’interroge sur un phénomène du passé est active. L’objet de cette réflexion est historique, mais l’action est «historienne». Cette démarche prend différentes formes, mais on attend d’un historien ou d’une historienne qu’il ou elle réfléchisse sur un objet du passé, mène une enquête sur les traces laissées par cet objet, constitue ou exploite un corpus de sources variées et soumette ses questions, sa méthode et ses réponses argumentées à la critique et au débat, en respectant des normes partagées. On peut donc parler d’une pensée, voire d’un ethos, d’une praxis ou d’un raisonnement, plus que d’une méthode.
De nombreux didacticiens et didacticiennes de l’histoire estiment que cette pensée favorise l’autonomie intellectuelle des élèves, car elle repose sur des opérations de questionnement et d’analyse critique des preuves, comme le croisement des sources. Ils soutiennent que l’enseignement de l’histoire devrait s’appuyer sur ces démarches, en mettant l’accent sur l’importance du questionnement. Les élèves comprendraient ainsi pourquoi il est essentiel de s’interroger, par exemple, sur l’intention de l’auteur d’une source et deviendraient plus critiques à l’égard des discours qui cherchent à influencer leurs croyances et comportements.
Quand on enseigne l’histoire au Québec, quelles définitions de la pensée historienne sont privilégiées?
Selon Peter Seixas, l’enseignement de l’histoire se divise en trois courants principaux. Le courant positiviste met l’accent sur l’acquisition de faits et la transmission d’un récit du passé perçu comme objectif et immuable, favorisant la mémorisation pour justifier la perspective d’un groupe. Le courant disciplinaire valorise l’enquête historique et la méthode critique, encourageant les élèves à analyser des sources, formuler des hypothèses, contextualiser les évènements et construire leurs propres interprétations. Le courant postmoderne, quant à lui, remet en cause l’objectivité de l’histoire en soulignant la subjectivité des interprétations et la nécessité de déconstruire les récits dominants en intégrant des perspectives multiples.
Pour Mathieu Bouhon et Jean-Louis Jadoulle, les enseignants et enseignantes oscillent plutôt entre trois approches. D’abord, certaines personnes présentent un récit exemplaire pour que les élèves l’intériorisent, ce qui est souvent vu comme rétrograde ou vain, même si des discours progressistes peuvent aussi reproduire un dogmatisme vertueux. Ensuite, d’autres placent les élèves en situation d’apprentissage autonome, ce qui demande du temps et aboutit souvent à des échecs. Enfin, certains enseignent la problématisation et l’investigation.
Au Québec, les enquêtes montrent que les enseignants et les enseignantes d’histoire au secondaire adoptent des approches hybrides, labiles et variées, bien que leurs pratiques s’alignent surtout sur les courants positiviste et disciplinaire. L’influence des épreuves uniques des examens ministériels de quatrième secondaire pèse dès la première année du secondaire, car la réussite des élèves est une priorité. Comme les évaluations valorisent davantage un simulacre de la démarche disciplinaire ou problématisante, le cours conduit le plus souvent à s’entraîner à appliquer machinalement une recette pour lire des ersatz de sources, d’habitude des témoignages volontaires, des écrits officiels à propos de la politique, mais surtout des textes courts qui ne nécessitent pas d’analyses ou de critiques. Ces textes sont choisis par le personnel enseignant pour permettre aux élèves de répondre à des questions qui les indiffèrent souvent de sorte que les élèves mobilisent peu d’outils de l’histoire pour analyser ou produire des discours dans des situations sortant de la forme scolaire. Au final, ils ne voient pas l’histoire comme un moyen de penser et d’agir, mais comme un pensum qui sert à se distinguer ou à être sélectionnés.
Quels types d’outils ou de manuels aident le mieux à transmettre la pensée historienne?
Bien que les cahiers d’exercices et les manuels scolaires soient souvent utilisés dans l’enseignement de l’histoire, ils sont rarement conçus pour favoriser le développement de la pensée historienne. Les manuels ont tendance à présenter l’histoire comme un récit unique et objectif, ce qui peut amener les élèves à croire que l’histoire est une question de mémorisation de faits avec une chaîne causale simple dont l’interprétation est univoque et coule directement des sources.
Malgré tout, les manuels peuvent être utilisés de manière plus efficace pour développer la pensée historienne. Par exemple, les enseignants et les enseignantes peuvent présenter aux élèves différents points de vue sur un évènement historique décrit par le manuel pour faire voir les angles oubliés, puis encourager les élèves à analyser les sources primaires qu’il contient en se demandant ce qu’il manque pour trancher et comment combler ce manque.
On peut faire de même autant avec toute interprétation du passé qui ne prétend pas présenter une version vérifiable de celui-ci, comme les romans, les jeux vidéos, les téléséries, etc., qu'avec les documentaires ou les exposés magistraux.
Il n’y a donc pas de bon manuel en soi pour que se développe la pensée historienne. La valeur d’un moyen d’enseignement dépend de la signifiance, de la pertinence et de l’économie de l’exploitation qu’on en fait: l’interaction des élèves avec ce moyen inhibe-t-elle ou promeut-elle un questionnement et un usage des outils mentaux voulus? La tâche convient-elle aux finalités du cours, c’est-à-dire amener les élèves à débattre avec rigueur et tolérance, puis à agir par eux-mêmes de façon plus critique, éclairée, réfléchie? Est-il possible d’arriver au même résultat plus simplement ?
À propos de ce livre
Sous la direction de Marc-André Éthier et David Lefrançois, Développer la pensée historienne à l'école, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2024, 286 p.