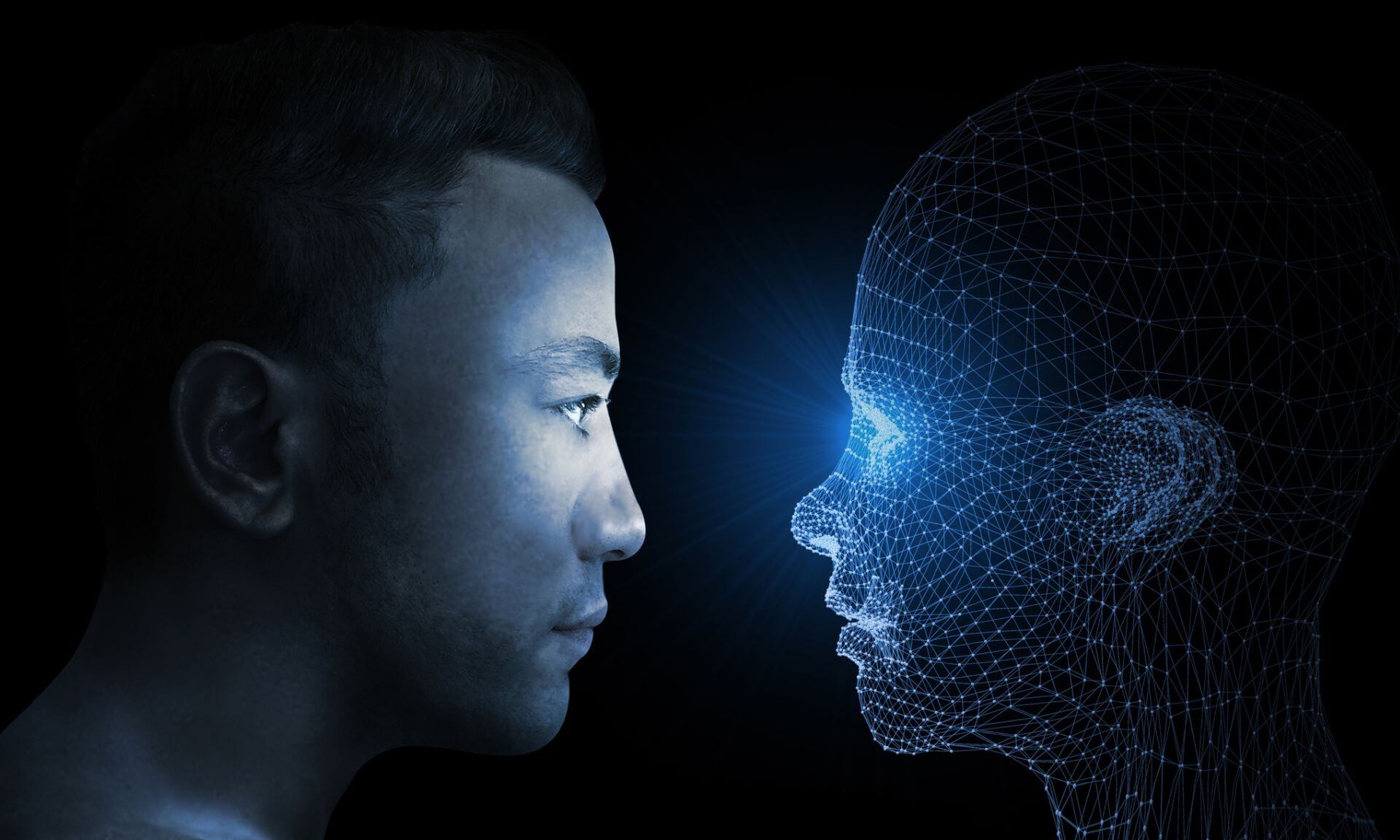Comment la pandémie a transformé la science ouverte


La pandémie de COVID-19 a bouleversé la manière dont la science est diffusée et partagée. Face à l’urgence sanitaire, de nouvelles pratiques ont accéléré l’accès aux résultats scientifiques, remettant en question certains modèles établis.
Pour mieux comprendre ces transformations et leur influence à long terme, nous nous sommes entretenus avec Vincent Larivière, professeur à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire UNESCO sur la science ouverte.
Quels sont les changements relatifs à la science ouverte qui ont émergé durant la pandémie?
Cinq changements majeurs ont émergé: l’essor des prépublications, la remise en question du processus d’évaluation par les pairs, l’ouverture des données, l’accès libre aux publications et l’importance du multilinguisme.
Face à l’urgence sanitaire, la nécessité d’accéder rapidement aux résultats scientifiques a favorisé l’essor des prépublications. Ces articles, diffusés avant leur évaluation par les comités de lecture, permettaient à la communauté scientifique d’analyser et de commenter les résultats en temps réel, notamment par les réseaux sociaux comme Twitter. La pandémie a également mis en lumière les limites de l’évaluation par les pairs. Ce processus, bien que central dans la validation scientifique, n’est pas infaillible: certains articles validés ont été rétractés par la suite, soit en raison de données falsifiées, soit à cause de biais dans le choix des évaluateurs, comme ce fut le cas des publications sur l’hydroxychloroquine de Didier Raoult.
Un autre changement significatif a été de rendre accessibles les données, en particulier celles liées à la COVID-19. Cela permettait à un plus grand nombre de chercheurs et chercheuses de les analyser et d’accélérer la compréhension du virus. Toutefois, cette tendance s’est estompée après le pic de la pandémie faute de mesures incitatives suffisantes pour la maintenir.
Durant la crise sanitaire, de nombreux éditeurs commerciaux ont temporairement rendu accessibles des articles sur le coronavirus. Cependant, une fois la situation stabilisée, ces contenus ont été refermés. L’accessibilité des publications scientifiques a progressé depuis la pandémie, mais moins fortement que ce qu’on avait espéré.
La crise a révélé la nécessité de diffuser les résultats scientifiques dans plusieurs langues, en particulier pour toucher les communautés de praticiens qui ne maîtrisent pas forcément l’anglais. Cette prise de conscience a encouragé la mise en place de certaines initiatives en faveur du multilinguisme, même si la diffusion scientifique reste largement dominée par l’anglais, en particulier dans le domaine médical.
Enfin, la pandémie a soulevé la question de l’évaluation ouverte: au-delà de l’accès aux articles, certains ont plaidé pour la publication des commentaires et avis des évaluateurs. Bien que cette pratique reste encore marginale, elle pourrait contribuer à renforcer la transparence et la confiance dans la recherche scientifique.
Que reste-t-il de la science ouverte depuis la pandémie?
Aujourd’hui, la situation est bien différente. Si la pandémie a démontré l’efficacité de la science ouverte, la plupart des pratiques d’avant la crise sanitaire ont repris. L’évaluation par les pairs reste la norme et la croissance des prépublications s’est essoufflée. Et bien que le libre accès se soit développé, il ne domine pas encore complètement la publication scientifique.
Il subsiste une certaine dynamique en faveur de la science ouverte, mais bien moins forte qu’au pic de la pandémie, en 2020, où l’urgence avait conduit à une diffusion maximale des connaissances.
Comment envisagez-vous la suite pour la science ouverte?
Pour ce qui est du libre accès, l’évolution est positive. Au Canada, les gouvernements encouragent la diffusion des recherches en accès libre, et cette pratique deviendra probablement la norme sans soulever de grandes controverses.
En revanche, l’ouverture des données est plus complexe, entre autres en raison des questions liées à l’anonymisation des participants dans certains domaines, contrairement aux sciences naturelles, où ces contraintes sont moindres. L’évaluation ouverte des publications devrait, elle aussi, continuer à se développer.
Quels sont les effets des récentes évolutions de la politique scientifique américaine sur la science ouverte et la recherche à l’échelle mondiale?
Les incertitudes actuelles autour de la politique scientifique américaine sont très préoccupantes. Aux États-Unis, les informations sur le libre accès et la science ouverte ont récemment disparu des sites des organismes de financement, suscitant de vives inquiétudes. Étant donné que les États-Unis restent le principal investisseur en recherche et développement, ces évolutions risquent d’avoir des répercussions un peu partout, y compris au Canada.