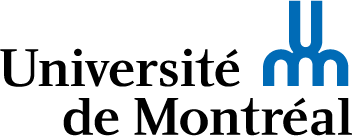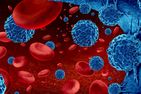Virus du papillome humain: une forte immunité collective observée
- UdeMNouvelles
Le 14 avril 2025
La prévalence des quatre principaux génotypes du VPH est inférieure à un pour cent chez les jeunes Québécois non vaccinés de 16 à 20 ans, nous apprend une nouvelle étude.
Moins de 20 ans après l’introduction du programme de vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) au Québec, les données révèlent une efficacité si marquée du programme que même les jeunes non vaccinés bénéficient d’une forme d'immunité.
«L'efficacité du vaccin combinée avec l'excellente couverture vaccinale contre le VPH au Québec ont permis de créer une immunité de groupe qui protège les individus non vaccinés», souligne François Coutlée, professeur émérite de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et chercheur au laboratoire de microbiologie du CHUM. Il est également coauteur d’une récente étude à ce sujet publiée dans le Journal of Infectious Diseases.
Une couverture vaccinale efficace qui profite à tous
Ce constat est partagé par Chantal Sauvageau, professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval, qui a dirigé l’étude. Elle note que la circulation du virus est désormais extrêmement faible. «Cela démontre que le programme fonctionne très bien et qu'il faut maintenir le cap», dit-elle.
Le VPH est un virus sexuellement transmissible dont certains génotypes peuvent causer des cancers, notamment du col de l’utérus, de la gorge, de l’anus et du pénis. Il est également responsable des condylomes génitaux. Sur plus de 200 génotypes du VPH recensés, au moins 12 sont reconnus comme étant oncogènes.
Le programme de vaccination québécois a débuté en 2008, d’abord auprès des filles de 9 à 17 ans et le vaccin ciblait les quatre génotypes les plus préoccupants. Depuis 2016, le programme inclut aussi les garçons et le vaccin est étendu à neuf génotypes du VPH. Depuis septembre 2024, le vaccin est offert à tous les jeunes de 9 à 20 ans.
Les cinq membres de l’équipe de recherche ont voulu vérifier si l’immunité collective était bel et bien présente. Pour ce faire, l’équipe a évalué la prévalence du VPH chez 369 jeunes hommes âgés de 16 à 20 ans, non vaccinés mais sexuellement actifs, recrutés entre septembre 2020 et août 2022. Résultat: seulement 0,5 % d’entre eux étaient porteurs de l’un des quatre génotypes du VPH ciblés par les premiers vaccins utilisés dans le programme de vaccination auprès des filles du même groupe d’âge.
Un nouveau défi pour le suivi du programme
Pour mettre ce chiffre en perspective, une étude menée avant l’instauration du programme de vaccination révélait que le génotype 16 du VPH – l’un des plus dangereux – était présent chez 16 % des hommes de 18 à 24 ans. Depuis, la circulation du virus a chuté de façon spectaculaire. Selon la Dre Sauvageau, cette faible prévalence indique que, si la couverture vaccinale se maintient, l’élimination des principaux génotypes oncogènes du VPH est envisageable. L’effet de la vaccination est donc majeur.
Une protection indirecte… mais pas suffisante
Bien que les jeunes non vaccinés semblent en ce moment protégés, la vaccination reste essentielle pour assurer une protection individuelle et maintenir l’immunité de groupe. «La vaccination demeure le moyen le plus efficace pour se protéger contre les cancers liés au VPH. Il ne faut pas compter uniquement sur l’immunité collective», insiste la Dre Marie-Hélène Mayrand, directrice du Département d'obstétrique-gynécologie de l’Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche du CHUM.
Source: Université Laval.
À propos de cette étude
L’article «Prevalence of Human Papillomavirus Genotypes in Unvaccinated 16- to 20-Year-Old Men in Quebec, Canada», par Catherine Wolfe, Iulia Gabriela Ionescu, Marie-Hélène Mayrand, François Coutlée et Chantal Sauvageau, est paru dans le Journal of Infectious Diseases le 21 février 2025.