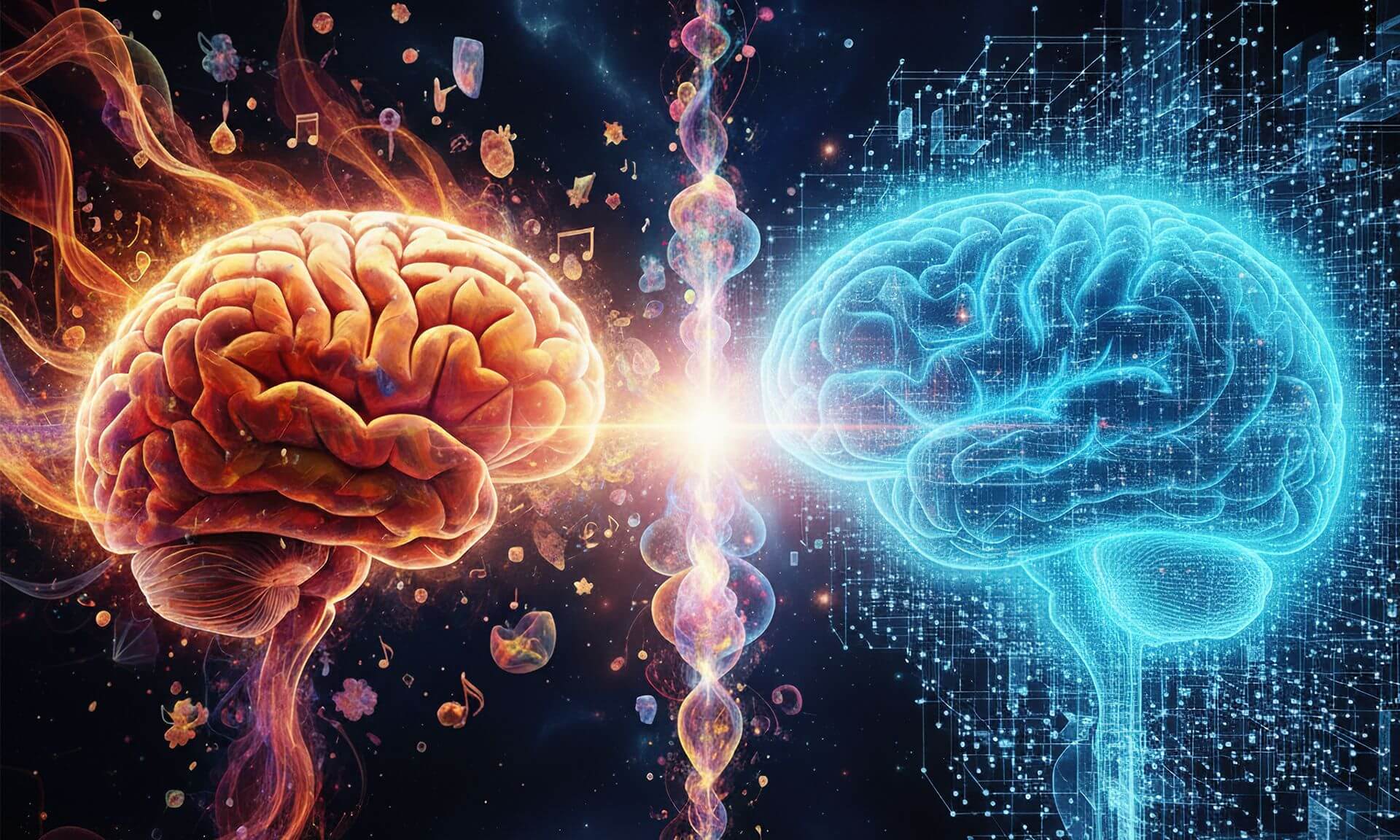Les télés numériques menacent la culture francophone et l’industrie culturelle canadienne

Dans un contexte où 42% des foyers canadiens ont coupé le câble, un nouveau phénomène transforme silencieusement le paysage audiovisuel: les plateformes de télévision en ligne gratuite avec publicités, aussi connues sous le nom de chaînes FAST, pour Free Ad-supported Streaming Television.
Au nombre de 400 au pays, ces chaînes soulèvent des questions cruciales sur l’avenir de la culture francophone et autochtone du Canada, selon Marie-Odile Demay-Degoustine, chargée de cours au Département d’histoire de l’art, de cinéma et des médias audiovisuels de l’Université de Montréal et chercheuse qui collabore à un projet de recherche du Labo Télé.
Avec la professeure Marta Boni et les doctorantes Frédérique Khazoom et Meganne Rodriguez-Caouette, elle cosigne un article publié récemment sur le site de La Conversation dans lequel elles tirent la sonnette d’alarme sur les conséquences de ce modèle économique émergent qui échappe largement à la réglementation traditionnelle.
Une réponse à la fatigue de la télé payante
Selon la chercheuse, l’émergence des chaînes FAST s’explique par une lassitude généralisée après l’explosion des plateformes de diffusion en continu, pendant la pandémie. «Nous avons été nombreux à nous abonner à Netflix, Amazon, Disney pendant la pandémie, explique-t-elle. À la fin, on s’est rendu compte que c’était non seulement coûteux, mais qu’on ressentait aussi une fatigue de choix.»
Les chaînes FAST proposent une solution séduisante: un retour à la télévision linéaire, mais gratuite et accessible via Internet. Comme les chaînes traditionnelles, elles diffusent une programmation continue avec des publicités toutes les 8 à 10 minutes.
Les FAST sont accessibles sur les télévisions dites intelligentes que produisent notamment Samsung, Roku et autres, ainsi que par Internet, sur les plateformes spécialisées comme Pluto TV et Tubi.
Chaque chaîne a une programmation très spécialisée et diffuse des propriétés intellectuelles populaires, comme CSI, Cheers, Mr. Bean, ou des programmations thématiques: des comédies de situation rétro, des documentaires, des émissions de téléréalité, des contenus insolites comme des feux de foyer en continu, ainsi que du sport et des nouvelles nationales diffusés en direct.
Au Canada, ces plateformes rejoignent déjà 24% des consommateurs de contenus en ligne. Le succès se mesure par des événements marquants: aux États-Unis, Tubi (propriété de Fox Corporation) a diffusé le Super Bowl en février 2025 et a rejoint 13,6 millions de spectateurs.
Un modèle basé sur la surveillance des données

Derrière cette gratuité apparente se cache un modèle économique dominant. «Le côté sombre, c’est la façon de monétiser des données massives sur nos habitudes de consommation, souligne Marie-Odile Demay-Degoustine. Les téléviseurs connectés collectent en permanence des informations grâce à des captures d’écran régulières et au suivi minutieux des comportements.»
Cette surveillance va bien au-delà de la mesure d’audience traditionnelle. Tous les choix sont profilés: changement de plateforme, d’émission, temps passé sur chaque contenu, moments de pause… Cette série d’actions constitue un portrait détaillé vendu à des tiers. À cela s’ajoutent des revenus publicitaires en constante augmentation, et qui devraient dépasser 100 % d’ici trois à quatre ans, selon les analystes consultés.
Une hégémonie culturelle américaine renforcée
L’une des principales problématiques de ce modèle concerne la représentation culturelle. Sur Pluto TV Canada, seules trois chaînes en français sont disponibles, tandis que Tubi Canada ne présente actuellement aucun contenu francophone. Le contenu autochtone brille par son absence totale, ce qui illustre «une négligence flagrante envers la diversité culturelle canadienne», ajoute la chercheuse.
Cette situation contraste avec les obligations des télédiffuseurs traditionnels canadiens, qui doivent présenter 50 % de contenu canadien sous surveillance du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Les FAST échappent à cette réglementation et proposent essentiellement du contenu américain qui «traverse la frontière, c’est un véritable Far West», déplore-t-elle.
L’érosion du financement de la culture locale
Au Canada, le modèle traditionnel de financement repose sur les contributions des câblodistributeurs: celles-ci diminuent à mesure que les consommateurs abandonnent leurs abonnements. Les FAST, dans l’état actuel des choses, contribuent à réduire les ressources financières qui devraient servir à produire du contenu télévisuel canadien.
«Cette érosion crée un cercle vicieux: avec une prévision d’abandon du câble qui devrait atteindre 50% des foyers au pays, les ressources pour la production locale vont s’amenuiser davantage et cette diminution touche particulièrement les contenus francophones et autochtones, déjà fragilisés par leurs marchés restreints», s’inquiètent Marie-Odile Demay-Degoustine et ses collègues.
Des mesures réglementaires insuffisantes
Face à ces défis, les gouvernements tentent de réagir, mais leurs mesures semblent dépassées. En avril 2023, le Canada a adopté la Loi sur la diffusion continue en ligne, exigeant que les services générant plus de 25 millions de dollars versent 5% de leurs revenus à des fonds culturels.
Selon la chercheuse, cette approche néglige cependant les aspects culturels cruciaux. «Aucune réglementation culturelle n’a été instaurée, et les règles claires ne devraient être émises qu’en 2026, laissant un vide réglementaire de plusieurs années», ajoute-t-elle.
Au Québec, le projet de loi 109 sur la découvrabilité des contenus francophones tente de répondre à ces enjeux, mais son effet reste incertain puisque le projet de loi est encore à l’étude et qu’aucun règlement n’a encore été rédigé.
Vers des solutions inspirées de modèles internationaux
Les cosignataires citent l’Australie comme exemple prometteur. Ce pays a obligé les manufacturiers de téléviseurs à intégrer automatiquement les grandes chaînes australiennes dans leurs interfaces, sous peine d’amendes.
Une stratégie similaire pourrait être appliquée au Canada avec l’intégration obligatoire de CBC, Radio-Canada et Télé-Québec dans les téléviseurs connectés. «Il faut d’abord rendre le contenu canadien et québécois visible, avance Marie-Odile Demay-Degoustine. Si on ne nous présente que du contenu américain, le consommateur ne peut pas savoir qu’il existe autre chose.»
À l’issue de leur recherche, les chercheuses prépareront d’ailleurs un livre blanc exhaustif sur la situation des chaînes FAST au Canada, qui reposera sur des entrevues avec des spécialistes mondiaux. Un colloque international est prévu pour 2026 pour discuter de solutions concrètes.
L’enjeu s’étend aux médias sociaux comme YouTube, TikTok et Instagram, qui participent à cette fragmentation de l’attention et à la monétisation des données personnelles. «Avec une approche réglementaire adaptée, les FAST pourraient devenir une occasion de renforcer l’identité culturelle canadienne, autochtone et québécoise», espère la chercheuse, qui souligne l’importance d’une volonté politique forte et d’une collaboration entre les diverses parties prenantes.