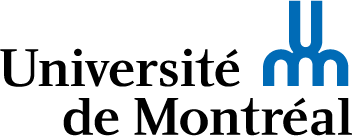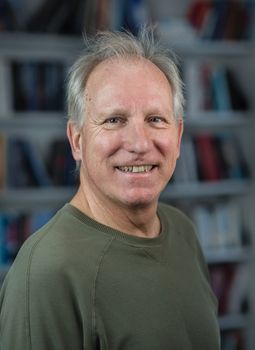Dans les coulisses de l’ONU
- UdeMNouvelles
Le 24 mai 2024
- Virginie Soffer
Dans leur nouveau livre, les professeurs Jean-Philippe Thérien et Vincent Pouliot font valoir que les politiques mondiales résultent d'un bricolage politique plutôt que d'une planification ordonnée.
Changements climatiques, flux massifs de populations, guerre en Ukraine, multiplication des normes technologiques pour la circulation des biens, la gouvernance mondiale est partout. Mais comment fonctionne-t-elle? Si la question semble simple, la réponse s’avère bien plus complexe, comme l'expliquent les professeurs de science politique Jean-Philippe Thérien, de l’Université de Montréal, et Vincent Pouliot, de l’Université McGill, dans leur livre Comment s’élabore une politique mondiale: dans les coulisses de l’ONU, publié aux Presses de Sciences Po.
Tenant compte du fait qu'il était impossible d’examiner toutes les politiques mondiales en un seul ouvrage, les professeurs se sont concentrés sur l’Organisation des Nations unies (ONU). Ils ont ainsi examiné de façon approfondie trois politiques onusiennes dans les domaines du développement, des droits de la personne et de la sécurité: l’adoption des objectifs de développement durable en 2015, l’institutionnalisation du Conseil des droits de l’homme à partir de 2005 et la promotion de la protection des civils dans les opérations de paix à partir des années 2000.
Les auteurs remettent en question l’idée reçue que la gouvernance mondiale se résumerait aux simples modalités techniques de la production de biens publics mondiaux. Ils soutiennent plutôt que la fabrique des politiques mondiales est un processus traversé par des jeux de pouvoir et des conflits idéologiques permanents.
Comment s’accorder sur une politique mondiale?
La question des valeurs à privilégier dans l'élaboration des politiques mondiales suscite des débats particulièrement intenses. L'impasse de la politique de réforme du Conseil de sécurité en est à cet égard un bon exemple. Certains insistent sur l'efficacité comme critère prédominant, arguant que la capacité d'action est primordiale pour assurer la paix internationale. D'autres, en revanche, mettent en avant la nécessité d'une démocratisation accrue, critiquant la domination du Conseil de sécurité par cinq grandes puissances qui reflètent le monde de 1945 et non pas celui d'aujourd'hui. Par ailleurs, il est remarquable que ceux qui souhaitent un conseil de sécurité plus démocratique ne soient pas d'accord sur la manière de définir la démocratie! Autre exemple: bien que la communauté internationale soit unanime pour dire que la protection des civils devrait être une priorité, les États sont loin de s'entendre sur l’utilisation de la force dans les opérations de paix.
«Un survol même très sommaire de la gouvernance mondiale montre que les acteurs sont souvent en désaccord non seulement sur la nature des problèmes, mais aussi sur les objectifs qu’ils veulent atteindre et sur les voies à emprunter pour y parvenir», soutiennent les auteurs dans leur ouvrage, mettant ainsi en lumière les défis inhérents à la gouvernance mondiale, où la diversité des intérêts en présence rend difficiles la recherche d'un consensus et la définition de politiques efficaces et légitimes.
Ni solutions techniques ni solutions rationnelles
«Il est grand temps d’abandonner l’idée qu’il existerait un ensemble de solutions techniques ou rationnelles permettant de résoudre les problèmes mondiaux une bonne fois pour toutes. En réalité, la fabrique des politiques mondiales est fondamentalement politique. Par conséquent, la formule “si seulement les gens pouvaient se mettre d’accord, nous vivrions dans un monde meilleur” est une idée courante qui s’avère profondément problématique dans l’analyse de la gouvernance mondiale. N’importe quel plan d’action collectif est voué à favoriser certains groupes davantage que d’autres, de même qu’à incarner une vision particulière du bien commun au détriment d’autres perspectives», expliquent les deux professeurs.
Un bricolage à l’échelle mondiale
Le livre emprunte à Claude Lévi-Strauss la métaphore du bricolage pour décrire l’agencement improvisé des composantes matérielles et idéologiques à partir desquelles les politiques mondiales sont élaborées.
«L'image du bricolage, où il n'y a pas de plan directeur, rend très bien compte de la façon dont les politiques mondiales sont fabriquées. Pour illustrer ce point, je pense à un des deux diplomates qui a été responsable de la négociation des objectifs de développement durable en 2015. Après coup, il a admis de façon très candide qu’au début des négociations personne ne savait où le processus s'en irait», note Jean-Philippe Thérien.
Des points communs pour l’élaboration des politiques mondiales
À travers l’analyse de leurs trois cas d’étude, ce livre a permis aux auteurs de désigner 10 tendances de fond caractérisant la grande majorité des politiques mondiales contemporaines: le choc des souverainetés; l’attention croissante portée aux individus; l’universalisation des aspirations; la promotion d’un récit holistique; le rôle d’orchestration des organisations internationales; la recherche d’inclusion; la codification croissante; l’accent mis sur l’expertise; la résilience du fossé Nord-Sud; et l’hégémonie de l’Occident.
«En comprenant mieux comment les politiques mondiales sont fabriquées, nous pourrons plus facilement imaginer des voies autres à la gouvernance mondiale telle qu’elle s’est constituée dans l’histoire moderne», concluent les auteurs.
À propos de ce livre
Vincent Pouliot et Jean-Philippe Thérien, Comment s’élabore une politique mondiale: dans les coulisses de l’ONU, Paris, Presses de Sciences Po, 2024, 240 p.