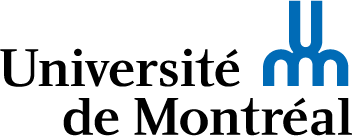«Guide alimentaire canadien»: les stratégies de l'industrie agroalimentaire décortiquées
- UdeMNouvelles
Le 24 mai 2024
- Martin LaSalle
Des acteurs de l’industrie agroalimentaire ont utilisé différentes stratégies d’influence pour manifester leur opposition lors de la révision du «Guide alimentaire canadien», de 2016 à 2019.
Les grands joueurs de l’industrie agroalimentaire du pays ont usé de plusieurs stratégies pour manifester leur opposition aux lignes directrices émises par Santé Canada lors de la révision du Guide alimentaire canadien, qui s’est déroulée de 2016 à 2019.
En tout, ils ont mené 366 activités politiques et commerciales, dont 82 (22 %) consistaient à critiquer les données scientifiques sur lesquelles s’appuyait Santé Canada et 76 (21 %) à présenter des données non publiées et triées sur le volet parce qu’elles étaient à l’avantage de l’industrie agroalimentaire.
C’est ce qu’a constaté Marie-Chantal Robitaille dans ses travaux de maîtrise effectués sous la direction du professeur Jean-Claude Moubarac, du Département de nutrition de l’Université de Montréal. Ses résultats ont été récemment publiés dans la revue Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada: Recherche, politiques et pratiques.
Actualiser le «Guide» en évitant les conflits d’intérêts
Au cours de la révision qui a duré trois ans, un comité mis sur pied par Santé Canada avait le mandat de tenir des consultations pour mettre à jour le Guide alimentaire canadien en se basant sur trois principes directeurs et recommandations (voir l'encadré à la fin de l’article).
Pour des raisons de transparence et afin d’éviter les conflits d’intérêts, les acteurs de l’industrie agroalimentaire ont été exclus des consultations, tout comme les experts et les scientifiques financés par l’industrie.
«Cette décision de Santé Canada est soutenue par la littérature scientifique ainsi que par l’Organisation mondiale de la santé, selon qui la collaboration entre le public et le privé peut altérer l’intérêt général en santé publique et rendre difficile l’établissement de politiques publiques en ce domaine», explique Marie-Chantal Robitaille.
De plus, la dernière version du Guide était jugée désuète par plusieurs professionnels de la santé, «qui la trouvaient inefficace et peu crédible parce qu’elle était devenue un outil de marketing pour certains produits», ajoute-t-elle.
Bien qu’ils n’aient pas participé à la consultation publique, les acteurs de l’industrie ont néanmoins pu s’exprimer quant aux lignes directrices en déposant 11 mémoires au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes.
Répertorier et analyser les actions de l’industrie
C’est dans ces mémoires, et les sites Internet des 11 auteurs des mémoires, que Marie-Chantal Robitaille a répertorié les activités politiques et commerciales de l’industrie, qu’elle a regroupées en quatre grandes stratégies, soit:
- la gestion de l’information (suppression d’information, atteinte à la crédibilité de tiers, etc.);
- les approches discursives (faire porter le débat sur les questions d’alimentation et de santé publique pour favoriser les intérêts de l’industrie);
- l’influence politique (lobbys et contacts indirects auprès des décideurs);
- la gestion de coalitions (création d’un réseau d’appui, notamment avec des professionnels de la santé et d’autres opposants).
«Mes travaux visaient d’abord à cerner les activités politiques et commerciales menées par des acteurs de l’industrie agroalimentaire pendant l'élaboration du Guide alimentaire canadien afin d'influencer le processus de révision, puis à analyser le discours et la position de ces acteurs quant aux trois principes directeurs et aux recommandations proposés par Santé Canada», mentionne l’étudiante.
Pas moins de 366 activités politiques
Les 366 activités politiques et commerciales qu’elle a recensées sont principalement le fait de trois organisations nationales, soit Les producteurs laitiers du Canada (24 %), le Conseil du jus (20 %), qui compose l’industrie des boissons sucrées et des boissons gazeuses, et l’Association nationale des engraisseurs de bovins (16 %).
Les stratégies de gestion de l’information se sont concrétisées en 197 activités (une proportion de 53,8 %), tandis que les stratégies discursives ont donné lieu à 108 activités (29,5 %). La pratique la plus courante de gestion de l'information était la «suppression», qui reposait principalement sur la critique des données scientifiques en soulignant leur complexité et leurs incertitudes. Elle s’est traduite par 98 activités politiques et commerciales (27 %).
Par exemple, dans leur mémoire présenté au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes, les Producteurs d’œufs du Canada ont indiqué que le dialogue entre les producteurs agroalimentaires et les professionnels de la santé «est une étape importante pour assurer l’équilibre des opinions», illustre Marie-Chantal Robitaille.
Le Conseil des viandes du Canada a tenté une manœuvre semblable pour justifier l’importance d’être consulté, affirmant qu’il disposait d’une «expertise en science de la nutrition de même qu’en matière d’éducation du consommateur».
Des pressions qui n’ont pas ébranlé les scientifiques ni Santé Canada
Selon la chercheuse et ses collègues, les pressions exercées par l’industrie agroalimentaire sur le comité de révision du Guide alimentaire canadien ainsi que sur Santé Canada sont demeurées lettre morte.
«C’est d’ailleurs ce qui situe avantageusement le Canada par rapport à d’autres pays où l’industrie agroalimentaire est parvenue à faire des gains, dit Marie-Chantal Robitaille. D’ailleurs, la littérature scientifique à ce sujet montre que l’industrie a usé des mêmes stratégies, notamment aux États-Unis, où les entreprises se sont liguées de 2010 à 2012 pour contrer les efforts du gouvernement destinés à lutter contre l’obésité.»
L’une des principales tactiques mises de l’avant par cette industrie est «d’exagérer les coûts qu’elle devra absorber pour s’adapter aux changements proposés et d’employer un ton alarmiste pour mettre en garde le public quant aux problèmes économiques et d’accès aux aliments que ceux-ci entraîneront», conclut l’étude.
Trois principes directeurs ont présidé à l’élaboration du dernier «Guide alimentaire canadien»
Principe no 1: Une variété d’aliments et de boissons nutritifs est le fondement d’une saine alimentation. Santé Canada recommande:
- la consommation régulière de légumes, de fruits, de grains entiers et d’aliments riches en protéines, surtout en protéines d’origine végétale;
- l’inclusion d’aliments qui contiennent surtout des lipides insaturés plutôt que des lipides saturés;
- la consommation régulière d’eau.
Principe no 2: Les aliments et boissons transformés ou préparés riches en sodium, sucre ou lipides saturés nuisent à une saine alimentation. Santé Canada recommande:
- la consommation limitée d’aliments transformés ou préparés riches en sodium ou en lipides saturés;
- la non-consommation de boissons transformées ou préparées riches en sucre.
Principe no 3: Des connaissances et compétences sont nécessaires pour naviguer dans un environnement alimentaire complexe et favoriser une saine alimentation. Santé Canada recommande:
- un choix d’aliments nutritifs dans les épiceries et les restaurants;
- la planification et une préparation de repas et collations sains;
- la prise des repas en famille ou entre amis aussi souvent que possible.