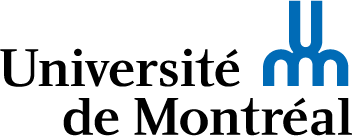Élections fédérales 2025: patrimoine, accessibilité et inclusion… Des thèmes à discuter
- UdeMNouvelles
Le 11 avril 2025
- Martin LaSalle
En vue du scrutin fédéral du 28 avril, Claudine Déom et Jean-Pierre Chupin pointent des questions sociales que les partis politiques devraient aborder pendant la présente campagne électorale.
Tandis que le Canada se prépare pour le scrutin fédéral du 28 avril, des sujets importants comme la protection du patrimoine culturel et l’accessibilité des lieux publics méritent une attention particulière.
Les professeurs Claudine Déom et Jean-Pierre Chupin, de l’École d’architecture de l’Université de Montréal, soulignent l’urgence de traiter ces questions et appellent les partis politiques à les intégrer dans leurs priorités. Leurs analyses, bien que distinctes, arrivent au même constat: la nécessité de politiques publiques visionnaires pour un Canada plus inclusif et respectueux de son héritage.
Le patrimoine culturel, un oublié des élections
Experte en patrimoine bâti, Claudine Déom déplore qu’il soit trop souvent absent des débats électoraux fédéraux. Pourtant, un revers majeur a récemment marqué le milieu du patrimoine: l’abandon du projet de loi C-23, Loi concernant les lieux, personnes et événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national, les ressources archéologiques et le patrimoine culturel et naturel, mort au Feuilleton en raison de la prorogation du Parlement. Cette loi visait à combler une lacune majeure: le Canada est le seul pays du G7 sans législation protégeant ses propres lieux patrimoniaux désignés.
«Concrètement, l’abandon de cette loi laisse des centaines de lieux culturels sans protection légale, indique la professeure d’architecture. Des bâtiments emblématiques comme les bureaux de poste, les pénitenciers, les phares ainsi que des infrastructures telles que les canaux et les ponts restent vulnérables. Le projet de loi C-23 aurait imposé aux ministères fédéraux et à certaines sociétés d’État des mesures pour préserver la valeur patrimoniale de ces lieux, selon des normes et des principes d’excellence.»
Claudine Déom mentionne que cette loi aurait également permis une plus grande participation des Autochtones à la désignation et la conservation des sites historiques au pays, le gouvernement alignant ainsi ses politiques patrimoniales sur les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.
Selon elle, cet abandon législatif représente «un non-sens pour la protection de l’héritage culturel canadien». Elle demande donc aux partis politiques de relancer «ce dossier essentiel qui touche non seulement à la préservation de l’histoire, mais aussi à la réconciliation avec les peuples autochtones».
Accessibilité universelle et qualité inclusive, des défis urgents et complexes
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en architecture, Jean-Pierre Chupin interpelle le futur gouvernement sur trois questions critiques liées à l’inclusion et à l’accessibilité des endroits publics.
D’abord, l’atteinte de l’accessibilité universelle d’ici 2040 est-elle un défi réalisable?
«La Loi canadienne sur l’accessibilité, adoptée en 2019, vise à rendre tous les lieux publics accessibles d’ici 2040, mais les progrès sont lents», soulève-t-il.
En effet, selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité couvrant les années 2017 à 2022, 27 % des Canadiennes et Canadiens vivent avec un handicap, et cette proportion atteint 50 % quand sont inclus les aidants et les familles.
«Malgré cela, une étude Léger de 2024 révèle que 57 % des Canadiens et des Canadiennes jugent l’accessibilité des bâtiments publics moyenne ou faible, déplore le professeur. Au-delà des obstacles physiques, des barrières comportementales freinent l’évolution des mentalités, dont les préjugés et la méconnaissance des handicaps, ainsi que le capacitisme, soit la discrimination basée sur les capacités. Le vieillissement de la population, bien que réel, ne suffit pas à mobiliser les décideurs.»
Ensuite, quelles actions le gouvernement fédéral devrait-il entreprendre pour agir contre l’incompréhension du rapport particulier à l’espace vécu par les personnes qui présentent des différences?
«L’Enquête canadienne sur l’incapacité montre que 60 % des personnes rencontrent des obstacles dans les lieux publics, dit Jean-Pierre Chupin. Les normes actuelles, centrées sur la sécurité et l’hygiène, ne garantissent pas une accessibilité de qualité, se limitant souvent à des palliatifs.»
Aussi propose-t-il de repenser la conception des endroits publics à travers la notion de qualité inclusive, une approche qui va au-delà des normes techniques pour intégrer la valeur sociale des lieux. «Par exemple, pour qu’un endroit public soit véritablement inclusif, il ne suffit pas d’installer une rampe d’accès: il doit être conçu pour que toutes les personnes, quels que soient leurs handicaps, puissent y vivre une expérience agréable et autonome», illustre-t-il.
De même, il souligne que l’insécurité ressentie par les femmes dans les lieux publics est «une question souvent négligée dans les discussions sur l’accessibilité. Un environnement inclusif doit aussi être sécurisant, en tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des minorités de genre».
Enfin, comment assurer la valeur sociale des environnements publics à travers le prisme de la qualité inclusive au-delà des normes de sécurité?
Jean-Pierre Chupin plaide pour une refonte des pratiques architecturales, plaçant l’humain au cœur du processus. Selon lui, la qualité inclusive doit devenir un critère central, qui transcende les normes de construction. Il donne l’exemple des personnes neurodivergentes «pour qui un environnement sensoriellement neutre est essentiel ou des personnes malvoyantes et malentendantes qui ont besoin de repères tactiles, visuels et auditifs adaptés».
«Pour ce faire, il faut une mobilisation collective: les architectes, les urbanistes, les décideurs et la population doivent collaborer», conclut-il.