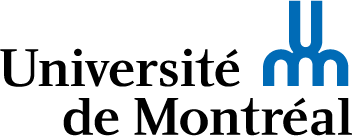Une thérapie de couple pour améliorer le désir sexuel
- UdeMNouvelles
Le 10 juillet 2024
- Béatrice St-Cyr-Leroux
Une nouvelle thérapie comportementale basée sur le couple permettrait de soutenir les femmes vivant avec un trouble du désir sexuel et d’amoindrir la détresse qui y est associée.
La baisse du désir sexuel est la difficulté sexuelle la plus courante chez les femmes, touchant de 30 à 40 % des adultes. Et pour 7 à 23 % de la population féminine, cette diminution s’accompagne d’une détresse significative. On parle alors d’un trouble de l’intérêt sexuel et de l’excitation, comme établi par les critères diagnostiques de la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.
Malgré la forte prévalence de cette baisse du désir sexuel et les conséquences psychologiques, sexuelles et relationnelles qui en découlent pour les femmes et leurs partenaires, il existait jusqu’alors relativement peu d’options thérapeutiques fondées sur des données probantes.
Or, une nouvelle thérapie sexuelle fondée sur le couple vient d’être testée et standardisée par Sophie Bergeron, professeure au Département de psychologie de l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les relations intimes et le bien-être sexuel, en collaboration avec Natalie O. Rosen, de l’Université Dalhousie, et Katrina Bouchard, de l’Université de la Colombie-Britannique.
Les chercheuses ont mené une récente étude de faisabilité qui révèle que cette intervention produit des améliorations de modérées à importantes des principaux symptômes de faible désir sexuel dyadique et de détresse sexuelle. Un essai clinique randomisé, qui devrait débuter en janvier prochain, viendra valider cette efficacité.
Un problème qui appartient aux deux partenaires
La thérapie comportementale pensée par Sophie Bergeron et ses collègues pour traiter le trouble de l’intérêt sexuel et de l’excitation s’attaque directement à la nature interpersonnelle de la détresse liée à la baisse du désir sexuel.
«Les troubles du désir sont les plus relationnels, ils présentent peu de facteurs biomédicaux et sont plutôt liés à l’interaction entre les deux membres d’un couple. Il faut donc reconceptualiser le problème comme étant un problème de couple plutôt qu’un enjeu individuel», note-t-elle.
L’intervention table ainsi sur la communication, l’acceptation, l’ouverture et la vulnérabilité entre les partenaires. Elle cible d’abord le développement de l’intimité au sein du couple – un facteur de protection pour le désir sexuel. «Quand on se sent proche de l’autre, en acceptant de se dévoiler, mais aussi en recevant une réponse empathique de l’autre, et qu’on a l’impression d’être compris, entendu et vu par son partenaire, les données montrent que le désir sexuel augmente», souligne la chercheuse, également directrice du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles.
La thérapie invite aussi à parler ouvertement de sexualité, un des sujets les plus difficiles pour les couples, selon Sophie Bergeron. Les partenaires apprennent alors à exprimer leurs besoins, leurs préférences et leurs réticences sans peur de blesser l’autre.
Si le traitement repose surtout sur des discussions guidées par une ou un thérapeute, il comporte aussi des exercices à réaliser à la maison, par exemple des séances de sensibilisation corporelle, où les partenaires doivent réapprivoiser le toucher sans pression d’avoir une relation sexuelle.
Une déstigmatisation qui soulage
Une bonne part de l’intervention concerne aussi le déboulonnement de mythes liés à la sexualité, dont ceux qui mènent les femmes à se blâmer et se culpabiliser pour leur manque de désir.
«Il y a un travail de défusion cognitive à faire pour distinguer la femme du trouble, normaliser et dédramatiser, et surtout axer les comportements sur le plaisir et la qualité des relations sexuelles plutôt que sur la fréquence», précise Sophie Bergeron.
Aux yeux de la chercheuse, ce volet psychoéducatif semble particulièrement utile pour alléger le fardeau émotionnel – notamment la honte et la frustration – du trouble de l’intérêt sexuel et de l’excitation.