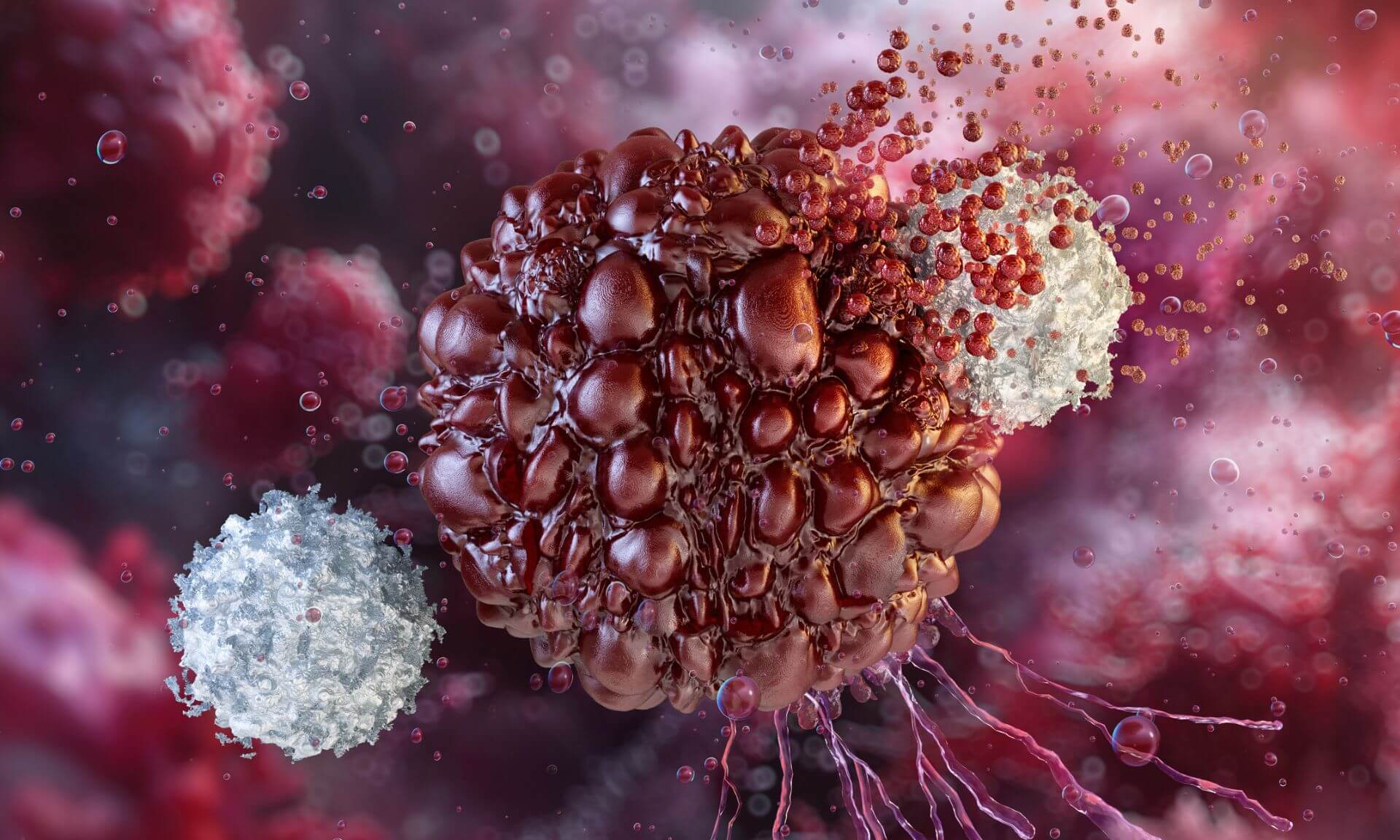Nutrition et cancer pédiatrique: comment parler aux adolescents?

Avoir un cancer durant l’enfance ou l’adolescence peut laisser plusieurs marques, certaines causées par la maladie elle-même, d’autres par les interventions thérapeutiques pour le combattre. «Les traitements sont très agressifs, en particulier pour un corps en développement», dit Andra Dima, étudiante de doctorat en nutrition sous la direction de Valérie Marcil, professeure au Département de nutrition de l’Université de Montréal.
L’étudiante aimerait ainsi aider les adolescents à atténuer les effets de ces traitements difficiles et faire avancer les connaissances en matière de prévention des complications cardiométaboliques. Après un baccalauréat en nutrition, elle a amorcé une maîtrise en janvier 2024 avant de faire un passage accéléré au doctorat cet hiver pour se plonger dans ce projet, soutenu par la Fondation Charles-Bruneau et un financement du Fonds de recherche du Québec.
Diminuer les effets des traitements

Pour diminuer les conséquences cardiométaboliques pendant et après les traitements, l’équipe dirigée par Valérie Marcil a implanté le projet de recherche VIE (Valorisation, implication, éducation) au CHU Sainte-Justine entre 2017 et 2022 auprès de jeunes atteints d’un cancer. Ce programme débute dès le premier mois suivant le diagnostic, en collaboration avec l’équipe médicale traitante, et repose sur trois volets complémentaires: la nutrition, l’activité physique et le soutien psychosocial.
S’il a connu du succès auprès des enfants et de leurs parents, les adolescents, eux, ont moins bien répondu à l’approche axée sur la famille, couramment employée en pédiatrie. Du côté nutrition, seulement 27,5 % des jeunes ont participé à au moins quatre des six consultations qui leur étaient offertes, comparativement à 60,5 % des enfants.
Or, les adolescents sont particulièrement vulnérables aux traitements contre le cancer et souffrent plus fréquemment de complications cardiométaboliques: 42 % risquent de présenter au moins deux complications (haute pression, dyslipidémie, prédiabète, etc.) environ un an et demi après le traitement, comparativement à 2 % des enfants.
Avec VIE-Ado, la doctorante, dont les recherches s’inscrivent dans les travaux de sa directrice, veut adapter le programme VIE à cette tranche d’âge.
S’adresser aux adolescents
Que faire pour favoriser une meilleure participation des jeunes? «Il faut considérer leurs contextes social, développemental et émotionnel pour faciliter leur intégration dans le programme», affirme Andra Dima. Une étude a en effet mis en lumière des barrières à la participation à VIE et des facteurs la facilitant, dont le besoin d’un accompagnement renforçant le sentiment d’autoefficacité et centré sur la reprise de contrôle sur sa vie.
Dans un premier temps, la doctorante élaborera le nouveau programme en collaboration avec l’équipe du Centre de cancérologie Charles-Bruneau et d’anciens participants. L’année passée à la maîtrise aura en effet permis de mettre en place la méthodologie et de commencer le processus d’approbation par le comité d’éthique de la recherche. «Nous sommes dans la phase de recrutement et visons la participation de 10 personnes qui avaient entre 13 et 21 ans lors du programme original», indique-t-elle. La première étape, qui devrait se dérouler sur les six prochains mois, est donc prête à s’amorcer.
Une méthodologie mixte
La collecte de donnée se fera de manière cumulative et constructiviste, à travers trois groupes de discussion de trois à quatre personnes. Les deuxième et troisième groupes pourront non seulement proposer des pistes d’amélioration au programme original, mais également réagir aux points apportés dans les groupes de discussion précédents. Chaque jeune fournira ensuite son avis sur les solutions retenues à l’aide d’un questionnaire. Le point de vue des parents et des professionnels de l’équipe soignante sur ces solutions sera de même recueilli par questionnaire. «Cette approche permet de renforcer la validité des solutions évoquées, malgré le petit nombre de participants», note Andra Dima.
Dans un deuxième temps, le programme sera implanté au CHU Sainte-Justine auprès d’adolescents chez qui un cancer a été nouvellement diagnostiqué et la doctorante évaluera sa faisabilité et son acceptabilité, pour finalement mesurer son effet sur le risque de complications cardiométaboliques.
La méthodologie de recherche élaborée pourrait par la suite servir de modèle pour la personnalisation d’interventions promouvant de saines habitudes de vie auprès de divers publics cibles. «Je trouve que la nutrition a vraiment un grand potentiel dans la prévention et dans la gestion des maladies, remarque Andra Dima. J’aimerais contribuer à mieux définir le rôle de la nutrition, pouvoir la personnaliser et montrer son incidence sur la qualité de vie de ces jeunes.»